Mishellénisme
Le mishellénisme est une détestation, un mépris de la Grèce, des Grecs et de la culture grecque.
Le mishellénisme est présent tout au long de l’Histoire, mais, étant ancien et profondément ancré dans l’inconscient collectif de l’opinion romaine et d’Occident depuis l’Antiquité latine, il apparaît « moins visible » aux yeux d’un occidental que le philhellénisme, phénomène plus marginal, plus « excentrique » et généralement cantonné aux lettrés et aux aristocraties (par exemple, chez les patriciens romains ou les savants et philosophes occidentaux de l'époque des Lumières et du XIXe siècle).
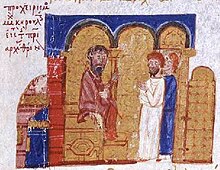

Antiquité romaine
Au-delà de Caton l'Ancien, qui lorsqu’il était censeur s’éleva contre l’hellénisation de la République romaine, la littérature latine exprime un certain mishellénisme[1].
Les opinions des Romains sur les Grecs étaient souvent peu favorables. Plaute décrivait « leur luxure et leur ivrognerie », et pour lui « parole d’un Grec » et « calendes grecques » étaient synonymes. La grammaire latine multipliait les citations dévalorisant les Grecs, comme le vers de Virgile écrit au livre II de l’Énéide : « Timeo Danaos et dona ferentes. » (« Je crains les Grecs, même quand ils apportent des cadeaux. ») ou encore l’exemple tiré de Juvénal : « Non possum ferre, Quirites, Graecam Urbem. » (« Je ne peux supporter, Citoyens, une Ville grecque. »)[2]. Et Pline l'Ancien, Sénèque, Quintilien véhiculaient la même opinion des Grecs qu’ils trouvaient « impudents, vénaux, vaniteux et serviles » : il y avait eu très peu de bons Grecs, et ils étaient tous morts. Les auteurs chrétiens étaient du même avis : la Première épître aux Corinthiens était lue comme un catalogue des « vices et dépravations » empêchant les Grecs de gagner le Paradis[3], alors que Johann Joachim Winckelmann dans son ouvrage Réflexions sur l'imitation des œuvres grecques dans la sculpture et la peinture (Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst) de 1755[4] chantait ces mêmes mœurs comme une manifestation de la « liberté grecque » (griechische Freiheit).
Moyen Âge
Au Moyen Âge, la Grèce et les Grecs étaient présentés par la propagande des clercs de l’église catholique romaine avec suspicion, mépris voire dégoût[5]. Selon Paul Tannery, cette suspicion est un héritage non seulement de la lecture des auteurs romains antiques, mais surtout du schisme de 1054 entre Rome et Constantinople : toute l’histoire romaine et celle du christianisme ont, depuis, été récrites de manière à présenter l’église de Rome comme seule héritière légitime de l’église primitive, à rejeter la responsabilité du schisme sur les quatre autres patriarches (Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem) et à occulter le fait qu’après avoir quitté la Pentarchie (qu’elle ne reconnaît d’ailleurs pas[6]) elle s’en est éloignée théologiquement et canoniquement au fil des 14 conciles qui lui sont propres. Même l’appellation d’« Empire byzantin » (qui apparaît seulement en 1557, sous la plume d’un historien allemand, Hieronymus Wolf) a pour but de séparer l’histoire de l’Empire romain d'Orient, présenté de manière péjorative, de celle de l’Empire d'Occident, revendiqué comme « matrice de l'Europe Occidentale »[7], en dépit du fait que les citoyens de l’Empire d’Orient nommaient leur État Basileía tôn Rhômaíôn (« empire des Romains »)[8], et ne se sont jamais désignés comme « Byzantins » mais se considéraient comme des Romains (Rhomaioi, terme repris par les Perses, les Arabes et les Turcs qui les appellent « Roum »).
À la fin du XIe siècle, les chroniqueurs normands Geoffroi Malaterra et Guillaume de Pouille qualifieront les Grecs de « gens mous, paresseux, lâches et efféminés par leur manière de se vêtir et par leurs mœurs trop raffinées, qui leur ont fait perdre ce qui fait la force et le prestige des Normands : le courage à la guerre, l'aptitude à supporter les privations, le sens de l'honneur et du sacrifice »[9].
Lors des croisades, le raffinement de la civilisation byzantine éveillait la méfiance des chevaliers occidentaux, épris de chasse et de prouesses guerrières ; ils n'avaient que mépris pour « ces petits Grecs efféminés, les plus lâches des hommes », dont ils craignaient les ruses et la traîtrise[10].
Cette vision péjorative rendit moralement acceptable (en Occident) le sac de Constantinople par la Quatrième croisade, qui élargit encore le fossé sur les plans religieux et politique. La prise de Constantinople par les Croisés en 1204 et le partage de l’Empire byzantin affaiblirent définitivement les États grecs face aux Arabes et aux Turcs musulmans du Proche Orient et face à l’Occident latin, qui s’empara alors de l’hégémonie mondiale. Même si d’un point de vue local, dès 1261-1262 les Grecs avaient reconquis leur capitale et recréé leur Empire, la puissance et le rayonnement byzantin avaient définitivement pâli[11]. Enfin, la prise de Constantinople en 1453, et d'Athènes en 1456 par les Ottomans achevèrent de ternir l’image des Hellènes en Occident[12].
Cette situation occulta la transmission par l’Empire grec de sa culture, de ses savoirs et de ses technologies, non seulement aux Arabes de l’orient, mais aussi à ceux de l’occident, par exemple au Xe siècle, lorsque Constantin VII et Romain Lécapène envoient des copies des bibliothèques impériales à Hasdaï ibn Shaprut, ministre du calife de Cordoue Abd al-Rahman III. Parmi ces copies, on trouve De materia medica, du médecin et botaniste grec Dioscoride. Les Juifs helléniques furent aussi un facteur oublié de transmission des savoirs grecs vers l’Occident[13]. Bien qu’elle ait été étudiée par les « philhellènes », cette transmission reste largement ignorée dans l’historiographie classique occidentale, qui affirme tenir des Arabes sa redécouverte du patrimoine antique, sans se demander d’où ceux-ci le tenaient : n’appelons-nous pas « hammam » les thermes, et « style mauresque » l’art roman byzantin, adapté aux goûts des Arabes ? Les « philhellènes », eux, affirment qu’au XVe siècle, c’est en grande partie par l’intermédiaire de manuscrits byzantins que l’on redécouvrit en Occident la science antique, principalement à travers Aristote et Ptolémée. Quelques décennies avant la chute de Constantinople, des érudits grecs commencèrent à émigrer vers Venise et les principautés italiennes, emportant avec eux quantité de manuscrits[14].
L’évènement politique déterminant de ce transfert des « humanités » du monde byzantin vers l’Italie est le concile de Florence de 1438, au cours duquel l’empereur grec Jean VIII Paléologue sollicita (vainement) l’appui des royaumes occidentaux contre la menace d’invasion musulmane. Des érudits comme Manuel Chrysoloras, Démétrios Kydones, François Philelphe, Giovanni Aurispa, ou Vassilios Bessarion jouèrent un rôle particulièrement actif dans la transmission des écrits grecs, telle l’encyclopédie appelée Souda (du grec ancien Σοῦδα / Soũda) ou Suidas (du grec ancien Σουίδας / Souídas) constituée vers la fin du IXe siècle et imprimée par Démétrius Chalcondyle à Milan en 1499[15]. Les bibliothèques vaticane et vénitienne (Biblioteca Marciana) recèlent encore de nombreux manuscrits astronomiques de cette époque, totalement inédits ou édités récemment, comme le Vaticanus Graecus 1059 ou le Marcianus Graecus 325 de Nicéphore Grégoras. Ce transfert culturel et scientifique joua un rôle important l’avènement de la Renaissance, mais il fut profondément occulté par le mishellénisme ambiant qui domina longtemps l’inconscient collectif occidental[16].
Époques moderne et contemporaine


Aux époques moderne et contemporaine, de nombreux auteurs occidentaux sont « victimes » de leurs lectures, imprégnées de mishellénisme sans qu'ils en soient conscients : même Voltaire, influencé par Wolf, voit en Byzance un « modèle d’obscurantisme religieux et fossoyeur des arts »[17], tandis que pour Thouvenel « l’Orient est un ramassis de détritus de races et de nationalités dont aucune n’est digne de notre respect »[18] ; quant à Edward Gibbon, il décrit l’Empire grec comme un état dogmatique (c’est l’un des sens du mot « orthodoxe ») n’ayant rien à léguer à l’Occident[19]. D'autres exemples de ces opinions se trouvent dans les ouvrages des ecclésiastiques René François Rohrbacher[20] ou Jean Claude Faveyrial[21].
À côté de ce mishellénisme historique, souvent inconscient, un « mishellénisme de déception » apparait au début du XIXe siècle lorsque les voyageurs nourris de l’imaginaire romantique de Winckelmann et de lord Byron découvrent une Grèce ottomane bien différente de leurs attentes : un pays méditerranéen pauvre, patriarcal, clanique, clientéliste, peu instruit, ignorant tout de son histoire (peu nombreuse, sa classe intellectuelle vit à Constantinople ou à l’étranger). La Grèce est parcourue par des bandes de toute sorte, armatoles ou klephtes plus brigands que héros, pour lesquels le visiteur étranger est d’abord une source de gains faciles. Pendant la Guerre d'indépendance grecque, ce « mishellénisme de déception » est renforcé par le massacre de la population turque de Tripolitsa et le pillage du butin par les insurgés de Theódoros Kolokotrónis, et par leur indiscipline générale, en particulier à Nauplie en 1832, lors de l’expédition de Morée[22]. Cette situation encouragea les grandes puissances à imposer comme roi de Grèce un allemand, le prince Louis Ier de Bavière devenu Othon de Grèce et à condamner Kolokotrónis pour désobéissance. Face au « mishellénisme de déception », l’un des arguments des philhellènes et de l’engagement de l’Occident pour la cause grecque, était que les Grecs ottomans auraient « dégénéré » en raison de leur longue sujétion (quatre siècles) aux Turcs. Mais lorsqu’après leur libération, les Grecs ne se montrent pas « meilleurs » dans le sens qu’avaient espéré les Occidentaux, le discours se modifia.
Les textes d’Edmond About comme La Grèce contemporaine de 1854 expriment cette opinion, bien que par ailleurs About trouve le pays admirable[23] et sa population « un des peuples les plus spirituels de l’Europe [qui] travaille facilement »[24] et auquel il reconnait une passion pour la liberté, un sentiment de l’égalité et un patriotisme sincère[25]. Le mishellénisme d'About, qui a souvent été très exagéré par la suite, est davantage à attribuer à son propre style caractéristique, caustique et incisif, très goûté à l’époque, à un moment où le philhellénisme n’était plus à la mode, et où l’on découvrait qu’en Grèce vivent aussi des gens malhonnêtes qui n’ont rien à voir avec leurs glorieux ancêtres de l’époque de Périclès. About ne décrit pas tous les Grecs, mais une classe dirigeante corrompue par le clientélisme méditerranéen, préfigurant ainsi les discours du XXIe siècle sur la « crise grecque ». Cette description, abusivement généralisée par d’autres commentateurs à toute la population grecque, fige dans l’esprit des lecteurs une différence définitive entre la Grèce antique, positive, et la Grèce moderne, méprisable[26].
Edmond About a aussi décrit l’archétype du bandit de grand chemin qui n’a plus l’excuse d’être un insurgé patriote, lorsqu’en 1870, durant le règne de Georges Ier, de tels bandits prennent en otage des touristes italiens et britanniques près d’Oropos. Alors que la rançon est en train d’être réunie, l’assaut de l’armée grecque aboutit à la mort des bandits mais aussi à celle des otages, massacrés par leurs ravisseurs. Cette tragédie entraîne une forte campagne de presse à l’étranger, notamment en Grande-Bretagne, visant indistinctement le royaume grec et sa population. Nul n’évoque les conditions environnementales, économiques et sociales du monde méditerranéen du XIXe siècle, très différent de celui de l’antiquité et devenu, en Grèce comme ailleurs, une terre de misère, d’illettrisme, de violence et d’émigration.
Au XXe siècle, le Guide Bleu de Paris à Constantinople de 1914 précise, à propos des guides-interprètes d’Istanbul : « Grecs, Arméniens ou Juifs, tous sont ignorants et incapables de donner des explications si on les sort de leur routine habituelle »... tout en concédant que « les Juifs, moins arrogants, plus modestes, sont somme toute préférables »[27]. Entre 1919 et 1922, eut lieu la guerre gréco-turque qui aboutit à la reprise par les nationalistes turcs, des terres concédées à la Grèce par le Sultan ottoman au traité de Sèvres, et en partie peuplées de populations grecques. Ce fut l’occasion pour un autre écrivain français, Pierre Loti, d’exprimer son mishellénisme en approuvant l’expulsion de ces populations, nonobstant les violences qui coûtèrent la vie à 480 000 grecs de Turquie[28]. Le mishellénisme se retrouve jusque dans le domaine des jeux de hasard où le mot « grec » désigne un tricheur[29] et dans la bande dessinée, par exemple dans l’univers de Thorgal sous la plume du scénariste Jean Van Hamme qui dépeint les « Byzantins » tels qu’on les lui a décrits dans la Belgique catholique de sa jeunesse : rapaces, décadents et corrompus[30].
Durant la Première Guerre mondiale, les « Vêpres grecques » aussi furent le sujet d'une série d'articles mishelléniques dans les médias de Paris et Londres.
En 2012, des ministres allemands (Wolfgang Schäuble, Guido Westerwelle, Philipp Rösler[31]) et des périodiques comme The Economist, Le Figaro ou Der Spiegel ont également relayé ou émis des opinions mishelléniques en attribuant aux seuls Grecs, tous collectivement jugés « irresponsables, profiteurs et menteurs », la responsabilité la crise de la dette publique grecque, comme s’il n'y avait pas eu depuis 2008 une crise financière internationale.
Ainsi, le mishellénisme est un phénomène bimillénaire, d’abord romain, ensuite catholique, ayant, comme l’antisémitisme, des racines culturelles et religieuses anciennes, et se nourrissant à l’époque contemporaine de motifs économiques ou politiques pour exprimer une hostilité émotionnelle face aux « Levantins » ; le mishellénisme peut aussi être un substitut à l’antisémitisme, lorsque celui-ci n’est plus ouvertement exprimable[32].
Bibliographie
Ouvrages
- (fr) Sophie Basch, Le mirage grec. La Grèce moderne devant l'opinion française. (1846-1946)., Hatier, Paris, 1995. (ISBN 2-218-06269-0)
- (fr) Sophie Basch (dir.), La métamorphose des ruines., École française d'Athènes (coll. Champs helléniques modernes), Athènes, 2004. (ISBN 2869581742)
- (fr) Georges Contogeorgis, Histoire de la Grèce, Hatier, coll. « Nations d'Europe », 1992 (ISBN 2-218-03-841-2).
- (fr) Gilles Grivaud (éditeur), Le(s) mishellénisme(s), Actes du séminaire tenu à l'École française d'Athènes, 16-, Athènes, éd. École française d'Athènes (coll. Champs helléniques modernes et contemporains 3), 2001. (ISBN 2-86958-191-2)
- (en) Terence Spencer, Fair Greece, Sad Relic. Literary Philhellenism from Shakespeare to Byron., Denis Harvey, Athènes, 1986. (ISBN 0907978215) (première édition 1954)
Articles
- (fr) Catherine Valenti, « L'École française d'Athènes au cœur des relations franco-helléniques. 1846-1946. », Revue d'Histoire moderne et contemporaine, no 50-4, 2003. lire sur Cairn
Voir aussi
Notes et références
- (en) Albert Henrichs, « Graecia Capta : Roman Views of Greek Culture », Harvard Studies in Classical Philology, vol. 97, , p. 247 (DOI 10.2307/311309).
- T. Spencer, op. cit., p. 32-35
- Terence Spencer, Fair Greece, Sad Relic., p. 32-35.
- Dernière édition française : Pensées sur l'imitation des œuvres grecques en peinture et en sculpture, traduit de l'allemand par Laure Cahen-Maurel, éditions Allia, Paris, 2005
- Sir Steven Runciman dans l'Introduction de Fani-Maria Tsigakou, The Rediscovery of Greece., Thames & Hudson, 1981, (ISBN 9780500233368) p. 7
- La pentarchie ou « gouvernement de cinq personnes » était l'organisation de l'Église chrétienne en cinq Églises patriarcales : Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem par la législation de l'empereur Justinien, au VIe siècle (voir Georgică Grigoriţă, L'autonomie ecclésiastique selon la législation canonique actuelle de l'Église orthodoxe et de l'Église catholique : étude canonique comparative, Rome, Gregorian Biblical BookShop, , 616 p. (ISBN 978-88-7839-190-1, lire en ligne), p. 62), et dans les actes du concile in Trullo (VIIe siècle) que Rome refusa de reconnaître en développant une ecclésiologie attribuant au siège de Rome, censé avoir été fondé par l'apôtre Pierre, la position centrale (lire (en) « Pentarchy », sur Encyclopædia Britannica, (consulté le ) : « the popes of Rome always opposed the idea of pentarchy », (en) Steven Runciman, The Eastern Schism : A Study of the Papacy and the Eastern Churches During the XIth and XIIth Centuries)
- Georg Ostrogorsky, Histoire de l’État byzantin, Paris, 1956, ed. Payot, (réimp. 1977)[réf. incomplète]
- Encyclopædia Universalis, article « Empire byzantin ».
- Images et signes de l’Orient dans l’Occident médiéval, p. 178. Presses universitaires de Provence, 1982. (ISBN 2821835922)
- Guibert de Nogent : Geste de Dieu par les Francs – Histoire de la première croisade (traduit par Monique-Cécile Garand), Brepols, 1998, p. 25. (ISBN 2503507336)
- Georges Contogeorgis, Histoire de la Grèce, p. 191, 204 et 213.
- Hieronymus Wolf, Corpus Byzantinæ Historiæ, 24 tomes, 1557 ; Bernard Flusin, La civilisation byzantine, PUF, 2006, (ISBN 213055850X) et Evelyne Patlagean, Un Moyen Âge grec, Albin Michel 2007, (ISBN 2-226-17110-X).
- Les communautés romaniotes prospéraient de l’Italie du sud à l’Égypte, et essaimèrent dans le sillage de Bélisaire, jusqu’en Espagne et en Septimanie (à Narbonne), et, au XIe siècle, plus au nord à Mayence : on y trouve des patronymes d’origine romaniote comme Kalonymos, Chryssologos, Margolis, Mellinis, Nassis... Les Romaniotes diffusèrent ainsi leur culture et leur art au sein des nouvelles communautés d’Occident, ashkénazes (« allemandes »), sarfaties (« françaises ») et séfarades (« espagnoles »). Ils sont attestés à Venise, dans la vallée du Rhin et en Languedoc : lire Philippe Gardette, Déconstruction des stéréotypes autour de la culture juive à Byzance ou brève tentative de réhabilitation d’une civilisation oubliée, éditions Universitaires européennes, Sarrebruck 2010, 352 pp.
- Émile Legrand, Bibliographie hellénique, ou Description raisonnée des ouvrages publiés en grec par des Grecs aux XVe et XVIe siècles (1885)
- Gallica
- À titre d'exemple, la publication Science et Avenir a publié en janvier 2010 un numéro spécial n° 114 consacré aux Sciences et techniques au Moyen Âge sans la moindre référence au monde byzantin.
- Véronique Prat, Les fastes de Byzance sur [1], 2 janvier 2009.
- Lettre de 1852 à Napoléon III, correspondance d'Edouard-Antoine de Thouvenel, Archives nationales, microfilms sous la cote 255AP sur Archives nationales.
- Edward Gibbon, Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain.
- Histoire universelle de l'église catholique, tome 25, Gomme-Duprey, Paris 1859
- Histoire de l’Albanie publié en 1889 et réédité par Robert Elsie, éd. Balkan Books, Dukagjini, Peja 2001, 426 pp.
- Pierre Vidal-Naquet, Introduction des Mémoires. de Yánnis Makriyánnis, p. 38.
- Edmond About, La Grèce contemporaine, « Chapitre I : Le pays », Paragraphe VIII : « Conclusion - La Grèce telle qu'elle est. », 1855 : « Elle [la Grèce] a même, si je ne me trompe, une beauté plus originale. Je vous accorde que la Grèce ne ressemble pas à la Normandie : tant pis pour la Normandie ? [...] Si un enchanteur ou un capitaliste faisait le miracle de changer la Morée en nouvelle Normandie, il obtiendrait pour récompense les malédictions unanimes des artistes. »
- Edmond About, La Grèce contemporaine, « Chapitre II : Les hommes », Paragraphe IV.
- Edmond About, La Grèce contemporaine, « Chapitre II : Les hommes », Paragraphes V, VI et VII.
- C. Valenti, article cité.
- Guide Bleu de Paris à Constantinople, éd. Hachette, page XVII des Renseignements généraux, au début de l'ouvrage.
- [2]
- Jean-Eugène Robert-Houdin, Les Tricheries des Grecs dévoilées ; l'art de gagner à tous les jeux, 1861
- Dans la trilogie que forment Le Barbare, Kriss de Valnor et Le Sacrifice.
- Philip Rösler sur [url=« http://www.france24.com/fr/20120212-berlin-loue-efforts-reforme-lespagne-portugal »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)] du 12 février 2012 consulté sur France24 le 5 avril 2012
- Hergé, cité par Pierre Assouline dans Hergé : biographie, Plon, 1998, pages 125-126, disait de son personnage Rastapopoulos : « pour moi, c'est plus ou moins un grec levantin, sans plus de précision, de toute façon apatride, c’est-à-dire, de mon point de vue à l’époque, sans foi ni loi ! Un détail encore : il n’est pas juif ! ».
