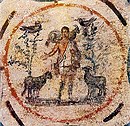Tertullien
| Nom de naissance | Quintus Septimius Florens Tertullianus |
|---|---|
| Naissance |
Vers 160 Carthage, province romaine d'Afrique actuelle Tunisie |
| Décès |
Vers 220 Carthage, province romaine d'Afrique actuelle Tunisie |
| Nationalité | Empire Romain |
| Pays de résidence | province romaine d'Afrique |
| Activité principale |
| Langue d’écriture | Latin |
|---|---|
| Genres |
Œuvres principales
Quintus Septimius Florens Tertullianus, dit Tertullien, né entre 150 et 160 à Carthage (actuelle Tunisie) et décédé vers 220 dans la même ville, est un écrivain de langue latine issu d'une famille berbère[1],[2] romanisée et païenne. Il se convertit au christianisme à la fin du IIe siècle et devient le plus éminent théologien de Carthage.
Auteur prolifique, catéchète, son influence fut grande dans l'Occident chrétien. En effet, il est le premier auteur latin à utiliser le terme de Trinité, dont il développe une théologie précise. Il est ainsi considéré comme l’un des plus grands théologiens de la chrétienté de son temps. C’est également un polémiste qui lutte activement contre les cultes païens et contre le gnosticisme de Marcion.
Sa figure est toutefois controversée, car il rejoint le mouvement hérétique montaniste à la fin de sa vie. Il est, ainsi, avec Origène, un des auteurs à être étudié avec les Pères de l'Église sans en être un à proprement parler, car il n'a pas été canonisé par l’Église catholique.
Biographie
On connaît peu de choses de sa vie. Certains éléments biographiques se trouvent dans quelques-unes de ses œuvres mais également chez Eusèbe de Césarée (Hist. eccl. II, ii. 4) et Jérôme (De viris illustribus, chap. LIII).
Il naît à Carthage entre 150 et 160. Son père, centurion dans une légion de l'armée romaine : la cohorte proconsulaire, meurt très tôt. Excellent élève, il étudie la rhétorique, la jurisprudence, l'histoire, la poésie, les sciences et la philosophie. Brillant rhéteur, on l'a longtemps pensé jurisconsulte de métier, thèse aujourd'hui largement contestée par les spécialistes du sujet[réf. nécessaire].
C'est vers 193 qu'il se convertit au christianisme. Il semble qu'il soit séduit par l'esprit de sainteté qu'il rencontre chez les chrétiens, par leur humilité, leur abnégation face aux persécutions et la hauteur de la doctrine évangélique. Sa conversion est soudaine et décisive. Il dira plus tard : « On ne naît pas chrétien, on le devient » (Apol, XVIII). Adversaire du paganisme et moraliste intransigeant (cf. ses traités sur la femme, le mariage, la chasteté ou le jeûne), il est considéré comme le premier auteur chrétien à énoncer la foi en latin. En effet, jusqu'à Tertullien, le christianisme s'est pensé et formulé en grec car il s'est d'abord développé dans la partie orientale de l'Empire, celle de la Diaspora hellénistique, où l'on parlait le grec. Il s'est d'abord présenté comme un courant philosophique (secta, haeresis). Il épouse une chrétienne. Voici un exemple de ce que Tertullien écrivait à sa femme :
« Douce et sainte alliance que celle de deux fidèles portant le même joug, réunis dans une même espérance, dans un même vœu, dans une même discipline, dans une même dépendance ! Tous deux, ils sont frères, tous deux serviteurs du même maître, tous deux confondus dans une même chair, ne forment qu'une seule chair, qu'un seul esprit. Ils prient ensemble, ils se prosternent ensemble, ils jeûnent ensemble, s'enseignant l'un l'autre, s'encourageant l'un l'autre, se supportant l'un l'autre. Vous les rencontrez de compagnie à l'église, de compagnie au banquet divin. Ils partagent également la pauvreté et l'abondance, la fureur des persécutions ou les rafraîchissements de la paix. Nuls secrets à se dérober, ni à se surprendre mutuellement ; confiance inviolable, empressements réciproques ; jamais d'ennui, jamais de dégoûts. Ils n'ont pas à se cacher l'un de l'autre pour visiter les malades, pour assister les indigents ; leur aumône est sans disputes, leurs sacrifices sans scrupules, leurs saintes pratiques de tous les jours sans entraves. Chez eux point de signes de croix furtifs, point de timides félicitations, point de muettes actions de grâces. De leurs bouches, libres comme leurs cœurs, s'élancent les hymnes pieux et les saints cantiques. Leur unique rivalité, c'est à qui célébrera le mieux les louanges du Seigneur. »
— Tertullien[3], trad. E.-A. Genoud.
Peut-être est-il devenu prêtre[4]. Mais c'est l'année 207 qui marque un tournant dans sa vie avec son adhésion au montanisme. Rompant avec l'Église traditionnelle, ses positions deviennent plus rigoristes. Paradoxalement, il combat avec encore plus d'acharnement Marcion et les hérésies gnostiques qui minent la chrétienté au IIIe siècle et il a beaucoup inspiré Cyprien de Carthage.
Il meurt à Carthage vers 220.
Théologie et morale
À la fin du IIe siècle et au début du IIIe, Tertullien inaugure la littérature chrétienne de langue latine et, avec lui, commence une théologie dans cette langue. Lors de son audience générale du , le pape Benoît XVI, dans la série des catéchèses qu'il prononce habituellement lors de ses audiences, fit une communication sur ce Père de l'Église, dont « l'œuvre porta des fruits décisifs, qu'il serait impardonnable de sous-évaluer[5] ». Le pape insista sur les apports théologiques essentiels contenus dans les écrits de Tertullien, notamment ses écrits à caractère apologétique, qui sont les plus célèbres. Ils manifestent, selon lui, deux intentions principales : réfuter les graves accusations des païens à l'égard de la nouvelle religion et répandre le message évangélique par le dialogue avec la culture du temps. Le Souverain pontife souligna, à propos de la Sainte Trinité : « De plus, Tertulien accomplit un pas immense dans le développement du dogme trinitaire : il nous a donné en latin le langage adéquat pour exprimer ce grand mystère, en introduisant les termes « une substance » et « trois personnes ». De même, il a beaucoup développé aussi le langage qui exprime correctement le mystère du Christ, Fils de Dieu et vrai homme[5]. »
L'historien Marcel Simon[6]analyse en ces termes l'importance de Tertullien dans le domaine de la théologie :
« L'apport de Tertullien dans les controverses christologiques et trinitaires est important. Ses conclusions s'apparentent sur plus d'un point à celles que formuleront plus tard les grands conciles orientaux. Il affirme l'unité de Dieu. Elle ne se divise pas mais se distribue en 3 personnes numériquement distinctes, en une trinité qui ne compromet en rien l'unité. Chacune des personnes de cette trinité, étant de la même substance, est Dieu. Le Christ est à la fois Dieu et homme, composé de deux substances unies sans se confondre, dans une seule personne. Mais à côté de ces aspects proprement spéculatifs, certains autres aspects de la pensée de Tertullien reflètent la mentalité juridique des Romains et sa propre formation de juriste. Il insiste sur des notions comme celles de mérite et de satisfaction. La rectitude morale de sa conduite vaut à l'homme des mérites au regard de Dieu. À l'inverse, s'il agit mal, il devient débiteur devant Dieu et lui doit satisfaction. Bien qu'il soit passé à l'hérésie montaniste, Tertullien est vraiment le fondateur de la théologie latine et contribue à lui imprimer, vis-à-vis de la théologie grecque, certains de ses traits originaux. »
Critique de la vanité
Dans De cultu feminarum (De l'ornement des femmes), Tertullien affirme qu'« au premier rang des pompes du siècle figurent toujours nécessairement l'or et l'argent. Mais après tout que sont-ils ? une terre un peu plus brillante parce que, péniblement arrachée aux mines par des mains esclaves, condamnées à ce châtiment, elle a été trempée de sueurs et de larmes. » Il qualifie en conséquence de crime « d'un côté, l'or, l'argent, les pierreries, les étoffes précieuses ; de l'autre, les soins immodérés prodigués à la chevelure, à la peau, et à toutes les parties du corps qui attirent les regards.»
Cette opposition à ce qu'il considère comme absurde lui vaudra une réputation de misogynie, que par ailleurs sa position sur la femme comme agent principal de la chute de l'homme dans le péché ne modifiera pas.
Selon Marie Turcan, Tertullien voyait la femme comme un danger public. D’après lui les femmes qui sont dignes à quelque chose de bon sont les mères de famille, les veuves, les vieilles dames dont l’expérience leur permet de prodiguer des conseils. Elle explique que Tertullien n’avait pas vraiment une estime profonde envers les femmes, ce qui l'a intéressé chez les femmes sont leurs armes.[7]
Selon Marie Turcan, Tertullien décrit la femme comme un être utile et dépravé mais créée par Dieu au même titre que l'homme. Il ne considérait pas la femme comme étant un être inférieur par rapport à l’homme[8].
Expressions typiques

Tertullien montre un sens de la formule que ne dédaignerait peut-être pas un publicitaire moderne. Ainsi à propos de ce qu'il advient de notre machinerie biologique après la mort :
« Après tant d'ignominie, elle retourne à la terre, son premier élément, pour prendre le nom de cadavre ; même ce nom de cadavre ne lui demeurera pas longtemps : elle deviendra un je ne sais quoi qui n'a plus de nom dans aucune langue ».
-- De la résurrection de la chair, IV
Bakounine lui attribue, peut-être à tort[9] le fameux « credo quia absurdum » (« je crois parce que c'est absurde »)[10].
Une phrase de Tertullien est cependant plus radicale encore : « Crucifixus est Dei Filius : non pudet quia pudendum est ; et mortuus est Dei Filius : prorsus credibile est, quia ineptum est ; et sepultus resurrexit : certum est, quia impossibile. » « Le Fils de Dieu a été crucifié : je n’en rougis pas, parce que c’est à rougir. Le Fils de Dieu est mort : il faut le croire, parce que cela révolte ma raison ; enseveli, il a ressuscité : c’est certain, parce que c’est impossible. »
- La chair du Christ, V, 4
Cette phrase est en général entendue comme signifiant que là où la raison semble impuissante, il ne reste plus guère que le recours à la foi pour la pallier.
On peut y voir aussi une référence à un paradoxe énoncé initialement par Aristote[11] : il est facile de faire croire le vraisemblable, mais on ne croit à l'extraordinaire que si on le voit. Si bien qu'un récit invraisemblable qui parvient malgré tout à se répandre aurait probablement une base factuelle. C'est une des rares incursions d'Aristote dans le domaine de la probabilité des causes.
Critiques
Nicolas Malebranche (1638-1715), dans un passage fameux de son livre De la recherche de la vérité, critique chez Tertullien les excès de l'imagination. Il lui accorde ainsi « plus de mémoire que de jugement, plus de pénétration et d'étendue d'imagination, que de pénétration et d'étendue d'esprit » (De la Recherche de la vérité, livre second, partie 3, chap. III). Malebranche, pourtant plutôt admiratif de l'Apologétique de Tertullien et de sa Prescription, voit tout particulièrement dans l'ouvrage Du Manteau, l'expression de ce mauvais tour qu'ont les esprits en proie à une imagination déréglée.
Citation sur Tertullien
« Nous ignorons les conditions de sa conversion. Elle dut être provoquée, comme tous les actes de sa vie, par sa logique passionnée. Dès qu'il voyait une vérité, il s'y livrait corps et âme, sans ménagement, sans compromission. C'était un extrémiste et un minoritaire. Il n'aimait pas les doctrines triomphantes qui pactisent avec le siècle. Son esprit se complaisait dans l'absolu, son tempérament dans la lutte. Avec cela, pamphlétaire admirable, armé pour la polémique comme pas un et s'y donnant tout entier. Un Berbère converti, mais qui, sous le placage chrétien, gardait toutes les passions, toute l'intransigeance, toute l'indiscipline du Berbère. »
— Charles-André Julien, Histoire de l'Afrique du Nord (1951), Payot, 2001, p.226. Màj édition 1994, 880 p. (ISBN 978-2-2288-8789-2).
Écrits

Tertullien[12] fut, en Afrique du Nord, le premier grand théologien de langue latine[13]'[14].
Tertullien s'adresse ainsi à sa femme :
- Deux en une seule chair
« Quel merveilleux joug pour deux chrétiens qu'une même espérance, une même loi, un même service ! Ils sont tous deux frères, tous deux compagnons d'esclavages. Rien ne les divise dans la chair ou l'esprit. Ils sont, en vérité, deux en une seule chair, et là où est une seule chair est aussi un seul esprit. Ensemble ils prient, ensemble se mettent à genoux, ensemble jeûnent. Ils s'instruisent l'un l'autre, s'exhortent l'un l'autre, se soutiennent l'un l'autre. Dans l'Église de Dieu, ils vont côte à côte, partageant le repas de Dieu, affrontant d'un même cœur les épreuves, les persécutions, ensemble se réconfortant. De l'un à l'autre, point de secret, point de faux-fuyant, point de chagrin. En toute liberté, ils visitent les malades, nourrissent les affamés. Ils font l'aumône sans anxiété, accomplissent leurs devoirs quotidiens sans entraves ; ils ne se signent point à la dérobée, ne rendent point grâces en tremblant, ne demandent point de bénédiction en silence. Chez eux retentissent hymnes et psaumes : c'est à qui au Seigneur chantera les plus belles louanges. Le Christ se complaît à les regarder, à les entendre, et leur envoie sa paix. Là où deux sont assemblés, il est (Mt 18, 20). »
— À sa femme 9, trad. France Quéré : Le mariage dans l'Église ancienne, coll. Ichtus 13, Le Centurion / Grasset, Paris, 1969, p. 282-283.
Commentaire selon saint Marc (Mc 7, 24-30) :
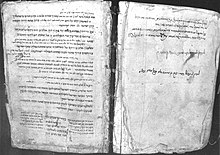
- Le pain qui est nécessaire
« Avec quel art la sagesse divine a disposé l'ordre de la prière : après les choses du ciel, c'est-à-dire le nom de Dieu, la volonté de Dieu et le règne de Dieu, elle a réservé une place dans les demandes aux nécessités de la terre ! En effet, le Seigneur avait encore donné cette consigne : Cherchez d'abord le Royaume, et tout cela vous sera donné par surcroît (Mt 6, 33).
Cependant, quand nous disons : Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour (cf. Mt 6, 11), comprenons-le de préférence au sens spirituel. Car le Christ est notre pain, le Christ est vie, et le pain est vie – « Je suis, a-t-il dit, le pain de vie » (Jn 6, 35). En demandant le pain de chaque jour, nous sollicitons donc de rester toujours dans le Christ et de ne pas nous trouver séparés de son corps.
Le pain est la seule chose qui soit nécessaire aux fidèles ; le reste, ce sont les païens qui s'en mettent en quête (cf. Mt 6, 32). C'est bien ce dont le Seigneur veut nous persuader par des exemples, quand il dit : « Un père prend-il le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens ? » (Mc 7, 27 ; Mt 15, 26).Cependant, puisque le Seigneur, dans son attention aux nécessités humaines, ne s'est pas contenté de transmettre la règle de la prière, mais a dit ensuite : « Demandez, et vous recevrez » (Jn 16, 24), et que chacun a des choses à demander en fonction des circonstances, on a le droit, quand on a prononcé d'abord la prière conforme à la loi et à l'usage, qui sert de fondations aux requêtes qui s'y ajoutent, de poser par-dessus d'autres demandes. »
— Tertullien. La Prière, 6.10, trad. M. Poirier, Prier en Afrique chrétienne, Paris, Migne, 2016, Les Pères dans la foi 104, p. 29-30, 33.
Méditations
Tertullien fut en Afrique du Nord le premier grand théologien de langue latine.

Commentaire selon saint Luc (Lc 6, 1-5) :
- Le sabbat des œuvres humaines
« Les pharisiens se trompaient à propos de la loi du sabbat en ne remarquant pas qu'elle édictait sous condition le repos des activités, en spécifiant une catégorie déterminée. Car lorsque Dieu dit du jour du sabbat : « Toute œuvre tienne tu ne feras en lui » (Ex 20, 10), en disant « tienne », il a précisé qu'il s'agissait d'une œuvre humaine que chacun exécute dans son métier ou son activité, et non d'une œuvre divine. Une œuvre de salut et de préservation n'appartient pas en propre à l'homme, mais à Dieu comme il est dit encore dans la Loi : « Toute œuvre, tu ne feras en lui sauf celle qui se fera pour toute vie » (Ex 12, 16), c'est-à-dire à cause d'une vie à sauver. Car l'œuvre de Dieu peut être accomplie même par le moyen d'un homme en vue de sauver une vie, elle n'en est pas moins accomplie par Dieu : ce qu'était destiné à faire le Christ homme, parce qu'il était aussi Dieu.
Il était dit le « maître du sabbat » parce qu'il défendait le sabbat comme sa propriété. Et même s'il l'avait détruit, c'eût été légitime puisqu'il en est le maître, plus encore celui qui l'a institué. Mais, en sa qualité de maître, il ne l'a absolument pas détruit. »
— Tertullien. Contre Marcion, IV, 12, 9-12, trad. R. Braun, Paris, Cerf, coll. « Sources Chrétiennes » 456, 2001, p. 161-163[15].
Bibliographie
Œuvres
- Ad martyras (197 ou 202-203)[16]
- Apologétique = Apologeticum (fin 197), Les Belles Lettres, 2002, 234 p. Trad. Frédéric Chapot : Premiers écrits chrétiens, Gallimard, coll. "La Pléiade", 2016, p. 829-918.
- Aux nations = Ad nationes (197), trad. M. de Genoude (1852) [1] [2]
- À ma femme = Ad uxorem (199), Cerf, 1980
- À Scapula, proconsul d'Afrique (212)
- Contre Hermogène, contre l'éternité de la matière = Adversus Hermogenem (205-206), Cerf, coll. "Sources chrétiennes", 1999, 473 p. Trad. E.-A. de Genoude [3]
- Contre Marcion = Adversus Marcionem (207), Cerf, 1990-1994, 3 vol. Trad. E.-A. de Genoude (1852) [4]
- Contre les juifs = Adversus judaeos (197). Trad. E.-A. de Genoude (1852) [5]
- Contre les Valentiniens (en) = Adversus valentinianos (207-212). Trad. A.-E. de Genoude [6]
- Contre les spectacles
- Contre Praxéas ou sur la Trinité = Adversus Praxeam (213). Trad. A.-E. de Genoude [7]
- De la chair du Christ (en) (entre 253 et 259), Cerf, coll. "Sources chrétiennes", 1975, 2 vol.
- De la couronne du soldat = De corona militis (211-212). Trad. E.-A. de Genoude [8]
- De la fuite pendant la persécution (vers 212). Trad. A.-E. Genoude [9]
- De la monogamie (217), trad. E.-A. de Genoude [10]
- De la patience = De patientia (200-203), Arléa, 2001
- De la pénitence = De paenitentia (entre 199 et 203). Trad. P. de Labriolle (1906) [11]
- De la prescription des hérétiques = De praescriptione haereticorum (vers 200). Trad. A.-E. de Genoude (1852) [12]
- De la pudicité = De pudicitia (entre 219 et 221), Cerf, 1993. Trad. P. de Labriolle (1906) [13]
- De la résurrection de la chair. Trad. Madeleine Moreau : La résurrection des morts, Desclée de Brouwer, 1980. Trad. E.-A. de Genoude (1852) [14]
- De la toilette des femmes = De cultu feminarum (197-201), Cerf, coll. "Sources chrétiennes", 1976, 194 p.
- De l'âme = De anima (208-211). Trad. A.-E. de Genoude (1852) [15]
- De l'idolâtrie = De idolatria. Trad. A.-E. de Genoude [16]
- De l'oraison dominicale. Trad. A.-E. Genoude [17]
- De l'ornement des femmes, trad. M. Charpentier (1844) [18]
- Des spectacles (en) = De Spectaculis (vers 198), Cerf, coll. "Sources chrétiennes", 1986, 365 p. La première société du spectacle, trad. A.-E. de Genoude révisée par Nicolas de Montpellier, Fayard/Mille et une nuits, 2015, 96 p.
- Du baptême. De baptismo (200-206) : Le baptême. Le premier traité chrétien, Cerf, coll. "Sources chrétiennes", 2008, 112 p. Trad. A.-E. de Genoude [19]
- Du jeûne, contre les psychiques = De ieiunio adversus psychicos. Trad. A.-E. de Genoude [20]
- Du manteau = De pallio (vers 210), Cerf, 2007. Trad. A.-E. de Genoude (1852) [21]
- Du sommeil, des songes, de la mort. Extraits du traité De l'âme, par Pierre Klossowski (1948), Le Promeneur, 1999, 65 p.
- Du voile des vierges = De virginibus velandis (avant 207), Cerf, 1997. Trad. A.-E. de Genoude (1852) [22]
- Exhortation à la chasteté = De exhortatione castitatis, Cerf, coll. "Sources chrétiennes", 1985, 214 p. Trad. A.-E. de Genoude [23]
- Le scorpiâque, antidote contre la morsure des scorpions. Trad. A.-E. de Genoude [24]
- Témoignage de l'âme = De testimonio animae. Trad. A.-E. de Genoude (1852) [25]
Pseudo-Tertullien
- Pseudo-Tertullien (en), Contre tous les hérétiques (Adversus omnes haereses), traduction M. de Genoude, 1852. [26]
Études
- Adhémar d'Alès, La théologie de Tertullien, Paris, Beauchesne, 1905.
- Jérôme Alexandre, Tertullien théologien, Parole et silence, Collection Collège des Bernardins, Saint-Maur, 2012.
- René Braun, Deus christianorum. Recherches sur le vocabulaire doctrinal de Tertullien, Paris, Études augustiniennes, 1977 (deuxième édition; première édition 1962).
- Steinmann Jean: Tertullien. Editions du Chalet, 1967
- Gosta Claesson, Index Tertullianeus, Paris, Études augustiniennes, 1975 (3 volumes).
- Jean-Claude Fredouille, Tertullien et la conversion de la culture antique, 2e éd., Institut d’études augustiniennes, Paris, 2012.
- Georges d'Amboise, Tertullianus redivivus - 3 volumes (1646- 1650)
- Joseph Moingt, Théologie trinitaire de Tertullien, Paris, Aubier, 1966, 3 tomes.
- Vincent Serralda et André Huard, Le Berbère... Lumière de l'Occident, éd. Nouvelles éditions latines, Paris, 1990 (ISBN 9782723302395).
- Maurice Sachot, L'Invention du Christ. Genèse d'une religion, Éditions Odile Jacob, « Le champ médiologique », 1998.
- Maurice Sachot, Quand le christianisme a changé le monde : La subversion chrétienne du monde antique, Éditions Odile Jacob, 2007.
- Philippe Henne, Tertullien l'Africain, Les éditions du Cerf, , 322 p. (ISBN 978-2-2040-9379-8).
- Stéphanie E. Binder, Tertullien et moi, Les éditions du Cerf, (ISBN 978-2-2041-3997-7).
Notes et références
- Charles-André Julien, Histoire de l'Afrique du Nord (1951), Payot, 2001, p. 226.
- André Berthier, L'Algérie et son passé (1951), Picard, 1951, p. 25.
- À ma femme, II, 9.
- « St Jérôme (…) fait de lui un prêtre. Ce qui n'a pas lieu d'être » selon Maurice Sachot, qui l'envisage plutôt « didascale » chrétien (Quand le christianisme a changé le monde, Odile Jacob, 2007, p. 111).
- Osservatore Romano du 31 mai 2007
- Marcel Simon, La Civilisation de l'Antiquité et le Christianisme, Paris, 1972.
- Marie Turcan, « Être femme selon Tertullien », Vita Latina, année 1990, p. 21
- Marie Turcan, « être femme selon Tertullien », Vita Latina, , p. 17 (lire en ligne)
- Voir le texte sur le site tertullian.org
- "Il est évident que quiconque en a besoin pour son bonheur, pour sa vie, doit renoncer à sa raison, et, retournant s'il le peut à la foi naïve, aveugle, stupide, répéter, avec Tertullien et avec tous les croyants sincères, ces paroles qui résument la quintessence même de la théologie : « Je crois parce que c'est absurde »" (Dieu et l'État)
- Rhétorique II, 23, 1400 a 6-9.
- Le premier Père de l'Église d'Occident.
- Quand l’Afrique du Nord était chrétienne.
- Tertullien était un apologiste, théologien et moraliste des débuts chrétiens de Carthage, en Afrique du Nord.
- René Braun (1920-2010). Persée (portail).
- Quintus Septimus Florens Tertullianus, (trad. du latin par Florimond de Raemond ), Aux martyrs [« Ad martyras »], Lyon, Benoist Rigaud, (1re éd. c 200), 14 p. (lire en ligne).
Liens externes
- Ressources relatives aux beaux-arts :
- Ressource relative à la religion :
- Ressource relative au spectacle :
- Ressource relative à la recherche :
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
- Britannica
- Brockhaus
- Den Store Danske Encyklopædi
- Deutsche Biographie
- Dizionario di Storia
- Enciclopedia italiana
- Enciclopedia De Agostini
- Gran Enciclopèdia Catalana
- Hrvatska Enciklopedija
- Nationalencyklopedin
- Proleksis enciklopedija
- Store norske leksikon
- Treccani
- Universalis
- Visuotinė lietuvių enciklopedija
- Œuvres en traductions françaises
- Traductions E.-M. Genoude
- Œuvres de Tertullien: textes avec concordances et liste de fréquence
- Sur le site "patristique.org"
- Sur le site "Sources chrétiennes"
- Écrivain romain du IIe siècle
- Écrivain romain du IIIe siècle
- Écrivain latin classique
- Théologien du IIe siècle
- Théologien du IIIe siècle
- Théologien chrétien
- Paléochristianisme
- Apologiste chrétien
- Père de l'Église
- Histoire du christianisme en Afrique
- Personnalité du christianisme et de la non-violence
- Personnalité berbère
- Naissance à Carthage
- Décès à Carthage