« Affaire Dreyfus » : différence entre les versions
bandeau "en cours" |
m →Contexte social : typo |
||
| (335 versions intermédiaires par 19 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image:degradation alfred dreyfus.jpg|thumb|300px|right|La dégradation d'Alfred Dreyfus]] |
|||
{{en cours}} |
|||
[[Image:degradation_alfred_dreyfus.jpg|thumb|250px|right|La dégradation d'Alfred Dreyfus]] |
|||
'''L'affaire Dreyfus''', appelée souvent '''l'Affaire''' par les contemporains, est l'une des crises les plus graves de la [[Troisième République|III{{e}} République]] [[France|française]] tant par ses répercussions politiques que par le trouble moral qu'elle entraîna dans le pays et l'armée française au moment où le conflit latent de la France avec l'[[Empire allemand]] se réveillait. C'est à l'origine une simple affaire d'[[espionnage]], devenue [[politique]] par ricochet, sur fond de polémique judiciaire et militaire, puis rapidement [[antisémite]], [[nationaliste]] et [[Religion|religieuse]]. Elle est considérée par l'[[historiographie]] comme l'un des épisodes fondateurs par ses conséquences de la politique française contemporaine. Elle porte le nom de son principal protagoniste, le [[capitaine]] [[Alfred Dreyfus]], [[condamnation|condamné]] sans preuves tangibles, puis [[Grâce (droit)|gracié]], [[relaxe|relaxé]] et finalement réhabilité. Alfred Dreyfus servit volontairement pendant la 1ere Guerre Mondiale comme lieutenant colonel dans l'artillerie et prit sa retraite définitive après l'Armistice. |
|||
À la fin du {{XIXe siècle}}, le point de départ de '''L'affaire Dreyfus''', est une erreur judiciaire sur fond d’espionnage, dont la victime est le capitaine '''[[Alfred Dreyfus]]''' (1859-1935), juif et alsacien d'origine. Pendant douze ans, de [[1894]] à [[1906]], '''''l’Affaire''''' a bouleversé la société française. <br> |
|||
== Les origines de l'Affaire : une banale histoire d'espionnage militaire == |
|||
La révélation de ce scandale, dans ''[[J'accuse]]'', un article d’[[Émile Zola]] en [[1898]], provoque une succession de crises politiques et sociales uniques en [[France]]. À son paroxysme en [[1899]], elle révèle les clivages de la France de la [[Troisième République]]. Elle divise profondément et durablement les Français en deux camps opposés, dreyfusards et anti-dreyfusards. Cette affaire est le symbole moderne et universel de l'iniquité au nom de la [[raison d'État]]. Elle exacerbera les pires sentiments humains au travers de très violentes polémiques nationalistes et [[antisémitisme|antisémites]] diffusées par une [[Presse écrite|presse]] puissante. |
|||
==Résumé de l'affaire Dreyfus== |
|||
En septembre [[1894]], un agent français d'origine alsacienne, Marie Bastian, employée comme femme de ménage à l'ambassade d'Allemagne et indicateur du service du contre-espionnage français, récupère dans la corbeille à papier de l'attaché militaire allemand Max von Schwarzkoppen une lettre (généralement désignée durant l'affaire sous le nom de « bordereau ») d'un auteur se présentant comme un officier de renseignement français. Cette lettre non signée annonçait à l'attaché militaire allemand l'envoi en pièces jointes de copies de documents relativement importants sur les dispositifs de défense français, notamment en matière d'artillerie ( ''"une note sur le frein hydraulique du 120 et la manière dont s'est conduite cette pièce"''). D'autres documents sont également promis au terme dudit bordereau. |
|||
[[Image:Jeu de loie.jpg|thumb|300px|left|Jeu de l'oie de l'affaire Dreyfus]] |
|||
Le bordereau est porté à la connaissance du [[ministre de la Guerre]], le [[général]] Auguste Mercier, qui demande une enquête administrative puis judiciaire . Elle sera confiée au service de contre-espionnage de l'armée, déguisé sous le nom de « [[Section de Statistique]] », qui est dirigé par un autre alsacien : le lieutenant colonel Jean Sandherr. C'est une équipe relativement étroite qui opère de façon quasiment indépendante du 2{{e}} Bureau de l'État Major qui, lui, est chargé du renseignement militaire à l'étranger. Cette enquête se déclenche contre l'avis du ministre des Affaires Etrangères qui craint de provoquer un incident diplomatique sérieux avec l'Italie et l'Allemagne. Il est établi que le ministre de la Guerre, le général Auguste Mercier, avait en partie déclenché cette affaire d'espionnage à l'État Major pour répondre à une campagne de presse et au parlement qui réclamaient sa révocation pour incompétence. |
|||
{{AffaireDreyfus}} |
|||
<ref>A partir de : Jean-Denis Bredin, ''l'Affaire'' et Pierre Birnbaum, ''L'Affaire Dreyfus, la République en péril''.</ref>À la fin de l'année [[1894]], injustement accusé de trahison pour intelligence avec l'ennemi et transmission de documents secrets compromettant la défense nationale, le capitaine Dreyfus, polytechnicien, juif et alsacien, est condamné au [[bagne]] à vie et déporté sur l'[[Île du Diable (Guyane)|île du Diable]].<br> |
|||
En partie animé par un antisémitisme doctrinaire, le haut commandement de l'armée française a employé des moyens illégaux afin d'emporter la décision du Conseil de guerre. <br>Quasiment oublié sauf des siens, Dreyfus purge sa peine dans des conditions inhumaines pendant quatre ans. Sans se décourager, sa famille, et notamment son frère [[Mathieu Dreyfus|Mathieu]], mettent tout en œuvre pour le faire libérer, certains de son innocence.<br> |
|||
Petit à petit, la vérité est révélée. Le chef du contre-espionnage, le colonel [[Marie-Georges Picquart|Picquart]], découvre le nom du vrai traître en [[1896]] : [[Ferdinand Walsin Esterhazy|Esterházy]]. Sa hiérarchie l’oblige à se taire. Ce qu’il refuse de faire, au risque de voir sa carrière compromise. L’information est donc rendue publique.<br> |
|||
Le commandant Esterházy est traduit en Conseil de guerre au tout début de l’année [[1898]]. Mais protégé par l'[[État-major]], qui ne veut pas perdre la face, le vrai coupable est acquitté sous les ovations de la foule.<br> |
|||
C'est un énorme scandale. <br> |
|||
Deux jours après, devant l'iniquité insupportable de cette décision de justice militaire, Émile Zola publie ''[[J'accuse]]'' dans le journal l'''[[Aurore]]'' en janvier [[1898]] et dévoile tous les traits sordides de ce qui devient désormais '''''l'Affaire'''''. Il accuse nommément et publiquement tous les protagonistes civils et militaires. C'est le début de la crise politique et sociale, qui se prolongera jusqu’à la fin du siècle. Des émeutes [[antisémitisme|antisémites]] éclatent dans plus de vingt villes françaises. On dénombre plusieurs morts à [[Alger]].<br> |
|||
La [[république]] est ébranlée, certains la voient même en péril. Il faut en finir avec l’affaire Dreyfus pour ramener le calme.<br /> |
|||
Malgré les menées de l'armée pour étouffer cette affaire, le premier jugement condamnant Dreyfus est cassé par la [[Cour de cassation (France)|Cour de cassation]] au terme d'une enquête minutieuse, et un nouveau Conseil de guerre a lieu à [[Rennes]] en [[1899]]. <br> |
|||
Mais contre toute attente, Dreyfus est condamné une nouvelle fois, à dix ans de travaux forcés, avec, toutefois, circonstances atténuantes. Epuisé par sa déportation de quatre longues années, Dreyfus n'a d'autre ressource que d'accepter la grâce présidentielle.<br> |
|||
Il faudra que le capitaine attende [[1906]], pour que son innocence soit officiellement reconnue au travers d'un arrêt sans renvoi de la Cour de cassation, décision inédite et unique dans l'histoire du [[droit]] français.<br> |
|||
Réhabilité, le capitaine Dreyfus sera réintégré dans l'armée au grade de [[lieutenant-colonel]] et participera à la [[Première Guerre mondiale]]. Il décède en [[1935]]. <br> |
|||
Les conséquences de cette affaire sont innombrables, encore perceptibles plus de cent ans après les faits, touchant tous les aspects sociaux en France : politique, armée, religion, société, droit, media, diplomatie et intellectuels. |
|||
{{loupe|Chronologie de l'affaire Dreyfus}} |
|||
===Confusions possibles=== |
|||
Après enquête sur le personnel du ministère de la Guerre et du fait de similitudes d'écriture, les soupçons se portent sur un officier-stagiaire à l'État Major, le capitaine Alfred Dreyfus, [[École polytechnique (France)|polytechnicien]] et [[Artillerie|artilleur]]. |
|||
Il ne faut pas confondre dreyfusards, dreyfusiens et dreyfusistes. <br> |
|||
*Les '''dreyfusards''' furent les premiers défenseurs de Dreyfus, ceux qui soutinrent le capitaine depuis le début. |
|||
*Le terme '''dreyfusiste''' désigne ceux qui réfléchissaient au-delà de l'affaire et voyaient en celle-ci une nécessité de remettre en cause la société et la politique et par extension le fonctionnement de la république (certains dreyfusards furent parfois aussi dreyfusistes par la suite). |
|||
*Quant aux '''dreyfusiens''', ils n'apparurent qu'en décembre [[1898]] lorsque l'affrontement entre dreyfusards et antidreyfusards devint vraiment aigu et que l'affaire compromettait la stabilité de la république. Ces derniers, même si certains avaient des sympathies pour Alfred Dreyfus, voulaient liquider l'affaire en calmant le jeu, dans le but de sauver le régime républicain parlementaire alors en place. Ils furent à l'origine d'une certaine conciliation entre les deux camps, grâce à un effort de médiation en prônant l'apaisement. Leur texte fondateur fut « l'appel à l'union », paru le [[23 janvier]] 1899 dans le journal ''[[Le Temps (quotidien français)| Le Temps]]''. Ils soutinrent généralement la politique de [[Waldeck-Rousseau]] et prônèrent une [[laïcisation]] de la société. |
|||
==Contextes de l'affaire Dreyfus== |
|||
Dreyfus était un coupable idéal : il est [[Alsace|alsacien]] d'origine [[juif|juive]], et il avait une connaissance parfaite de la langue, de la culture et du territoire allemands. Il passait par ailleurs pour peu sympathique et assez prétentieux vis-à-vis de ses camarades de travail et de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui facilitait les accusations. Enfin il s'était rendu à [[Mulhouse]], désormais en Allemagne, en décembre 1893 pour les obsèques de son père qui était le gérant de l'usine de textiles familiale. |
|||
===Contexte politique=== |
|||
[[Image:Allégorie républicaine.jpg|thumb|left|300px|La '''[[Troisième République|République]]''' victorieuse, Lithographie vers 1880]] |
|||
En [[1894]], la [[Troisième République|{{IIIe}} République]] est vieille de vingt-trois ans. |
|||
Le régime politique de la [[France]] va vers la stabilité après trois grandes crises : le [[boulangisme]] en [[1889]], le [[scandale de Panamá]] en [[1892]], et la menace [[Anarchisme|anarchiste]], réduite par les « lois scélérates » de juillet [[1894]]. |
|||
Le président [[Sadi Carnot]], assassiné le [[24 juin]] [[1894]] est remplacé par un modéré, [[Casimir-Perier]] qui incarnera un certain retour au calme. |
|||
Les gouvernements appelés « opportunistes » font des choix politiques orientés vers un protectionnisme économique, presque indifférents à la question sociale, tournés radicalement vers une alliance russe sensée briser l'isolement du pays, œuvre du général [[Raoul Le Mouton de Boisdeffre|le Mouton de Boisdeffre]].<br> |
|||
Les élections de [[1893]] amènent un profond renouvellement du personnel politique, usé par les crises. |
|||
Majoritairement républicaine et modérée alliée aux monarchistes, qui sont devenus une force parlementaire, la Chambre écarte les radicaux qui, dès lors, cherchent une alliance avec les socialistes. |
|||
Ainsi la République en tant que régime parlementaire était désormais fondée. |
|||
Qu'ils soient de droite ou de gauche, les républicains existent bien et la droite même nationaliste, ne remet pas en cause le cadre institutionnel. |
|||
La stabilité du régime est assurée par une forte croissance économique développant une société bourgeoise emprunte de positivisme, appuyée par de considérables progrès scientifiques. |
|||
L'empire colonial français, en voie de finalisation, est vu comme une grande réussite, contribuant largement à l'embellie économique de cette fin de siècle. L'Empire doit être prêt pour la consécration : l'[[exposition universelle de 1900]].<ref>Miquel, ''L'affaire Dreyfus'', Que sais-je ?, pp. 7 et s.</ref> {{,}} <ref>Duclert, ''L'affaire Dreyfus'', p. 4-5</ref> |
|||
=== Contexte militaire === |
|||
On sait aujourd'hui qu'Alfred Dreyfus était innocent. L'accusation était fondée sur un dossier officiel peu convaincant et sur la communication en violation des droits de la défense d'un « dossier secret » composé de documents objectivement peu probants mais sur lesquels le ministre de la Guerre avait mis tout son poids politique et militaire. |
|||
[[Image:Général de Boisdeffre.jpg|thumb|200px|Le général Raoul le Mouton '''de Boisdeffre''' artisan de l'alliance militaire avec la Russie]] |
|||
L'affaire Dreyfus se place dans le cadre de l'annexion de l'Alsace et de la Moselle, déchirure qui va alimenter tous les nationalismes les plus extrêmes. |
|||
La [[guerre de 1870|défaite traumatisante de 1870]] semble loin, mais l'esprit revanchard est toujours présent. |
|||
De nombreux acteurs de l'affaire Dreyfus sont d'ailleurs des Alsaciens<ref>Dreyfus est de [[Mulhouse]], comme Sandherr et Scheurer-Kestner, Picquart est [[Strasbourg|strasbourgeois]], Zurlinden est [[Colmar|colmarien]]</ref>. |
|||
Les militaires exigent des moyens considérables pour préparer le prochain conflit, et c'est dans cet esprit que l'[[alliance franco-russe]] contre nature<ref>Auguste Scheurer-Kestner dans une allocution au Sénat.</ref> du [[27 août]] [[1892]] est signée, sur la base d'une convention militaire. |
|||
L'armée s'est relevée de la défaite, mais elle est encore largement constituée de ses anciens cadres socialement aristocrates et politiquement monarchistes. |
|||
Le culte du drapeau et le mépris de la République parlementaire sont les deux rouages de la pensée militaire à cette époque<ref>Duclert, ''L'affaire Dreyfus'', p. 5</ref>. |
|||
La France a beau célébrer son armée avec la régularité d'un métronome, l'armée ignore la nation.<br> |
|||
Depuis une dizaine d'années, l'armée connaît une mutation importante, dans le double but de la démocratiser et de la moderniser. |
|||
Des [[Polytechnique|polytechniciens]] concurrencent efficacement les officiers issus de la voie royale de [[Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan|Saint-Cyr]], ce qui amènera des dissensions, amertumes et jalousies parmi ceux des sous-officiers qui s'attendaient à des promotions au choix. |
|||
La période est aussi marquée par une course aux armements qui touche principalement l'artillerie, avec des perfectionnements concernant l'artillerie lourde (canons de 120 et 150), mais aussi et surtout, la mise au point de l'ultra secret [[Canon de 75 Modèle 1897|canon de 75mm]]<ref>Sur la mise au point du canon de 75 : Doise, ''Un secret bien gardé'', pp. 9 et s.</ref>.<br> |
|||
Il faut aussi signaler ici le fonctionnement du contre-espionnage militaire, alias « Section de statistiques ». |
|||
Au fur et à mesure des campagnes judiciaires puis politico-médiatiques engagées par la famille Dreyfus, ce dossier secret sera complété par de faux documents, confectionnés par le [[lieutenant-colonel]] [[Hubert-Joseph Henry]], adjoint à la "Section de Statistique", dont le dévouement aveugle à la hiérarchie va jusqu'au zèle excessif. |
|||
Le Renseignement, activité organisée et outil de guerre secrète, est une nouveauté de la fin du {{XIXe}} siècle. |
|||
La Section de statistiques est créée en 1871 mais ne compte alors qu'une poignée d'officiers et de civils. |
|||
Son chef en 1894 est le lieutenant-colonel Jean Sandherr, saint-cyrien, alsacien de Mulhouse et très antisémite. |
|||
Sa mission est simple : récupérer des renseignements sur l'ennemi potentiel de la France, et l'intoxiquer avec de fausses informations. |
|||
La Section de statistiques est épaulée par les « Affaires réservées » du quai d'Orsay, animée par un jeune diplomate, [[Maurice Paléologue]]. |
|||
La course aux armements va amener une ambiance d'espionnite aiguë dans le contre-espionnage français. |
|||
Aussi, l'une des tâches de la section consiste à espionner l'ambassade d'Allemagne, rue de Lille, à Paris afin de déjouer toute tentative de transmission d'informations importantes à l'Allemagne. |
|||
D'autant que plusieurs affaires d'espionnage avaient déjà défrayé la chronique d'une presse friande de ces histoires mêlant les hauts sentiments au sordide. |
|||
Ainsi en [[1890]], l'archiviste Boutonnet a-t-il été condamné pour avoir vendu les plans de l'obus à la mélinite. |
|||
L'attaché militaire allemand à Paris est en [[1894]] le comte Maximilien von Schwartzkoppen, qui développe une politique d'infiltration qui semble avoir été efficace.<br> |
|||
Depuis le début 1894, la section enquête sur un trafic de plans directeurs concernant Nice et la Meuse, mené par un agent que les Allemands et les Italiens surnomment Dubois. |
|||
C'est ce qui l'amène aux origines de l'affaire Dreyfus<ref>Doise, ''Un secret bien gardé'', p. 25</ref>. |
|||
===Contexte social=== |
|||
Après plusieurs analyses [[graphologie|graphologiques]], Dreyfus est considéré comme « l'auteur probable » du bordereau ayant maquillé son écriture. Ces analyses ont été supervisées par le [[commandant]] [[Armand du Paty de Clam]], l'expert de l'état-major chargé de l'enquête, qui ne se prononce pas formellement mais signale plutôt, sous la pression de sa hiérarchie, une forte probabilité. Il s'est appuyé sur d'autres experts militaires et civils dont ceux de la préfecture de police de Paris, les célèbres [[Alphonse Bertillon]] et Teyssonières, qui sont formels dans leurs accusations et le resteront jusqu'à leur mort. |
|||
[[Image:Duel 1895.jpg|thumb|left|200px|Le duel, mode de résolution des affrontements personnels.]] |
|||
[[Image:Caricature antisémite.jpg|thumb|200px|L'Affaire suscita de nombreuses caricatures '''antisémites''']] |
|||
Le contexte social est marqué par la montée du [[nationalisme]] et de l'[[antisémitisme]], une donnée de l'armée, et une composante de la société. |
|||
Cette croissance de l'antisémitisme, très virulente depuis la publication de ''La France juive'' d'[[Édouard Drumont]] en [[1886]] (150 000 exemplaires la première année), va de pair avec une montée du [[cléricalisme]]. |
|||
Les tensions sont fortes dans toutes les couches de la société, attisées par une presse puissante et totalement libre d'écrire et de diffuser n'importe quelle information, fût-elle injurieuse ou diffamatoire. |
|||
Pratiquement sans risques juridiques.<br> |
|||
L'antisémitisme n'épargne pas l'institution militaire qui pratique des discriminations occultes jusque dans les concours, avec la fameuse cote d'amour, notation irrationnelle, dont Dreyfus a fait les frais à l'école d'application de Bourges<ref>Bach, ''L'armée de Dreyfus'', p. 534</ref>. |
|||
Témoin des fortes tensions de cette époque, la vogue du duel, à l'épée ou au pistolet, allant parfois jusqu'à la mort d'un des deux duellistes. |
|||
De brillants officiers juifs, atteints par une série d'articles de presse de ''[[La Libre Parole]]''<ref>''Les juifs dans l'armée''</ref>, accusés de « trahir par naissance », défient leurs rédacteurs. |
|||
Ainsi en est-il du capitaine Cremieu-Foa, juif alsacien et polytechnicien qui se bat sans résultat. |
|||
Mais le capitaine Mayer, autre officier juif, est tué par le marquis de Morès, ami de Drumont, dans un autre duel ; décès qui déclenche une émotion considérable, très au delà des milieux israélites. |
|||
La haine des juifs est désormais publique, irrationnelle, alimentée par un brûlot diabolisant la présence juive en France. |
|||
La présence juive en France ? |
|||
80 000 personnes au plus en [[1895]] (dont 40 000 à Paris), très intégrés, plus 45 000 en [[Algérie]].<br> |
|||
Le lancement de ''La Libre Parole'', dont la diffusion estimée est de 200 000 exemplaires<ref>Miquel, ''La troisième République'', p. 391</ref> en [[1892]] va permettre à Drumont d'élargir encore son audience vers les basses couches de la population, déjà tentées par l'aventure boulangiste. |
|||
L'antisémitisme diffusé par ''La Libre Parole'', mais aussi par ''[[L'Éclair]]'', ''[[Le Petit Journal]]'', ''[[La Patrie]]'', L'Intransigeant, ''[[La Croix]]'', en puisant dans les racines antisémites des milieux catholiques va atteindre des sommets himalayens<ref>Duclert, ''L'affaire Dreyfus'', p. 8</ref>. |
|||
==Origines de l'affaire et le procès de 1894== |
|||
Le préfet de police chargé de l'enquête de personnalité, constate quant à lui, que Dreyfus pourrait avoir le profil d'un agent double du fait de sa vie privée trouble et de ses liens avec l'Allemagne. En effet, selon les rapports de la police, il entretiendrait une maîtresse et aurait eu des dettes de jeux. De plus une partie de sa famille, dont son père et un de ses frères restés en Alsace pour gérer la filature familiale, serait en bons termes avec les autorités allemandes. |
|||
===A l'origine : les faits d'espionnage=== |
|||
[[Image:Alfred-Dreyfus.jpg|thumb|200px|left|Le '''[[Alfred Dreyfus|capitaine Dreyfus]]''' avant l'Affaire]] |
|||
[[Image:Bordereau.jpg|thumb|200px|right|Photographie d'une copie du '''bordereau'''. L'original a disparu.]] |
|||
L'origine de l'affaire Dreyfus n'est pas claire plus d'un siècle après les faits. Il s'agit d'une affaire d'espionnage dont les intentions sont restées obscures jusqu'à nos jours<ref>Espionite aiguë ? Affolement de l'État-major ? Intox du SR français ? Écran de fumée pendant le développement de l'ultra secret canon de 75 ?</ref>. De nombreux historiens parmi les plus éminents expriment plusieurs hypothèses distinctes<ref>hypothèses car les preuves n'existent pas</ref>, mais tous arrivent à une conclusion unique : Dreyfus était innocent du crime de haute trahison.<br> |
|||
====Découverte du bordereau==== |
|||
Le ministre de la Guerre, le général Auguste Mercier, proche des républicains progressistes (opportunistes) au pouvoir, après l'aval du Président du Conseil [[Charles Dupuy]] et du chef de l'État et des armées, le [[Président de la République française|président de la république]] [[Félix Faure]] et après consultation du cabinet ministériel décide donc, malgré la maigreur du dossier d'accusation, d'arrêter Dreyfus et de l'inculper d'intelligence avec l'ennemi devant un [[Conseil de la Guerre|Conseil de Guerre]]. |
|||
Les militaires du SR<ref>SR pour « Service de renseignements », autrement dit, le contre-espionnage</ref> ont affirmé de manière constante |
|||
<ref>Reinach, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75082s ''Histoire de l'affaire Dreyfus'', Tome 1], p. 40-42 </ref> qu'en septembre [[1894]], la « voie ordinaire »<ref>Jargon du SR signifiant : documents récupérés par la femme de ménage de l’ambassade d’Allemagne</ref> avait apporté<ref>Scénario toujours débattu par de nombreux historiens. Voir Bredin, ''l’Affaire, p.66, Doise, ''Histoire militaire de l'affaire Dreyfus'' p.49 et s., Thomas, ''L'affaire sans Dreyfus'', T1 p. 70. La question est de savoir comment ce document est réellement arrivé entre les mains du SR. </ref> au contre-espionnage français une lettre que l’on surnommera par la suite « [[s:Bordereau de l’affaire Dreyfus|le bordereau]]» <ref>page écrite sur un papier léger dit « pelure »</ref>. <br> |
|||
Cette lettre-missive, partiellement déchirée en six grands morceaux<ref>Et non pas en tout petits morceaux. De plus le papier n'était pas froissé. Bredin, ''l'Affaire'', p. 67</ref>, écrite sur du papier pelure, non signée et non datée, était adressée à l'attaché militaire allemand en poste à l’ambassade d’Allemagne, Max von Schwarzkoppen. Il établissait que des documents militaires confidentiels, mais d'importance relative<ref>J Doise, p. 55 et s. La seule information importante du document consiste en une note sur le canon de 120, pièce d'artillerie qui ne représentera que 1,4% du parc d'artillerie moderne français en 1914.</ref>, avaient été transmis à une puissance étrangère.<br> |
|||
====Recherche de l'auteur du bordereau==== |
|||
== Le premier procès == |
|||
Cette prise semble suffisamment importante pour que le chef de la « Section de statistiques »<ref>Sur la Section de statistiques, lire Bredin, p. 49-50, Doise p.42-43 et Thomas p. 60-70</ref>, le mulhousien<ref>Thomas, ''l’affaire sans Dreyfus'' p. 67. Alfred Dreyfus était aussi originaire de Mulhouse</ref> Jean Sandherr, en informe le [[ministre de la Guerre]], le [[général]] [[Auguste Mercier]]. <br> |
|||
Le ministre, violemment attaqué dans la presse pour son action jugée faible, semble vouloir tirer parti de cette affaire pour se requinquer<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p.65 et Reinach, et Reinach,[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75082s ''Histoire de l'affaire Dreyfus'', Tome 1], p. 39</ref>. Il diligente immédiatement deux enquêtes successives, l’une administrative et l’autre judiciaire. <br> |
|||
Pour trouver le coupable, le raisonnement est simple sinon simpliste, voire grossier<ref>Birnbaum, ''L'affaire Dreyfus'', p.40</ref>: le cercle de recherche est restreint à un coupable forcément en poste ou ancien collaborateur à l’État-major, artilleur<ref>nota : sur les indication du capitaine Matton, seul artilleur de la Section de statistiques. Trois des documents transmis concernaient l'artillerie de près ou de loin.</ref>, et officier stagiaire <ref>nota : les documents provenaient des 1{{er}}, 2{{e}}, 3{{e}} et 4{{e}} bureaux, un stagiaire semblant seul à même de proposer une telle variété de documents, car ils passaient de bureau en bureau pour parfaire leur formation. </ref>{{,}}<ref> Doise, ''Histoire militaire''… et Bredin, ''l’Affaire'', p.68</ref> .<br> |
|||
Le coupable idéal est tout trouvé : le [[Capitaine (militaire) |capitaine]] [[Alfred Dreyfus]], [[École polytechnique (France)|polytechnicien]] et [[Artillerie|artilleur]], de confession israélite et alsacien d’origine. D'autant plus qu'au travers de Dreyfus, on s'en prend à la république<ref>Birnbaum, ''l'Affaire Dreyfus...'', p. 48</ref>. Sans que ce soit une exception, puisqu’on privilégiait les officiers de l’est de la France pour leur double connaissance de la langue allemande et de la culture germanique, on insistera plus sur les origines alsaciennes de Dreyfus que sur son appartenance religieuse au tout début de l’affaire <ref>Burns, ''Une famille….'', p.139</ref>. Mais l’[[antisémitisme]], qui n’épargne pas les bureaux d’État-major<ref>Sandherr était un antisémite forcené. v. Paléologue, ''l'Affaire Dreyfus et le quai d'Orsay''</ref>, deviendra rapidement le centre de l’affaire d’instruction, remplissant les vides d’une enquête préliminaire incroyablement sommaire. D'autant que Dreyfus était à ce moment là le seul officier juif à l'État-major.<br> |
|||
De fait, la légende<ref>Duclert, ''Alfred Dreyfus'', p. 115 et s.</ref> du caractère froid et renfermé, voire hautain de l’homme et sa « curiosité » va fortement jouer contre lui et rendront plausibles toutes les accusations en transformant les actes les plus ordinaires de la vie courante dans un ministère, en faits avérés d’espionnage.<br> |
|||
Dreyfus est arrêté le [[15 octobre]] [[1894]] et incarcéré à la [[Prisons de Paris|prison du Cherche-midi]] à [[Paris]]. Le [[31 octobre]], son arrestation est rapportée dans la presse. Le 2 novembre, les poursuites judiciaires sont entamées à son encontre. Lors de l'instruction, l'accusation prétendra avoir obtenu des aveux de Dreyfus, ce qui clôturerait définitivement le dossier d'autant que les allemands refusent de le reconnaître comme l'un de leurs agents. |
|||
C’est bien entendu ce début d’instruction, partial et partiel, cette vision restrictive du champ du possible, qui va amener la bévue puis l’erreur et enfin le mensonge d’État au travers d’un conte à dormir debout où l’irrationnel et la pensée magique l’emporteront souvent sur le positivisme pourtant en vogue à cette époque. <ref>Birnbaum, ''L'Affaire Dreyfus'', p.38</ref> |
|||
{{Citation3|Dès cette première heure s’opère le phénomène qui va dominer toute l’affaire. Ce ne sont plus les faits contrôlés, les choses examinées avec soin qui forment la conviction ; c’est la conviction souveraine, irrésistible, qui déforme les faits et les choses. [[Joseph Reinach]]}} |
|||
Pourtant, au moment de son procès à huis clos devant un Conseil de Guerre qui se déroule sur trois jours en décembre 1894, il clame son innocence avec véhémence et est sur le point d'être acquitté lorsqu'une « pièce secrète » adjointe au dossier et non communiquée au défendeur et à son avocat, Maître Demange, est transmise aux juges militaires et force la condamnation. |
|||
[[Image:Alphonse Bertillon.jpg|thumb|200px|left|'''[[Alphonse Bertillon]]''' n'est pas un expert en écriture mais il invente la théorie de « l'auto-forgerie »]] |
|||
[[Image:Auguste Mercier.jpg|thumb|200px|right|Le général '''[[Auguste Mercier]]''', ministre de la Guerre en 1894]] |
|||
====Expertises en écriture==== |
|||
Le [[22 décembre]], Dreyfus est condamné à la dégradation militaire - qui aura lieu le [[5 janvier]] [[1895]] dans la cour de l'[[École militaire (France)|École militaire]] - et à la déportation au bagne de l'[[Île du Diable (Guyane)|Île du Diable]] en Guyane. |
|||
Pour confondre Dreyfus, les écritures du bordereau et du capitaine sont comparées. Personne n’est compétent en cette matière à l’État-major<ref>Comme le signale d'ailleurs le général Mercier à ses subordonnés</ref>. Entre alors en scène l’un des personnages les plus énigmatique de cette histoire : le [[commandant]] [[Armand du Paty de Clam|du Paty de Clam]]. <ref>sur les personnalités de Mercier et du Paty de Clam, lire : Paléologue, ''L’Affaire Dreyfus et le Quai d’Orsay'', p.111 et s., et Guillemin, ''L’énigme Esterházy'', T1 p. 99</ref> Entre autres traits originaux de sa personnalité complexe, le commandant se pique d’une expertise [[graphologie|graphologique]]. Mis en présence des deux écritures le [[5 octobre]], du Paty conclut d’emblée à l’identité. Après une journée de travail complémentaire, il assure dans un rapport que, malgré quelques dissemblances, les ressemblances sont suffisantes pour justifier une enquête. Dreyfus est donc « l'auteur probable » du bordereau pour l'État-major<ref>Bredin, '' l’Affaire'', p. 70</ref>.<br> |
|||
La peine est sévère (l'Île du Diable est dans les faits une quasi-condamnation à mort), même pour une affaire d'espionnage militaire. Le prisonnier est au secret du fait de la nature même de l'affaire touchant à la sécurité nationale. |
|||
Le général Mercier tenant un coupable, il va faire mousser l'affaire, qui prendra le statut d'affaire d'État pendant la semaine qui s'écoule avant l'arrestation de Dreyfus. En effet, le ministre consulte et informe toutes les autorités<ref>nota : le général rencontre le président de la République, [[Casimir-Perier]], en minimisant l'importance des pièces transmises, ce que Mercier niera ensuite, opposant irréductiblement les deux hommes. v. ''Procès de Rennes'', T1. pp. 60, 149 et 157</ref>, mais malgré les conseils de prudence<ref>Du général [[Félix Gustave Saussier|Saussier]], gouverneur de la place de Paris notamment</ref> et les objections courageusement exprimés par [[Gabriel Hanotaux]] lors d'un petit conseil des ministres,<ref>Thomas, ''L'affaire sans Dreyfus'', p. 141. Hanotaux a fait promettre à Mercier d'abandonner les poursuites si d'autres preuves n'étaient pas trouvées. C'est sans doute l'origine du dossier secret.</ref> il décide de poursuivre.<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p.72</ref> Du Paty de Clam est nommé [[officier de police judiciaire]]. Pendant ce temps plusieurs informations sont ouvertes parallèlement, les unes sur la personnalité de Dreyfus, les autres consistant à s'assurer de la réalité des identités d'écriture. L'expert<ref>expert en écritures à la Banque de France. Son honnête prudence sera vilipendée dans l'acte d'accusation du commandant d'Ormescheville. Reinach, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75082s ''Histoire de l'affaire Dreyfus'', Tome 1], p.311 </ref> Gobert n'est pas convaincu, trouve de nombreuses différences et écrit même que « la nature de l'écriture du bordereau exclut le déguisement graphique »<ref>Reinach, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75082s ''Histoire de l'affaire Dreyfus'', Tome 1], p.92. Gobert affirme que le texte a été écrit rapidement, excluant la copie</ref>. Déçu, Mercier fait alors appel à [[Alphonse Bertillon]], l'inventeur de l'[[anthropométrie]] judiciaire, mais nullement expert en écritures. Il n'est d'abord pas plus affirmatif que Gobert, en n'excluant pas une copie de l'écriture de Dreyfus.<ref>''Procès de Rennes'', T2 p. 322. Idée renforcée par la transparence du papier.</ref>. Mais par la suite, sous la pression des militaires, il affirmera que Dreyfus s'est auto-copié.<br> |
|||
== L'affaire d'espionnage devient une affaire judiciaire == |
|||
====L'arrestation==== |
|||
Mathieu Dreyfus, le frère aîné d'Alfred Dreyfus, est convaincu de l'innocence de l'accusé . Il réussit à convaincre divers modérés, dont le vice-président du Sénat [[Auguste Scheurer-Kestner]] et un journaliste de gauche [[Bernard Lazare]] de se pencher sur les zones d'ombre de la procédure. |
|||
Le [[13 octobre]], sans aucune preuve tangible, le dossier étant vide, le général Mercier fait convoquer le capitaine Dreyfus pour une inspection générale, en « tenue bourgeoise »<ref>En civil.</ref>. L'objectif de l'État-major était de gagner la [[Preuve en droit pénal français|preuve]] parfaite en droit français : l'[[aveu]]. Cet aveu serait obtenu par effet de surprise, en faisant écrire au suspect une lettre inspirée du bordereau<ref>Reinach, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75082s ''Histoire de l'affaire Dreyfus'', Tome 1], p.107</ref> au coupable<ref>''Rapport de la Cour de Cassation'', T1 p.127</ref> sous la dictée. <br> |
|||
Le [[15 octobre]] [[1894]] au matin, le capitaine Dreyfus subit donc cette mascarade, sans rien avouer. L'espoir des militaires était déçu. Du Paty de Clam le fait arrêter tout de même<ref>L'ordre d'arrestation avait été signé d'avance.</ref> et l'inculpe d'intelligence avec l'ennemi afin d'être traduit devant un Conseil de guerre. Il est incarcéré à la [[prison du Cherche-midi]] à [[Paris]]. |
|||
[[Image:Du Paty de Clam.jpg|thumb|200px|right|Le commandant '''du Paty de Clam''', chef d'enquête, procède à l'arrestation du capitaine Dreyfus]] |
|||
=== L'instruction et le premier Conseil de guerre=== |
|||
Leur campagne en faveur de la révision, relayée petit à petit, d'abord surtout dans la presse de gauche antimilitariste déclenche en retour une vague d'antisémitisme très violente dans l'opinion. La France était alors en nette majorité antidreyfusarde. Le commandant Henry, à la « Section de Statistique », est de son côté conscient de la fragilité du dossier d'accusation. Il tente de le renforcer, en accord avec le Chef d'État Major, le [[général de Boisdeffre]], et le general Gonse, afin d'éviter toute tentative de révision. Il apporte donc au dossier d'accusation, en 1896, deux faux entièrement composés par lui qui prouveraient formellement la culpabilité de Dreyfus. |
|||
{{Mme}} Dreyfus est prévenue le jour même de l'arrestation, par une perquisition au domicile du capitaine. Mais elle doit se taire sous les menaces comminatoires de du Paty. En toute illégalité<ref>Cour de cassation, Duclert, ''De la justice...'', p. 51</ref>, Dreyfus est mis au secret dans sa prison. Il est torturé psychologiquement jour et nuit par du Paty, qui veut obtenir des aveux. Mais Dreyfus ne craque pas, et n'avoue rien. Il est soutenu par le premier dreyfusard : le commandant Forzinetti<ref>Commandant les prisons militaires de Paris.</ref>. <br> |
|||
Le [[30 octobre]], l'affaire est révélée dans le journal antisémite d'[[Édouard Drumont]], ''[[La Libre Parole]] '', début d'une très violente campagne de presse qui durera jusqu'au procès. Cet événement place l'Affaire sur le terrain de l'[[antisémitisme]], qu'elle ne quittera plus<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 80</ref>.<br> |
|||
Le [[1er novembre]], [[Mathieu Dreyfus]], le frère d'Alfred, appelé d'urgence à Paris, est mis au courant de l'arrestation. Il va devenir l'artisan du combat long et ingrat pour la libération de son frère. En attendant, il s'est mis à la recherche d'un avocat, qui sera finalement l'éminent pénaliste Edgar Demange.<br> |
|||
[[Image:Felix-gustave-saussier.jpg|thumb|150px|left|Le général '''[[Félix Gustave Saussier|Saussier]]''', gouverneur militaire de Paris, ordonne une information contre Dreyfus]] |
|||
====L'instruction==== |
|||
Le lieutenant-colonel [[Marie-Georges Picquart]], nouveau chef du contre-espionnage militaire francais, autrement dit de la "Section de Statistique", obtient de son côté la communication par la même Marie Bastian espionne à l'Ambassade d'Allemagne, d'un document appelé le « petit bleu ». Les soupcons de Picquart se dirigent sur un officier francais d'origine hongroise, donc lui aussi originaire d'un pays potentiellement ennemi, l'[[Empire austro-hongrois]]. Il s'agit du commandant d'infanterie [[Ferdinand Walsin Esterhazy]]. Son écriture ressemble formellement à celle du « bordereau » qui a servi a incriminer Dreyfus. Picquart fait faire une enquête - curieusement en accord avec ses supérieurs - qui démontre qu'Esterhazy avait connaissance des éléments décrits par le « bordereau » et qu'il était en contact avec l'attaché militaire allemand Schwarzkoppen. Bien que Esterhazy soit un ancien membre du contre-espionnage francais où il a servi après la Guerre de 1870, c'est un personnage trouble à la réputation personnelle controversée, donc un traître plausible. Picquart communique les résultats de son enquête à l'État Major qui fera ensuite tout pour l'évincer de son poste, avec l'aide de son propre adjoint le commandant Henry. Il s'agissait avant tout, dans les hautes spheres de l'Armée, de ne pas admettre que la condamnation de Dreyfus eût été une grave erreur judiciaire. |
|||
Le [[3 novembre]], à contre cœur<ref>Il traite le rapport de du Paty « d'élucubrations », Bredin, ''l'Affaire'', p.88.</ref>, le général Saussier donne l'ordre d'informer. Saussier avait tous les pouvoirs pour arrêter la machine infernale, mais il ne l'a pas fait. A-t-il cru exagérément en la justice militaire pour acquitter Dreyfus<ref>Cour de cassation, ''De la justice'', p. 103</ref> ?<br> |
|||
Le commandant Besson d'Ormescheville, rapporteur auprès du Conseil de guerre, commet un rapport à charge. Tous les ragots les plus vils sur la vie privée prétendument dissolue d'Alfred Dreyfus, toutes les indiscrétions, les boues de caniveau, encombrent ce monument de partialité<ref>Zola, ''J'accuse''.</ref>. Mais même supposés vrais, ce ne sont pas des preuves de trahison.<br> |
|||
On n'a donc pas de preuves, mais c'est une preuve de culpabilité. Dreyfus n'a pas connu les pièces incriminées dans le bordereau, mais il aurait pu les connaître. Il avait de la mémoire : une nouvelle preuve. Il savait l'allemand : une autre preuve. Il ne savait finalement pas très bien l'allemand : toujours une preuve. Bref le vide. <br> |
|||
Le [[4 décembre]], devant ce dossier « accablant »<ref>L'accusation ne repose que sur l'écriture du bordereau, dont les expertises se contredisent. Bredin, ''l'Affaire'', p. 89</ref>, Dreyfus est renvoyé devant le premier Conseil de guerre. Le secret est levé et M{{e}} Demange a enfin accès au dossier. À sa lecture, sa confiance est absolue : ce sera l'acquittement. Premier juge de Dreyfus, l'avocat a pu constater le néant du dossier qui ne repose que sur une pièce unique, le bordereau, et sur de vagues témoignages indirects. |
|||
====Le procès : « le huis clos ou la guerre ! »<ref>nota : Titre de l’''Intransigeant'' du 21 décembre 1894</ref>==== |
|||
Dans le même temps, les républicains centristes au pouvoir, lesquels ont fait condamner Dreyfus, ne veulent surtout pas donner d'arguments à leurs adversaires politiques à l'extréme droite, en se faisant accuser de « mollesse philosémite » et d'[[antimilitarisme]]. Ils font donc une campagne violente dans la Presse pour défendre l'honneur de l'Armée et empêchent la possibilite d'une révision judiciaire. Cette campagne finit par atteindre Picquart en personne. |
|||
[[Image:Dreyfus Petit Journal 1894.jpg|thumb|200px|right|Une du '''[[Le Petit Journal|Petit Journal]]''' du 23 décembre 1894]] |
|||
Le Conseil de guerre se déroule du 19 au [[22 décembre]] [[1894]]. Sous la pression de la violente campagne de presse qui durait depuis deux mois, le huis clos<ref>Procès qui a lieu en la seule présence des magistrats, de l'accusé et de sa défense.</ref> est prononcé. Ce huis clos n'est d'ailleurs pas conforme puisque le commandant [[colonel Picquart|Picquart]] et le préfet [[Louis Lépine]] seront présents à certaines audiences en violation du droit. Cette mesure permet, dès lors, de ne pas divulguer le néant du dossier au grand public<ref>Reinach, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75082s ''Histoire de l'affaire Dreyfus'', Tome 1], p. 394</ref>. C'est l'étouffement des débats<ref>Cour de cassation, ''De la justice'', Duclert, p. 107 </ref><br> |
|||
Conformément aux prévisions, le vide du dossier apparaît nettement. Les discussions de fond sur le bordereau montrent que le capitaine Dreyfus ne pouvait pas en être l'auteur<ref>Reinach, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75082s ''Histoire de l'affaire Dreyfus'', Tome 1], p.409 et Doise, ''Histoire militaire...'', p. 87</ref>. D'autre part, l'accusé lui même clame son innocence, et se défend point par point. Au surplus, ses déclarations sont appuyées par de nombreux témoignages à décharge. Enfin l'absence de mobile pour le crime est une sérieuse épine dans le dossier d'accusation. Dreyfus était en effet ultra patriote, brillant officier prometteur, et surtout très riche<ref>Alors qu'il n'était que capitaine, il gagnait des revenus personnels issus de l'héritage de son père et de la dot de sa femme, équivalents à ceux d'un général commandant de région. Doise, ''l'histoire militaire...'', p.38</ref>.<br> Pourquoi donc aurait-il trahi ? Personne n'apporte d'arguments. Pour la presse de droite, l'argument est tout trouvé : parce qu'il est juif !<br> |
|||
[[Alphonse Bertillon]], qui n'est pas expert en écritures, est présenté comme un savant de première importance. Il invente la théorie extravagante de l'auto-[[forgerie]] à l'occasion de ce procès. Il accuse en effet Dreyfus d'avoir imité sa propre écriture, expliquant les dissemblances de l'écriture du bordereau par le fait qu'il ait employé des extraits de l'écriture de son frère Mathieu et de son épouse Lucie. Cette théorie farfelue et sidérante semble avoir eu un certain effet sur les juges. |
|||
Le commandant [[Hubert-Joseph Henry|Hubert Henry]] <ref>Adjoint du chef du SR et découvreur du bordereau</ref> fait une déclaration théâtrale. En affirmant qu'une suspicion existait depuis le mois de février à propos d'une trahison à l'État-major, il jure sur l'honneur à l'audience que le traître est Dreyfus en le désignant. L'incident a un effet considérable sur le jury<ref>Composé de sept officiers qui sont à la fois juges et jurés.</ref>.<br> |
|||
Toutefois, l'issue du procès est incertaine. La conviction des juges a été ébranlée par l'attitude ferme et les réponses logiques de l'accusé<ref>Reinach, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75082s ''Histoire de l'affaire Dreyfus'', Tome 1], p. 411</ref>. Les juges partent délibérer. Mais l'État-major a encore une carte en main. |
|||
====Transmission d'un dossier secret aux magistrats==== |
|||
Picquart est alors muté dans le Sud tunisien pour l'éloigner de Paris. Le journal ''[[L'Eclair]]'', le [[14 septembre]] [[1896]], révèle l'existence du « dossier secret» qui, paradoxalement, établit l'illegalité de la procedure. Puis le [[10 novembre]] [[1896]], ''[[Le Matin (France)|Le Matin]]'' reproduit un fac-similé du bordereau. |
|||
[[Image:Schwartzkoppen3.jpg|thumb|150px|left|'''Max von Scharzkoppen''' a toujours affirmé n'avoir jamais connu Dreyfus]] |
|||
Les témoins militaires du procès alertent le commandement sur les risques d'acquittement. Mais dans cette éventualité, la Section de statistiques avait préparé un dossier, contenant quatre preuves « absolues » de la culpabilité du capitaine Dreyfus, accompagnées d'une note explicative. Celui-ci fut remis, en [http://fr.wikisource.org/wiki/Affaire_Dreyfus_-_arr%C3%AAt_de_la_Cour_de_cassation_du_12_juillet_1906#En_ce_qui_concerne_le_dossier_secret_: toute illégalité], au président du Conseil de guerre, le colonel Emilien Maurel au début du délibéré sur ordre du ministre de la Guerre, le général Mercier<ref>En droit militaire français de l'époque, toutes les preuves de culpabilité doivent être remises à la défense afin d'être débattues contradictoirement, ce qui n'était pas le cas de la justice ordinaire.</ref>.<br> |
|||
Ce dossier, on le saura bien plus tard, contenait, outre des lettres sans grand intérêt dont certaines étaient truquées<ref>Birnbaum, ''l'Affaire Dreyfus...'', p.43</ref>, une pièce restée célèbre dénommée « '''Canaille de D...''' ». C'était une lettre de l'attaché militaire allemand, Max von Schwartzkoppen à l'attaché militaire italien Alessandro Panizzardi interceptée par le SR. La missive était sensée accuser définitivement Dreyfus, puisque d'après ses accusateurs, il était désigné par l'initiale de son nom<ref>Il s'agissait en fait d'un dénommé Dubois, identifié par la Section de statistiques depuis un an.</ref>. En réalité, la Section de statistiques savait que la lettre ne pouvait pas être attribuée à Dreyfus, et si elle le fut, ce fut par intention criminelle<ref>Cour de cassation, ''De la justice...'', Duclert p. 92</ref>.<br> |
|||
Le colonel Maurel a affirmé au second procès Dreyfus<ref>''Rennes'', T2, pp. 191 et s.</ref> que les pièces secrètes n'avaient pas servi à emporter l'adhésion des juges du Conseil de guerre. Mais il se contredit en affirmant qu'il a lu un seul document, « ce qui fut suffisant ».<br> |
|||
Après plusieurs heures de délibération, le verdict tombe. |
|||
====Condamnation, dégradation et déportation==== |
|||
Enfin, en [[1897]], Picquart fait connaître publiquement ses doutes sur la culpabilité de Dreyfus, du fait de sa découverte d'un des faux de Henry lors de sa consultation du dossier lorsqu'il était en fonction comme directeur de la « Section de Statistique » à la suite de Sandherr, décédé. Il a également pris connaissance d'une autre pièce « découverte » à l'ambassade d'Allemagne, grâce a Madame Bastian, dite « le petit bleu » incriminant le commandant [[Ferdinand Walsin Esterhazy|Esterhazy]]. |
|||
[[Image:Dreyfus-in-Prison-1895.jpg|thumb|200px|right|Une du '''[[Le Petit Journal|Petit Journal]]''' du 20 janvier 1895]] |
|||
Le [[22 décembre]], à l'unanimité des sept juges, Dreyfus est condamné « à la destitution de son grade, à la dégradation militaire, et à la déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée », c'est-à-dire au bagne en Guyane.<br> |
|||
La [[constitution de 1848]] avait aboli la peine capitale pour crime politique. Le jury a condamné Dreyfus pour trahison, à l'unanimité. Pour la presse et le public, les quelques doutes préexistants au procès s'étaient immédiatement dissipés, et personne ne se posait plus de question. La culpabilité était certaine. L'heure était à la vindicte populaire.<br> |
|||
À droite comme à gauche, on regrettait l'abolition de la peine de mort pour ce genre de crime. L'antisémitisme atteint des sommets dans la presse et se manifeste dans des populations jusqu'à présent épargnées<ref>Reinach, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75082s ''Histoire de l'affaire Dreyfus'', Tome 1], p.468</ref>. Même [[Jean Jaurès|Jaurès]] dans un article, rappelle « qu'un troupier vient d'être condamné à mort et exécuté pour avoir lancé un bouton au visage d'un adjudant. Alors pourquoi laisser ce misérable en vie ? » |
|||
Le [[5 janvier]] [[1895]], la cérémonie de la dégradation se déroule dans une cour de l'[[École militaire (France)|École militaire]] à Paris. Les témoins signalent la dignité de Dreyfus, qui continue de clamer son innocence. Ici vient se greffer ce que l'on appellera appellera « la légende des aveux »<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 107</ref>. Avant la dégradation, Dreyfus aurait confié être un traître au capitaine Lebrun-Renault, dans le fourgon qui l'amenait à l'École militaire. Il apparaîtra qu'en réalité, le capitaine de la Garde républicaine s'était vanté, mais que Dreyfus n'avait fait [http://fr.wikisource.org/wiki/Affaire_Dreyfus_-_arr%C3%AAt_de_la_Cour_de_cassation_du_12_juillet_1906#En_ce_qui_concerne_les_pr.C3.A9tendus_aveux_: aucun aveu]<ref>Décision de la Cour de Cassation</ref>.<br> |
|||
Puis, en novembre, les défenseurs des Dreyfus sont informés par d'autres sources des similitudes d'écriture du "bordereau" avec celle d'Esterhazy et de nouvelles charges contre ce dernier. |
|||
Le prisonnier est mis au secret du fait de la nature même de l'affaire, touchant à la sécurité nationale. Il est enfermé dans une cellule en attendant son transfert.<br> |
|||
Le [[17 janvier]], il est transféré au bagne de l'[[île de Ré]], où il est maintenu plus d'un mois. Il a le droit de voir sa femme deux fois par semaine, dans une salle allongé, chacun à un bout, le directeur de la prison au milieu<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 103</ref>.<br> |
|||
Le [[21 février]], il embarquait sur le vaisseau ''Ville-de-Saint-Nazaire''. Le lendemain, le navire fit cap vers la [[Guyane (France)|Guyane]]. |
|||
==La Vérité en marche (1895-1897)== |
|||
Le [[15 novembre]], Mathieu Dreyfus porte plainte auprès du Ministère de la Guerre contre Esterhazy. Mais celui-ci va être protégé par l'État-major et donc par le gouvernement. Pour le disculper, il est présenté le [[10 janvier]] [[1898]] devant un [[Conseil de guerre]] qui l'acquitte dès le lendemain . Le lieutenant colonel Picquart, pour sa part, est lui-même arrêté sous l'accusation de violation du secret professionnel comme ayant divulgué son enquête à son avocat qui l'aurait révélé au sénateur Scheurer-Kestner. Le commandant Esterhazy, mis à la retraite, ne tardera pas à s'exiler en Angleterre ou il terminera ses jours confortablement dans les années 1920. Il est clair qu'Esterhazy bénéficia, au moment de « L'Affaire » , d'un traitement de faveur de la part des hautes sphères de l'Armée. Ce traitement ne s'explique que par le désir de l'État Major de vouloir étouffer toute velléite de remettre en cause le verdict du Conseil de Guerre qui avait condamné le capitaine Dreyfus. |
|||
===Dreyfus à l'île du Diable=== |
|||
[[Image:650px-Case de Dreyfus.jpg|thumb|150px|left|La case de Dreyfus sur '''l'île du Diable''' en Guyane]] |
|||
[[Image:Dreyfus Ile du diable 96.jpg|thumb|200px|right|Une du '''Petit Journal''' du 27 septembre 1896]] |
|||
Le [[12 mars]], après une traversée pénible de quinze jours, le navire mouille au large des [[îles du Salut]]. |
|||
Dreyfus reste un mois au bagne de l'[[île Royale]], puis il est transféré à l'[[Île du Diable (Guyane)|île du Diable]] le [[14 avril]]. |
|||
Avec ses gardiens, il est le seul habitant de l'île, logeant dans une case de pierre de quatre mètres sur quatre<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 125</ref>. |
|||
Hanté par le risque de l'évasion, le commandant du bagne va faire vivre un enfer au condamné alors que les conditions de vie sont déjà très pénibles. La température atteint 45°C. |
|||
Dreyfus tombe malade, secoué par les fièvres qui s'aggraveront d'année en année<ref>Alfred Dreyfus, ''Cinq années de ma vie''</ref>. <br> |
|||
Dreyfus est autorisé à écrire sur un papier numéroté et paraphé. Il subit la censure du commandement de même que lorsqu'il reçoit du courrier de sa femme Lucie, par lequel ils s'encouragent mutuellement.<br> |
|||
[[Image:J accuse.jpg|right|thumb|260px|La une de ''[[L'Aurore (journal)|L'Aurore]]'', ''[[J'accuse]]'' d'[[Émile Zola]]]] |
|||
Le [[6 septembre]] [[1896]], les conditions de vie d'Alfred Dreyfus s'aggravent encore : il est mis à ''la double boucle''. |
|||
Le [[25 novembre]], [[Émile Zola]], entre-temps convaincu de l'innocence de Dreyfus, publie un premier article dans ''[[Le Figaro]]'', qui ne tardera pas à se désengager de ce qui est désormais « L'Affaire », puis le [[13 janvier]] [[1898]], il publie en première page de ''[[L'Aurore (journal)|L'Aurore]]'', un article intitulé : ''[[J'accuse]]'', adressé au [[Liste des présidents de France|président]] Félix Faure, article qui fait l'effet d'une bombe. |
|||
Ce supplice infâme, oblige le forçat à rester sur son lit, immobile, les chevilles entravées. |
|||
Cette mesure est la conséquence de la fausse information de son évasion, révélée par un journal anglais. |
|||
Pendant deux longs mois, elle plonge Dreyfus dans un profond désespoir. |
|||
Pour lui, il est certain, à ce moment, que sa vie s'achèvera sur cette île lointaine<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 132</ref>. |
|||
===La famille Dreyfus découvre l'affaire et agit=== |
|||
Le général [[Jean-Baptiste Billot|Billot]] porte plainte contre Zola qui passe devant les [[Assises]] de la Seine du [[7 février|7]] au [[23 février]]. Il est condamné à 3 000 francs d'amende (c'est [[Octave Mirbeau]] qui paiera de sa poche les 7 525 francs, représentant le montant de l'amende et des frais de justice, le 8 août 1898) et un an de prison, mais son procès a permis la publicité des pièces. |
|||
[[Image: |
[[Image:Cdt henry.JPG|thumb|200px|left|Le commandant Henry, faussaire du SR.]] |
||
Mathieu Dreyfus, le frère aîné d'Alfred Dreyfus, est convaincu de l'innocence du condamné. Il est le premier artisan de la réhabilitation de son frère, dans un moment très difficile à vivre, passant tout son temps, toute son énergie et sa fortune à rassembler autour de lui un mouvement de plus en plus puissant en vue de la révision du procès de décembre 1894 : |
|||
::{{citation|Après la dégradation, le vide se fit autour de nous. Il nous semblait que nous n'étions plus des êtres comme les autres, que nous étions comme retranchés du monde des vivants. Mathieu Dreyfus}}<ref>Mathieu Dreyfus, ''L'Affaire telle que je l'ai vécue'', Fayard, p. 47</ref> |
|||
Mathieu essaie toutes les pistes, y compris les plus étonnantes. |
|||
Un mouvement dit ''dreyfusard'' se forme pour défendre Alfred Dreyfus. Parmi ces derniers, se trouvent des hommes de lettres (Émile Zola, Octave Mirbeau, [[Anatole France]]) et de sciences, des universitaires et des savants ([[Arthur Giry]], [[Auguste Molinier]], [[Paul Meyer]]), qualifiés pour la première fois d'« intellectuels ». On trouve également des catholiques ou libre-penseurs, et de nombreux [[protestants]] tels que [[Raoul Allier]]. Certains formeront la [[Ligue française pour la défense des droits de l'Homme et du citoyen]]. [[Jean Jaurès]] défendra aussi Dreyfus, publiant le [[11 octobre]], dans ''La Petite République'', un article intitulé ''[[s:Les Preuves|Les Preuves]]''. Un ministre de la Guerre (le général Chanoine) le défendra aussi. |
|||
Ainsi, grâce au docteur Gibert<ref>nota : ami du président [[Félix Faure]]</ref> il rencontre au [[Le Havre|Havre]] une femme qui, sous [[hypnose]], lui parle pour la première fois d'un « dossier secret »<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 117</ref>. Le fait est confirmé par le président de la République au docteur Gibert dans une conversation privée. |
|||
Petit à petit, malgré les menaces d'arrestation pour complicité, les filatures, les pièges tendus par les militaires, il réussit à convaincre divers modérés. |
|||
Ainsi, le vice-président du [[Sénat (France)|Sénat]] [[Auguste Scheurer-Kestner]], un alsacien, et un journaliste de gauche [[Bernard Lazare]], se penchent sur les zones d'ombre de la procédure. |
|||
Lazare est le premier à publier un opuscule dreyfusard dès [[1896]] à [[Bruxelles]]<ref>Lazare, ''Une erreur judiciaire. La vérité sur l'Affaire Dreyfus'', Bruxelles, novembre 1896.</ref>. |
|||
Cette publication n'a que peu d'influence sur le monde politique et intellectuel, mais elle contient tant de détails que l'État-major suspecte le nouveau chef du SR, Picquart, d'en être responsable.<br> |
|||
Leur campagne en faveur de la révision, relayée petit à petit dans la presse de gauche antimilitariste, déclenche en retour une vague d'antisémitisme très violente dans l'opinion. |
|||
Cette affaire prendra par la suite une tournure ouvertement politique. |
|||
La France était alors très majoritairement antidreyfusarde. |
|||
Le commandant Henry, à la Section de statistiques, est de son côté conscient de la fragilité du dossier d'accusation. |
|||
À la demande de sa hiérarchie, le [[général de Boisdeffre]], chef d'État-major général, et le général Gonse, il est chargé de faire grossir le dossier afin d'éviter toute tentative de révision. |
|||
Incapable de trouver la moindre preuve à ''posteriori'', il décide d'en fabriquer... |
|||
===Le vrai coupable est identifié et dénoncé : affaire Esterházy et procès=== |
|||
À côté des partisans sincères de la culpabilité ou de l'innocence de Dreyfus apparaissent les ''dreyfusistes'' et les ''anti-dreyfusistes'' qui voient dans l'affaire pour les uns un moyen de remettre en cause la politique des modérés d' « apaisement » entre l'Église et la République et de s'attaquer à l'institution militaire jugée réactionnaire (les radicaux) ou même dangereuse par essence (les socialistes), pour les autres (monarchistes, républicains conservateurs ou cléricaux intransigeants) au contraire le moyen de prendre leur revanche sur les modérés, jugés trop proches des milieux juifs, protestants ou maçons et sur leurs nouveaux alliés catholiques « ralliés ». |
|||
====Découverte du traître : Picquart « passe à l'ennemi »==== |
|||
[[Image:Picquart 2.jpg|thumb|200px|left|Le lieutenant colonel '''Georges Picquart''' en tenue de chasseurs d'Afrique]] |
|||
Le vrai coupable est découvert par hasard de deux manières ; par Mathieu Dreyfus d'une part, et par le SR d'autre part, à la suite d'une enquête. |
|||
Le fait marquant de cette période, c'est l'affectation du lieutenant-colonel [[Marie-Georges Picquart|Georges Picquart]] à la tête du SR en juillet 1895 ; le colonel Sandher est en effet tombé malade. Picquart avait suivi l’affaire Dreyfus dès son origine. <ref>C’est lui qui avait reçu le capitaine le matin du 15 octobre 1894, lors de la scène de la dictée.</ref>. <br> |
|||
En mars [[1896]], Picquart exige désormais de recevoir directement les documents volés à l'ambassade d'Allemagne, sans intermédiaire<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 140</ref> ; il y découvre un document surnommé le « '''petit bleu''' ». |
|||
Il s’agit d’une carte télégramme, jamais envoyée, écrite par von Schwartzkoppen et interceptée à l’ambassade d’Allemagne. |
|||
Celle-ci est adressée à un officier français d'origine hongroise : commandant [[Ferdinand Walsin Esterhazy|Ferdinand Esterházy]], 27 rue de la Bienfaisance - Paris<ref>Sur la personnalité et la vie d'Esterházy, lire Reinach, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k750834 ''Histoire de l'Affaire Dreyfus'' Tome 2], chapitre 1{{er}}</ref>. |
|||
Par ailleurs, une autre lettre au crayon noir de von Schwartzkoppen démontre les mêmes relations d'espionnage avec Esterházy<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p.142</ref>. |
|||
Mis en présence de lettres de cet officier, Picquart s'aperçoit avec stupéfaction que son écriture est la même que celle du « bordereau » qui a servi à incriminer Dreyfus. |
|||
Il se procure le « dossier secret » remis aux juges en [[1894]], et devant sa vacuité, acquiert la certitude de l’innocence de Dreyfus. <br> |
|||
Picquart diligente une enquête en secret, avec l'accord de ses supérieurs<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p.144</ref>. Elle démontre qu'Esterházy avait connaissance des éléments décrits par le « bordereau » et qu'il était bien en contact avec l'ambassade d'Allemagne<ref>Birnbaum, ''l'Affaire Dreyfus...'', p. 56</ref>. |
|||
Il fut notamment établi que l'officier vendait de nombreux documents secrets aux Prussiens, mais dont la valeur était assez faible. <br> |
|||
Esterházy était un ancien membre du contre-espionnage français<ref>Reinach, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k750834 ''Histoire de l'affaire Dreyfus'', Tome 2],p. 26</ref> où il a servi après la Guerre de 1870. |
|||
Les ''dreyfusards'', soutenus surtout par des républicains [[Parti radical|radicaux]], dont certains comme [[Georges Clemenceau|Clemenceau]] sont aussi désireux de faire oublier le [[scandale de Panama]], puis par des socialistes jaurésiens, heureux de pouvoir vitupérer contre le jésuitisme et le militarisme, soutiennent que Dreyfus est innocent ou du moins condamné sans preuves et qu'il faut refaire le jugement au risque de désavouer les autorités militaires et le gouvernement républicain modéré. |
|||
Il avait travaillé dans le même bureau que le Commandant Henry de 1877 à 1880 <ref>Ce qui pose la question de savoir s'il n'y a pas eu complicité entre les deux hommes. Bredin, p. 144 et Thomas p. 231 sont sceptiques </ref>. |
|||
Fripouille à la personnalité trouble, à la réputation sulfureuse et controversée, criblé de dettes, il est pour Picquart, un traître probable animé par un mobile certain : l'argent. <br> |
|||
Picquart communique alors les résultats de son enquête à l'État-major. |
|||
Mais il se heurte à un mur : « l'autorité de la chose jugée ». |
|||
Désormais, tout sera fait pour l'évincer de son poste, avec l'aide de son propre adjoint le commandant Henry. |
|||
Il s'agissait avant tout, dans les hautes sphères de l'Armée, de ne pas admettre que la condamnation de Dreyfus puisse être une grave erreur judiciaire. |
|||
Pour Mercier, puis Zurlinden, et l'État-major, ce qui est fait est fait, on ne revient jamais en arrière<ref>Doise, ''Histoire militaire...'', p. 24 et s. </ref>. |
|||
Il convenait maintenant de séparer les affaires Dreyfus et Esterházy.<br> |
|||
====Dénonciation d'Estarházy==== |
|||
Les antidreyfusards, soutenus par la majorité des conservateurs, des modérés (mélinistes) et des nationalistes, pensent soit que Dreyfus est réellement coupable, soit qu'une révision du jugement n'est pas opportune dans les conditions morales et militaires de la France de l'époque. La hiérarchie de l'église catholique, dans le but de porter un coup décisif à la République et permettre ainsi un retour à l'ancien régime, se range résolument dans le camp des antidreyfusards. |
|||
[[Image:Ferdinand Esterhazy.jpg|thumb|200px|right|Le commandant '''Ferdinand Walsin Esterházy''']] |
|||
La presse lance une violente campagne contre le noyau dur naissant des Dreyfusards. |
|||
Cependant, si les clivages sont assez nets sur le plan des grandes tendances de l'opinion ou de la presse, gauche « révisionniste » contre droite « anti-révisionniste », le partage est beaucoup moins tranché au niveau des individus. Ainsi, des catholiques ([[Paul Viollet]]) ou des conservateurs athées d'extrême droite sont « dreyfusards », car non convaincus de la culpabilité de Dreyfus et une partie importante des radicaux sont « anti-dreyfusards » par jacobinisme ou s'abstiennent prudemment tel [[Emile Combes]] ainsi que d'assez nombreux socialistes (essentiellement [[guesdistes]]) par désintérêt pour le sort d'un bourgeois militariste ou même par antisémitisme économique. Les anarchistes, tels [[Sébastien Faure]], [[Séverine]] ou [[Mécislas Golberg]], qui a priori n'étaient pas attendus sur ce terrain, seront parmi les premiers à se mobiliser et en première ligne. |
|||
Mais en contre-attaquant, l'État-major se découvre et révèle des informations ignorées jusque là, ayant trait, notamment, au « dossier secret »<ref>v. articles de ''L'Éclair'' des 10 et 14 septembre 1896, hostiles à Dreyfus, mai révélant l'existence du « dossier secret ». Bredin, ''l'Affaire'', p. 163</ref>.<br> |
|||
Le doute commence à s'installer. |
|||
Des intellectuels s'interrogent<ref>Cassagnac, pourtant violent antisémite, fait paraître un article intitulé ''le doute'', mi-septembre 1896</ref>. |
|||
Picquart tente de convaincre ses chefs de réagir en faveur de Dreyfus, mais l'État-major semble sourd. |
|||
Une enquête est instruite contre lui, il est surveillé. |
|||
Il devient le gêneur qu'on éloigne dans l'Est, puis en [[Tunisie]] « dans l'intérêt du service »<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 167</ref>. <br> |
|||
C'est le moment que choisit le commandant Henry pour passer à l'action. Le [[1er novembre]] [[1896]], il fabrique un faux, le '''faux Henry'''<ref>Autrement appelé « faux patriotique » par les antidreyfusards</ref>, en conservant l'entête et la signature<ref>Alexandrine, signature usuelle de Panizzardi.</ref> d'une lettre quelconque de [[Panizzardi]], et écrit lui-même le texte central : |
|||
{{citation3|J'ai lu qu'un député va interpeller sur Dreyfus. Si on demande à Rome nouvelles explications, je dirai que jamais j'avais les relations avec ce Juif. C'est entendu. Si on vous demande, dites comme ça, car il ne faut pas que on sache jamais personne ce qui est arrivé avec lui.}} |
|||
Le [[7 juillet]] [[1898]], [[Jacques Marie Eugène Godefroy Cavaignac|Godefroy Cavaignac]], nouveau ministre de la Guerre, dans un discours devant la Chambre, veut démontrer une bonne fois pour toute la culpabilité de Dreyfus et fait état d'un document « accablant » contre lui. Argué de faux dans la presse par le colonel Picquart et par les animateurs de la cause dreyfusarde, le Ministre est contraint de faire expertiser ce document à l'État-Major qui va être obligé de reconnaître qu'il s'agit d'un faux réalisé par le colonel Henry qui est arrêté le [[30 août]]. Il se [[suicide]] (ou on le force à se suicider) le lendemain. Apparaît alors la notion de « faux patriotique » et ''[[La Libre Parole]]'', journal antisémite, lance une souscription au profit de sa veuve, ''le monument Henry''. Chaque donation est accompagnée de remarques lapidaires sur Dreyfus et les [[Dreyfusards]]. |
|||
C'est un faux assez grossier, Henry ne parle à personne de ses agissements, et les généraux Gonse et Boisdeffre peuvent foncer chez leur ministre, le général Billot, avec leur lettre salvatrice. |
|||
== La crise du régime == |
|||
Tout le monde respire. |
|||
Il n'y avait pas d'erreur. |
|||
Le traître était bien Dreyfus, on en est sûr désormais<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p.168</ref>. |
|||
Fort de cette trouvaille, l'État-major va désormais s'ingénier à protéger Esterházy et à persécuter le colonel Picquart. <br> |
|||
Picquart, qui ignore tout du faux Henry, comprend peu à peu qu'il est méprisé par les militaires. |
|||
C'est à partir de ce moment stratégique que la cause « dreyfusarde » l'emporte et que le milieu politico-militaire va s'efforcer de « limiter la casse ». |
|||
Littéralement accusé de malversations par le commandant Henry, il proteste par écrit et rentre à Paris. |
|||
[[Image:Marie-Georges Piquart.jpg|thumb|200px|left|'''Auguste Scheurer-Kestner''', vice-président du Sénat]] |
|||
Le [[16 février]] [[1899]], le président Félix Faure (hostile à la révision du procès) meurt, il est remplacé par [[Émile Loubet]]. Le [[3 juin]] est signé l'arrêt de révision renvoyant Alfred Dreyfus devant un second Conseil de guerre à [[Rennes]]. |
|||
Le secret est trop lourd à porter seul. Picquart se confie à son ami, l'avocat [[Louis Leblois]]. |
|||
Le vice-président du Sénat, [[Auguste Scheurer-Kestner]] est touché par le doute alors qu'il est mis en présence de l'avocat. |
|||
Sans citer Picquart, il révèle l'affaire aux plus hautes personnalités du pays. |
|||
Mais l'État-major a des soupçons. |
|||
C'est le début de l'affaire Picquart<ref>Doise, ''Histoire militaire...'', p. 109 et s.</ref>, cette conspiration contre l'officier de valeur qui a osé s'interroger sur l'indicible.<br> |
|||
Le commandant Henry, pourtant adjoint de Picquart, mais jaloux, mène de son propre chef, une opération d'intoxication afin de compromettre son supérieur. Il se livre à diverses malversations (fabrication d'une lettre le désignant comme l’instrument du syndicat juif voulant faire évader Dreyfus, truquage du « petit bleu » pour faire croire que Picquart en a effacé le nom du réel destinataire, rédaction d'un courrier nommant Dreyfus en toutes lettres).<br> |
|||
À cette date, le régime lui-même est contesté, [[Paul Déroulède]] a tenté le [[23 février]] un coup de force sur l'[[Palais de l'Élysée|Élysée]]. Le {{1er juin}}, le capitaine [[Jean-Baptiste Marchand|Marchand]], héros de [[Fachoda]], critique le gouvernement. Le [[4 juin]], le président Loubet est agressé aux courses d'[[Auteuil]]. Le [[11 juin]], le [[Gouvernement Charles Dupuy|gouvernement Dupuy]] est renversé. |
|||
En novembre [[1897]], les défenseurs de Dreyfus sont informés par d'autres sources des similitudes d'écriture du « bordereau » avec celle d'Esterházy et de nouvelles charges contre lui. |
|||
Mathieu avait en effet fait afficher la reproduction du bordereau, publiée par ''[[Le Figaro]]''. |
|||
Un banquier, Castro, avait formellement identifié son écriture comme celle du commandant Esterházy, son débiteur. |
|||
Le [[11 novembre]][[1897]], les deux pistes se rejoignent, à l'occasion d'une rencontre entre Scheurer-Kestner et Mathieu Dreyfus. |
|||
Mathieu obtient la confirmation du fait qu'Esterházy est bien l'auteur du bordereau. |
|||
Le [[15 novembre]], sur ces bases, Mathieu Dreyfus porte plainte auprès du ministère de la Guerre contre Esterházy<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 200</ref>. |
|||
La polémique étant publique, l'armée n'a plus d'autre choix que d'ouvrir une enquête.<br> |
|||
Fin [[1897]], Picquart, qui est revenu à Paris, fait connaître publiquement ses doutes sur la culpabilité de Dreyfus, du fait de ses découvertes. La collusion destinée à éliminer Picquart semble avoir échoué <ref>Thomas, ''l'Affaire sans Dreyfus'', p. 475</ref>. |
|||
La contestation est très forte et vire à l'affrontement. |
|||
Afin de discréditer Picquart, Esterházy envoie des lettres au Président de la République. |
|||
L'effet est vain. |
|||
====Procès et acquittement==== |
|||
Le général de Pellieux est chargé d'effectuer une enquête. |
|||
Celle-ci tourne court, l'enquêteur étant adroitement manipulé par l'État-major. |
|||
Le vrai coupable, lui dit-on, c'est le lieutenant-colonel Picquart<ref>Bredin, ''L'Affaire'', p. 207</ref>! |
|||
De Pellieux s'achemine vers un non-lieu, quand un nouveau coup de théâtre se produit : l'ex-maîtresse d'Esterházy, {{Mme}} de Boulancy, fait publier dans ''Le Figaro'' des lettres dans lesquelles il exprimait violemment, une dizaine d'années plus tôt, toute sa haine de la France et son mépris de l'Armée française. |
|||
Une partie de la presse vole au secours du traître au travers d'une campagne antisémite sans précédent.<br> |
|||
[[Image:Clemenceau - Manet.jpg|right|thumb|200px|Portrait de '''Georges Clemenceau''' par le peintre Edouard Manet]] |
|||
Mais la presse dreyfusarde réplique, forte des nouveaux éléments en sa possession. [[Georges Clemenceau]], dans le journal [[L'Aurore (journal)|''L’Aurore'']], se demande : |
|||
{{citation3|Qui protège le commandant Esterházy ? La loi s'arrête, impuissante devant cet aspirant prussien déguisé en officier français. Pourquoi ? Qui donc tremble devant Esterházy ? Quel pouvoir occulte, quelles raisons inavouables s'opposent à l'action de la justice ? Qui lui barre le chemin ? Pourquoi Esterhazy, personnage dépravé à la moralité plus que douteuse, est-il protégé alors que tout l’accuse ? Pourquoi un honnête soldat comme le lieutenant-colonel Picquart est-il discrédité, accablé, déshonoré ? S'il le faut nous le dirons!}} |
|||
Bien que protégé par l'État-major et donc par le gouvernement, Esterházy, est obligé d’avouer la paternité de lettres francophobes publiées par ''Le Figaro''. |
|||
Ceci décide le bureau de l’État-major, les membres de la Sainte Arche, à agir : une solution pour faire cesser les questions, les doutes et les débuts de demande de justification doit être trouvée. L'idée est d'exiger d'Esterházy qu'il demande lui-même à passer en jugement et être acquitté. Alors les bruits cesseront et tout rentrera dans l’ordre. |
|||
C'est donc pour le disculper définitivement, selon la vieille règle « ''Res judicata pro veritate habetur'' »<ref>La chose jugée est tenue pour véridique</ref>, qu'Esterházy est présenté le [[10 janvier]] [[1898]] devant un Conseil de guerre. |
|||
Le huis clos « retardé »<ref>La salle sera vidée dès que les débats aborderont des sujets touchant à la défense nationale, c'est à dire le témoignage de Picquart.</ref> est prononcé. Il est prévenu des sujets du lendemain avec des indications sur la ligne de défense à tenir. |
|||
Le procès est un festival d'impudences : les constitutions de parties civiles demandées par Mathieu et Lucie Dreyfus<ref>Appelée à la barre, le président Delegorgue refuse de l'interroger</ref> leur sont refusées, les trois experts en écritures ne reconnaissent pas l'écriture d'Esterházy dans le bordereau et concluent à la contrefaçon<ref>Thomas, ''l'Affaire sans Dreyfus'', T2 p. 244</ref>. |
|||
L'accusé lui-même est applaudi, les témoins à charge, hués et conspués, Pellieux intervient pour défendre l'État-major sans qualité légale<ref>Duclert, ''L'affaire Dreyfus'', p.39</ref>. |
|||
Bref une véritable comédie, une parodie de justice s'il en fut jamais. |
|||
Le véritable accusé est le colonel Picquart, sali par tous les protagonistes militaires de l'Affaire<ref>Thomas, ''l'Affaire sans Dreyfus'', T2 p. 245 </ref>.<br> |
|||
L'accusé est acquitté à l'unanimité dès le lendemain, après trois minutes de délibéré<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 227</ref>. |
|||
Sous les cris de « vive Esterházy », il a du mal à se frayer un chemin vers la sortie où l'attendent 1 500 personnes. |
|||
Mais l'État-major est allé trop loin. |
|||
Le scandale est immense et ne restera pas sans réponse. |
|||
===Les réactions à l'acquittement d'Esterházy === |
|||
[[Image:L Agitation-Antisemite.jpg|left|thumb|230px|Émeutes antisémites dans une gravure du '''''Petit Parisien'''''.]] |
|||
L'acquittement d'Esterházy amène un changement de stratégie dreyfusarde. Au libéralisme de Scheurer-Kestner et Reinach, succède une action plus combative et contestataire<ref>Duclert, ''l'affaire Dreyfus'', p.40</ref>. |
|||
Un mouvement dit ''dreyfusard'' s'est déjà formé pour défendre Alfred Dreyfus, animé par Bernard Lazare, Mathieu Dreyfus, Joseph Reinach et Auguste Scheurer-Kestner. De proche en proche, ils parviennent à convaincre de plus en plus d'élites. Parmi eux, on trouve des hommes de lettres : [[Émile Zola]] comme on l'a vu, mais aussi [[Octave Mirbeau]], [[Anatole France]], [[Marcel Proust]], [[Lucien Herr]]). Des scientifiques, des universitaires et des savants comme [[Arthur Giry]], [[Auguste Molinier]], [[Paul Meyer]] et surtout [[Émile Duclaux]], personnage considérable de la science française, directeur de l'Institut Pasteur. Il sont qualifiés pour la première fois d'« '''[[intellectuel]]s''' »<ref>Mot en vogue dans les années 1870, repris par Clemenceau</ref>. <br> |
|||
On trouve également des catholiques ou libre penseurs, et de nombreux [[protestants]] tels que [[Raoul Allier]]. C'est à l'occasion de l'affaire Dreyfus que la [[Ligue française pour la défense des droits de l'Homme et du citoyen]] est créée, afin d'affirmer la prédominance des doits individuels sur les excès de la raison d'État. <br> |
|||
Le monde politique n'est pas en reste. [[Jean Jaurès]] défendra aussi Dreyfus, publiant le [[11 octobre]], dans ''La Petite République'', une série d'articles intitulés ''[[s:Les Preuves|Les Preuves]]''. [[Georges Clemenceau]] et son frère [[Albert Clemenceau|Albert]], [[Léon Blum]], qui tente de convaincre [[Maurice Barrès|Barrès]], sans succès. |
|||
En réaction à l'acquittement, d'importantes émeutes antidreyfusardes et antisémites, d'une violence jamais atteinte, ont lieu dans toute la France. On attente aux biens et aux personnes. Par ailleurs, les réactions de l’État-major sont vives. Fort de cette victoire éclatante, l'heure est en effet venue des règlements de compte. Le lieutenant-colonel Picquart, est lui-même arrêté sous l'accusation de violation du secret professionnel, accusé d'avoir divulgué son enquête à son avocat qui l'aurait révélée au sénateur Scheurer-Kestner. <br> |
|||
Le colonel Picquart aurait pu s'arrêter là, revenir en arrière, se protéger. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il va s'engager de plus en plus dans l'Affaire par honneur. Il est, avec quelques autres, l'un des artisans majeurs de la révision.<br> |
|||
En attendant, il est l'objet des pires vexations, d'humiliations, mis aux arrêts au [[Mont-Valérien]]. On veut briser sa carrière s'il ne rentre pas dans le rang. À Mathieu qui le remercie, il réplique sèchement qu'il ne « fait que son devoir »<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 227 </ref>.<br> |
|||
Le commandant Esterházy, sera mis rapidement à la réforme, et devant les risques qui pèsent à son égard, ne tardera pas à s'exiler en Angleterre où il terminera ses jours confortablement dans les [[années 1920]]<ref>''Dictionnaire de l'affaire Dreyfus'', Thomas, entrée Esterházy en Angleterre</ref>. Il est clair qu'Esterházy bénéficia, au moment de « L'Affaire », d'un traitement de faveur de la part des hautes sphères de l'Armée. Ce traitement s'explique assez mal, sinon par le désir de l'État-major de vouloir étouffer toute velléité de remise en cause du verdict du Conseil de guerre qui avait condamné le capitaine Dreyfus en [[1894]]. |
|||
==L'affaire explose 1898== |
|||
===J'accuse : l'affaire Dreyfus devient l'Affaire=== |
|||
{{loupe|J'accuse}} |
|||
[[Image:J accuse.jpg|left|thumb|260px|A la une de ''[[L'Aurore (journal)|L'Aurore]]'', ''[[J'accuse]]'' d'[[Émile Zola]]]] |
|||
[[Image:Emile Zola.jpg|thumb|right|'''Émile Zola''' en 1898]] |
|||
[[Émile Zola]] est au sommet de sa gloire. |
|||
Il a publié les vingt volumes des [[Rougon-Macquart]], diffusés dans des dizaines de pays. |
|||
Il est une sommité du monde littéraire, et en a pleinement conscience. |
|||
Au général de Pellieux, il dira pendant son procès : |
|||
{{citation3|Je demande au général de Pellieux s'il n'y a pas différentes façons de servir la France ? On peut la servir par l'épée ou par la plume. M. le général de Pellieux a sans doute gagné de grandes victoires ! J'ai gagné les miennes. Par mes œuvres, la langue française a été portée dans le monde entier. J'ai mes victoires ! Je lègue à la postérité le nom du général de Pellieux et celui d'Émile Zola : elle choisira<ref>[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62779w Procès Zola, T1] p. 268</ref>!}}<br> |
|||
Par son engagement personnel, Zola donne une nouvelle dimension à l'affaire Dreyfus, qui devient l''''Affaire'''. |
|||
Mi-novembre [[1897]], [[Auguste Scheurer-Kestner]] présente à Zola l'ensemble du dossier Dreyfus, et le convainc de l'erreur judiciaire. |
|||
C'est le début de l'engagement officiel du romancier<ref>nota : bien qu'il soit déjà intervenu dans ''Le Figaro'' en mai [[1896]], dans un article ''Pour les juifs''</ref>. <br> |
|||
Le [[25 novembre]], Émile Zola publie ''M. Scheurer-Kestner'' dans ''[[Le Figaro]]'', premier article d'une série qui en comptera trois<ref>Suivi du ''Syndicat'' le 1{{er}} décembre et de ''Procès-verbal'' le 5 décembre</ref>. |
|||
Devant les menaces de désabonnements massifs de ses lecteurs, le directeur du journal cesse de soutenir Zola<ref>Zola, ''Combat pour Dreyfus'', p. 44</ref>.<br> |
|||
Le [[13 janvier]] [[1898]], scandalisé par l'acquittement d'Esterházy, Zola décide de procéder à un acte révolutionnaire. |
|||
Il publie en première page de ''[[L'Aurore (journal)|L'Aurore]]'', un énorme article de 4 500 mots, en forme de lettre ouverte, en forme de lettre ouverte au [[Liste des présidents de France|président]] [[Félix Faure]]. |
|||
Clemenceau, trouve le titre : '''''[[J'accuse]]'''''. |
|||
Vendu habituellement à trente mille exemplaires, le journal diffuse ce jour là près de trois cent mille copies. |
|||
Cet article fait l'effet d'une bombe.<br> |
|||
Le papier est une attaque directe, explicite et nommée. Tout le monde y passe : le ministre de la Guerre, l'État-major, bref tous les complices du complot qui ont envoyé le capitaine Dreyfus au bagne. |
|||
L'article lui même comporte de nombreuses erreurs, en majorant ou minorant les rôles de tel ou tel acteur. Le rôle du général Mercier est fortement sous-estimé. |
|||
L'auteur n'a pas prétendu faire œuvre d'historien<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 234</ref>. |
|||
Mais il apporte pour la première fois la réunion de toutes les données existantes sur l'Affaire<ref>Duclert, l'affaire Dreyfus, p. 42</ref>.<br> |
|||
Le but premier de Zola est de s'exposer volontairement afin de forcer les autorités à le traduire en justice. |
|||
Son procès servirait d'occasion pour un nouvel examen publique des cas Dreyfus et Esterházy. |
|||
Il va ici à l'encontre de la stratégie de Scheurer-Kestner et Lazare, qui prônaient la patience et la réflexion<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 236</ref>. <br> |
|||
Devant le succès national et international de ce coup d'éclat, le procès est inévitable. |
|||
À partir de ce moment critique, l'Affaire va suivre deux voies parallèles. D'une part, l'État va utiliser son appareil pour imposer la limitation du procès à une simple affaire de diffamation, afin de dissocier les cas Dreyfus et Esterházy, déjà jugés. |
|||
D'autre part, les conflits d'opinion tenteront de peser sur les juges ou le gouvernement, pour obtenir les uns la révision et les autres la condamnation de Zola. |
|||
Mais l'objectif du romancier est atteint : l'ouverture d'un débat public aux assises. |
|||
===Les procès Zola=== |
|||
[[Image:Zola Anthropo.jpg|thumb|left|220px|Photographie anthropomorphique d''''[[Émile Zola]]''' au moment de ses procès]]Le général [[Jean-Baptiste Billot|Billot]] porte plainte contre Zola qui passe devant les [[Assises]] de la Seine du [[7 février|7]] au [[23 février]] [[1898]]. |
|||
Le ministre ne retient que trois passages de l'article <ref>Miquel, Que sais-je, ''L'affaire Dreyfus'', p. 45</ref>, dix-huit lignes, qui en compte plusieurs centaines. |
|||
Il est reproché à Zola d'avoir écrit que le Conseil de guerre avait commis une « illégalité » « par ordre »<ref>Cour de Cassation, ''De la Justice...'', Pagès p. 143.</ref>. Le procès s’ouvre dans une ambiance terrible. |
|||
Les journaux se sont acharnés contre les partisans de Dreyfus en général et surtout contre Zola. |
|||
Il est traité d'italien, d'émigré et d'apatride. |
|||
Les passions se déchaînent, la population prend position plus nettement, manipulée par la presse.<br> |
|||
[[Fernand Labori]], l’avocat de Zola, fait citer environ deux cents témoins. |
|||
Le but de l’opération est de permettre aux dreyfusards de parler des anomalies du dossier Dreyfus. |
|||
C’est pour les avoir dénoncées ouvertement que Zola se retrouve devant les Assises. |
|||
Mais c'est aussi le moyen d'étaler dans la presse la réalité de l'Affaire Dreyfus, inconnue du public jusqu'à présent. |
|||
Plusieurs journaux<ref>''Le Siècle'' et ''L'Aurore''</ref> publient en effet les notes [[sténographie|sténographiques]] ''in extenso'' des débats presque en direct, ce qui édifie la population. |
|||
Ce sera aussi un outil incontestable dans les batailles futures, auquel les dreyfusards vont constamment se référer. |
|||
Mais pour l'heure, les nationalistes sont maîtres du palais et organisent des émeutes, forçant le préfet de police à intervenir afin de protéger les sorties de Zola à chaque audience<ref>Duclert, ''l'affaire Dreyfus'', p. 44</ref>.<br> |
|||
Ce procès est aussi le lieu d'une véritable bataille juridique, dans laquelle les droits de la défense sont sans cesse bafoués. |
|||
C'est le moment d'une prise de conscience pour beaucoup d'observateurs, celle de la collusion entre le monde politique et les militaires. |
|||
À l'évidence, la Cour a reçu des instructions pour étouffer les débats. |
|||
Le président Delegorgue apparaissant obnubilé par la longueur des audiences, doit jongler sans cesse avec le droit pour que le procès de 1894 ne soit surtout pas l'objet des interventions. Sa litanie célèbre, « la question ne sera pas posée » sera répétée des dizaines de fois<ref>[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62779w Voir l'intégralité des débats de 1898]</ref>. |
|||
Voici un échange parmi d'autres entre l'avocat de la défense et le président de la Cour d'assise : |
|||
[[Image:Zola sortie.jpg|thumb|300px|'''''Zola aux outrages''''', huile sur toile de Henry de Groux, 1898]] |
|||
{{citation3|Me Labori. - Mais j'ai une question à poser.<br> |
|||
M. Le président. - Vous ne la poserez pas.<br> |
|||
Me Labori. - J'insiste, monsieur le Président.<br> |
|||
M. Le président. - Je vous dis que vous ne la poserez pas.<br> |
|||
Me Labori. - Oh ! monsieur le Président ! Il est intéressant...<br> |
|||
M. Le président. - C'est inutile de crier si fort.<br> |
|||
Me Labori. - Je crie parce que j'ai besoin de me faire entendre.<br> |
|||
M. Le président. - La question ne sera pas posée.<br> |
|||
Me Labori. - Permettez, vous dites cela ; mais je dis que je veux la poser.<br> |
|||
M. Le président. - Eh bien ! je dis que non, et c'est une affaire entendue ! Le Président doit écarter du débat tout ce qui peut allonger les débats sans aucune utilité ; c'est mon droit de le faire.<br> |
|||
Me Labori. - Vous ne connaissez pas la question ; vous ne savez pas quelle est la question.<br> |
|||
M. Le président. - Je sais parfaitement ce que vous allez demander<ref>[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62779w Procès Zola, T1] p. 503-504</ref>.}} |
|||
De fait, on a bien parlé de l’Affaire, mais Zola est condamné à un an de prison et à 3 000 francs d'amende (c'est [[Octave Mirbeau]] qui paiera de sa poche les 7 525 francs, représentant le montant de l'amende et des frais de justice, le [[8 août]] [[1898]]). |
|||
Le procès Zola est un tournant qui permet la publicité des pièces et la mise en lumière de nombreuses contradictions.<br /> |
|||
Le [[2 avril]], une demande de pourvoi en cassation reçoit une réponse favorable. |
|||
Il s'agit de la première intervention de la Cour suprême dans cette affaire judiciaire, premier barrage à la raison d'État. |
|||
La plainte aurait en effet dû être portée par le Conseil de guerre et non par le ministre. |
|||
Le procureur général Manau est favorable à la révision du procès Dreyfus et s’oppose fermement aux antisémites. |
|||
Les juges du Conseil de guerre, mis en cause par Zola, portent plainte pour diffamation. |
|||
L’affaire est déférée à Versailles où, pense-t-on, le public est plus favorable à l’Armée, plus nationaliste. |
|||
Le [[23 mai]] [[1898]], dès la première audience, M{{e}} Labori se pourvoit en cassation en raison du changement de juridiction. |
|||
Le procès est ajourné et les débats sont repoussés au [[18 juillet]]. |
|||
Ce nouveau procès aboutit à une nouvelle condamnation des accusés ; Zola quitte la France et rejoint Londres. |
|||
Quant à Picquart, il se retrouve à nouveau en prison. |
|||
===La mort de Henry, le faussaire démasqué=== |
|||
[[Image:Faux Henry 1896.jpg|thumb|250px|left|Photographie du '''faux Henry'''. L'entête (mon cher ami) et la signature (Alexandrine) sont de Panizzardi (quadrillage). Le reste est de la main d'Henry.]] |
|||
L'acquittement d'Esterházy et les condamnations d'Émile Zola et de Georges Picquart, sans compter le fait qu'un innocent purge en ce moment même une peine indigne, ont un retentissement national et international considérables. |
|||
La France, démocrate et républicaine, patrie des droits de l'homme, qui prétend diffuser la philosophie humaniste des [[Droit naturel|Lumières]], expose un arbitraire étatique au bord de la caricature. |
|||
L'antisémitisme a fait des progrès considérables, et les émeutes sont courantes pendant toute l'année 1898. |
|||
Les révisionistes ont eux aussi progressé en exposant toutes les contradictions de l'Affaire. |
|||
Ils rassemblent autour d'eux de plus en plus d'indignés. <br> |
|||
[[Image:G Cavaignac.jpg|thumb|110px|right|Portrait de '''Godefroy Cavaignac''', ministre de la Guerre]] |
|||
[[Jacques Marie Eugène Godefroy Cavaignac|Godefroy Cavaignac]], nouveau ministre de la Guerre et anti-révisionniste farouche, veut démontrer une bonne fois pour toute la culpabilité de Dreyfus, en tordant le cou à Esterházy au passage. |
|||
Il le tient en effet pour « un mythomane et un maître chanteur »<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 287</ref>. |
|||
Cavaignac a l'honnêteté d'un doctrinaire intransigeant<ref>Thomas, ''l'Affaire sans Dreyfus'', T2, p.262</ref>, mais il ne connaît absolument pas les dessous de l'Affaire. |
|||
Il avait eu la surprise d'apprendre que l'ensemble des pièces sur lesquelles l'accusation se basait, n'avaient pas été expertisées. |
|||
Boisdeffre ayant « une confiance absolue » en Henry. |
|||
Alors il décide d'enquêter lui-même, dans son bureau avec ses adjoints, et rapatrie le dossier secret qui compte alors 365 pièces<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 279</ref>. |
|||
Il est absolument convaincu de la culpabilité de Dreyfus, renforcé dans cette idée par la légende des aveux, après avoir rencontré le principal témoin, le capitaine Lebrun-Renault<ref>Reinach, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75085t ''Histoire de l'affaire Dreyfus'', Tome 4] p. 5</ref>.<br> |
|||
Le [[7 juillet]] [[1898]], lors d'une interpellation à la Chambre, Cavaignac fait état de trois pièces « accablantes, entre mille ». |
|||
La conviction des députés est unanime, foudroyante<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 288</ref>. |
|||
Son discours est affiché dans les 36 000 communes de France, avec la reproduction des trois preuves. |
|||
Les antidreyfusards jubilent et portent Cavaignac en triomphe. Mais leur joie est de courte durée. <br> |
|||
Jaurès, dans un long article, démolit la démonstration du ministre. |
|||
Par ailleurs, le colonel Picquart écrit le [[8 juillet]] au président du Conseil : |
|||
{{citation3|Je suis en état d'établir devant toute juridiction compétente que les deux pièces portant la date de [[1894]] ne sauraient s'appliquer à Dreyfus et que celle qui portait la date de [[1896]] avait tous les caractères d'un faux.}} |
|||
Le ministre fait une nouvelle fois vérifier ses documents. |
|||
Le [[13 août]] au soir, coup de théâtre, le capitaine Cuignet découvre la supercherie. |
|||
La missive qui désigne Dreyfus en toutes lettres, la base des certitudes de l'État-major depuis deux ans, est un faux, un faux grossier, le ''faux Henry''. |
|||
Tout l'édifice s'écroule. |
|||
Cavaignac tente encore de trouver des raisons logiques à la culpabilité et la condamnation de Dreyfus, contre l'évidence<ref>Duclert, ''l'Affaire Dreyfus'', p. 48</ref>. |
|||
Mais tout à son honneur, il ne tait pas sa découverte.<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 301</ref><br> |
|||
Un conseil d'enquête est formé contre Esterházy, devant lequel celui-ci panique. |
|||
Il avoue ses rapports avec le commandants du Paty de Clam. |
|||
La collusion entre l'État-major et le traître est avérée. <br> |
|||
Le [[30 août]], Cavaignac se résigne à demander des explications au colonel Henry, en présence de Boisdeffre et Gonse. |
|||
Au bout d'une heure d'interrogatoire mené par me ministre lui-même, Henry s'effondre et fait des aveux complets<ref>Reinach, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75085t ''Histoire de l'affaire Dreyfus'', Tome 4] p. 183 et s.</ref>. Il est mis aux arrêts de forteresse au [[Mont-Valérien]]. Il se suicide<ref>Les circonstances du décès d'Henry ne sont toujours pas éclaircies et ont nourri quelques fantasmes. L'assassinat est peu probable. Miquel, ''l'Affaire Dreyfus'', Que sais-je ? p. 74</ref> le lendemain en se tranchant la gorge avec un rasoir. |
|||
Les généraux de Boisdeffre et Gonse démissionnent, « dupes de gens sans honneur ».<br> |
|||
Preuve de l'intoxication des esprits, apparaît alors la notion de « faux patriotique » et ''[[La Libre Parole]]'', journal violemment antisémite, lance une souscription au profit de sa veuve, ''le monument Henry''. Chaque donation est accompagnée de remarques lapidaires sur Dreyfus et les [[Dreyfusards]], témoignage de la bêtise et de la méchanceté humaines. Quatorze mille souscripteurs, dont 53 députés, envoyèrent 131 000 francs<ref>Miquel, ''L'affaire Dreyfus'', Que sais-je, p. 92</ref>. |
|||
La révision est désormais inévitable. |
|||
Pourtant, Cavaignac affirme : « moins que jamais ! » |
|||
Mais le président du Conseil, [[Henri Brisson]], le force à démissionner. |
|||
Malgré son rôle, apparemment totalement involontaire, dans la révision du procès de 1894, il restera un antidreyfusard convaincu et fera une intervention méprisante et blessante envers Dreyfus au procès de Rennes.<br> |
|||
Le gouvernement transfert donc le dossier à la Cour de cassation, pour avis sur les quatre années de procédures passées. |
|||
===La révision inéluctable provoque une crise du régime=== |
|||
====Le régime au bord de l'implosion==== |
|||
Henry est mort, Boisdeffre a démissionné, Gonse n'a plus aucune autorité et du Paty a été très gravement compromis par Esterházy : pour les conjurés, c'est la débâcle<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 307</ref>. |
|||
Le gouvernement est désormais pris entre deux feux : la loi et le droit contre la pression nationaliste de la rue et du commandement supérieur qui se reprend. <br> |
|||
Le [[3 septembre]] [[1898]], le président du Conseil, Brisson, incite Mathieu Dreyfus à déposer une demande en révision du Conseil de guerre de [[1894]]. Cavaignac, démissionné, pour avoir continué à répandre sa vision antidreyfusarde de l'affaire, se pose en chef de file antirévisionniste. C'est la crise politique. Le général [[Émile Auguste François Zurlinden|Zurlinden]] lui succède. |
|||
Mais « travaillé » par l'État-major, il est vite « retourné » et rend un avis négatif à la révision le [[10 septembre]], conforté par la presse extrémiste pour laquelle, « la révision, c'est la guerre ».<br> |
|||
L'obstination du gouvernement, qui vote le recours à la Cour de cassation le [[26 septembre]], amène la démission de Zurlinden, remplacé aussitôt par le général Chanoine<ref>Duclert, ''L'affaire Dreyfus'', p.50</ref>.<br> |
|||
Celui-ci, lors d'une interpellation à la [[Chambre des députés (France)|Chambre]], donne sa démission, la confiance étant refusée à Brisson, contraint lui aussi à la démission. Le discrédit est total.<br> |
|||
Le [[4 novembre]], le progressiste [[Charles Dupuy]] est nommé à sa place. |
|||
Quatre ans plus tôt, il avait couvert les agissements du général Mercier aux débuts de l'affaire Dreyfus ; mais aujourd'hui, il annonce qu'il suivra les arrêts de la Cour de cassation, barrant la route à ceux qui veulent étouffer la révision et dessaisir la Cour.<br> |
|||
le [[5 décembre]], à la faveur d'un débat à la Chambre sur la transmission du « dossier secret » à la Cour de cassation, la tension monte encore d'un cran. |
|||
Les injures, invectives et autres violences nationalistes font place aux menaces de soulèvement. [[Paul Déroulède]] déclare : « s'il faut faire la guerre civile, nous la feront. » |
|||
Une nouvelle crise survient au sein même de la Cour de cassation, dès lors que Quesnay de Beaurepaire, président de la chambre civile, accuse la chambre criminelle de dreyfusisme par voie de presse. Il démissionne le [[8 janvier]] [[1899]] en héros de la cause nationaliste. Cette crise aboutit au dessaisissement de la chambre criminelle au profit des chambres réunies. C'est le blocage de la révision<ref>Duclert, ''L'affaire Dreyfus'', p. 53</ref>. |
|||
Survient alors un de ces clins d'œil de l'Histoire, qui, sous des dehors de scandale mondain, amènent subitement une issue devant la muraille. Le [[16 février]] [[1899]] le président de la République [[Félix Faure]] décède dans des conditions rocambolesques. [[Émile Loubet]] est élu, une avancée pour la cause de la révision, car le précédent président en était un farouche opposant. Le [[23 février]], à la faveur des funérailles de Félix Faure, Paul Déroulède tente un coup de force sur l'[[Palais de l'Élysée|Élysée]]. C'est un échec, les militaires ne s'étant pas ralliés en définitive. La République tremble mais ne s'écroule pas. |
|||
Le [[28 février]], [[Waldeck-Rousseau]] s'exprime au Sénat sur le fond et dénonce la « conspiration morale » au sein du gouvernement et dans la rue. La révision n'est plus évitable. |
|||
====La Cour de cassation rend la Justice==== |
|||
[[Image:Cassation Dreyfus.jpg|thumb|left|250px|Les magistrats de la '''chambre criminelle''' dans ''Le Petit Journal'']] |
|||
Dans ce contexte de grave crise républicaine, alimentée de campagnes de presse grossièrement conflictuelles à l'encontre de la chambre criminelle<ref>Miquel, ''L'affaire Dreyfus'', Que sais-je, p. 91</ref>, la Cour de cassation va commencer à rendre la Justice. |
|||
Les magistrats qui payaient encore le désastre du [[scandale de Panamá]], étaient constamment traînés dans la boue dans les journaux nationalistes.<br /> |
|||
Le [[26 septembre]] [[1898]], après à un vote du Cabinet, le garde des Sceaux saisit la Cour de cassation.<br /> |
|||
Le [[29 octobre]], à l'issue de la communication du rapport du rapporteur Alphonse Bard, la chambre criminelle de la Cour déclare « la demande recevable et dit qu'il sera procédé par elle à une instruction supplémentaire »<ref>Cour de cassation, ''La première révision'', Royer-Ozaman, p. 182</ref>. <br> |
|||
Le rapporteur Louis Loew préside. Il est l'objet d'une très violente campagne d'injures antisémite, alors qu'il est [[Protestantisme|protestant]] alsacien, accusé d'être un déserteur, un vendu aux Prussiens. |
|||
Malgré les silences complaisants de Mercier, Billot, Zurlinden et Roget qui se retranchent derrière l'autorité de la chose jugée et le secret d'État, la compréhension de l'Affaire s'illumine de détails ignorés auparavant. |
|||
Cavaignac fait une déposition de deux jours, mais ne parvient pas à démontrer la culpabilité de Dreyfus. |
|||
Au contraire il le disculpe aussi brillamment qu'involontairement par une démonstration de la datation exacte du bordereau (août 1894). |
|||
Puis Picquart démontre par sa calme précision l'ensemble des rouages de l’erreur puis de la conspiration.<br> |
|||
Dans une décision du [[8 décembre]] [[1898]] en représailles au dessaisissement qui s'annonce, Picquart est écarté du Conseil de guerre par la chambre criminelle. |
|||
C'est un nouvel obstacle aux volontés souveraines de l’État-major. |
|||
Une nouvelle campagne de presse furieusement antisémite éclate à cette nouvelle. |
|||
Le travail d'enquête est tout de même repris par la chambre criminelle<ref>Duclert, ''L'affaire Dreyfus'', p. 52</ref>. |
|||
Le « dossier secret » est analysé à partir du [[30 décembre]], et la chambre demande la communication du dossier diplomatique, ce qui est accordé.<br> |
|||
Parallèlement, pour faire suite à l'incident de Beaurepaire, le président Mazeau instruit une enquête sur la chambre criminelle, qui aboutira au dessaisissement de celle-ci « afin de ne pas la laisser porter seule toute la responsabilité de la sentence définitive ».<br> |
|||
Le [[9 février]], la chambre criminelle rend son rapport en mettant en exergue deux faits majeurs : il est certain qu'Esterházy a utilisé le même papier pelure que le bordereau<ref>La Cour a fait réaliser plusieurs expertises scientifiques minutieuses afin de conclure à des certitudes.</ref> et le dossier secret est totalement vide. |
|||
Ces deux fait majeurs anéantissent à eux seuls toute les procédures à l'encontre d'Alfred Dreyfus. |
|||
Mais une loi de dessaisissement prive la chambre criminelle de la poursuite des actions qui découleraient de son rapport.<br> |
|||
Le [[1er mars]] [[1899]], le nouveau président de la chambre civile de la Cour de cassation, Alexis Ballot-Beaupré est nommé rapporteur pour l'examen de la demande de révision. |
|||
Il aborde le dossier en juriste et décide d'un supplément d'enquête. Dix témoins complémentaires sont interrogés, lesquels affaiblissent encore la version de l'État-major. Dans le débat final et par un modèle d'objectivité, le président Ballot-Beaupré détruit la seule pièce à charge contre Dreyfus : le bordereau. |
|||
Le procureur Manau abonde dans le sens du président. |
|||
M{{e}} Mornard qui représente Lucie Dreyfus plaide sur du velours<ref>[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k24254t v. ''Débats de la Cour de Cassation en vue de la révision'']</ref>.<br> |
|||
Le [[3 juin]] [[1899]], les chambres réunies de la Cour de cassation cassent le jugement de [[1894]] en audience solennelle<ref>[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k24254t v. arrêt de la Cour du 3 juin 1899]</ref>. |
|||
L’affaire est renvoyée devant le Conseil de guerre de Rennes. |
|||
Les conséquences sont immédiates : Zola, exilé en Angleterre, revient en France, Picquart est libéré, Mercier est accusé de communication illégale de pièces.<br> |
|||
Par cet arrêt, la Cour de cassation s'impose comme une véritable autorité, capable de tenir tête à l'armée et au pouvoir politique<ref>Cour de cassation, ''La première révision'', Royer et Ozaman, p. 210</ref>.<br> |
|||
Pour de nombreux Dreyfusards cette décision de justice est l'anti-chambre de l'acquittement du martyre. |
|||
C'est sans doute oublier un peu vite que la Cour place le destin de l'accusé entre les mains d'une armée humiliée. |
|||
On a démontré ses grossières erreurs, et même, plusieurs de ses membres sont des faussaires avérés. |
|||
Dès lors, le débat portera sur le respect strict ou non de l'arrêt de renvoi par le Conseil de guerre. |
|||
L'organe militaire a-t-il une autonomie juridique comme l'affirme à dessein la presse nationaliste ? |
|||
Reste que la Cour, en cassant avec renvoi, a cru en la Justice souveraine et universellement partagée. |
|||
Elle a oublié, ou feint d'oublier que l'esprit de corps peut obéir à d'autres lois<ref>Cour de cassation, ''La première révision'', Royer et Ozaman, p. 211</ref>. |
|||
== Le procès de Rennes 1899== |
|||
===Déroulement du procès=== |
|||
[[Image:Port Haliguen (2).JPG|thumb|left|Port Haliguen à [[Quiberon]] où Dreyfus débarque en juin 1899]] |
|||
[[Image:Demange Labori.jpg|thumb|200px|La défense de Dreyfus à Rennes : '''Edgar Demange''' et '''Fernand Labori''']] |
|||
Le prisonnier n'était au courant en rien des événements qui se déroulaient à des milliers de kilomètres de lui. |
|||
Ni des complots ourdis pour que jamais il ne puisse revenir, ni de l'engagement d'innombrables honnêtes hommes et femmes à sa cause. L'administration pénitentiaire avait filtré des informations qu'elle jugeait confidentielles, véritable abus de pouvoir. |
|||
À la fin de l'année [[1898]], il apprend avec stupéfaction la dimension réelle de l'Affaire, dont il ignorait tout : l'accusation de Mathieu contre Esterházy, son acquittement, l'aveu et le suicide d'Henry, ceci à la lecture du dossier d'accusation de la Cour de cassation qu'il reçoit deux mois après sa publication<ref>Duclert, ''Alfred Dreyfus'', p. 543</ref>.<br> |
|||
Le [[5 juin]] [[1899]], Alfred Dreyfus est prévenu de la décision de cassation du jugement de [[1894]]. |
|||
Le [[9 juin]], il quitte l'[[île du diable]], cap vers la France, enfermé dans une cabine comme un coupable qu'il n'est pourtant plus. |
|||
Il débarque le [[30 juin]] à Port Haliguen, sur la presqu'île de [[Quiberon]], dans le plus grand secret « par une rentrée clandestine et nocturne »<ref>Jean Jaurès, in ''L'Humanité'' du 4 juillet 1899</ref>. Après cinq années de martyre, Il retrouve le sol natal, mais enfermé dès le 1{{er}} juillet à la prison militaire de [[Rennes]]. |
|||
Il est déféré le [[7 août]] devant le Conseil de guerre de la capitale bretonne.<br> |
|||
Le Général Mercier, champion des antidreyfusards, intervient constamment dans la presse, pour affirmer l'exactitude du premier jugement : Dreyfus est bien le coupable.<br> |
|||
Immédiatement, des dissensions se font jour dans la défense de Dreyfus. |
|||
Ses deux avocats sont sur des stratégies opposées. |
|||
M{{e}} Demange souhaite jouer la défensive et obtenir simplement l'acquittement de Dreyfus. |
|||
M{{e}} Labori, brillant avocat de 35 ans cherche à frapper plus haut, il veut la défaite de l'État-major, son humiliation publique. |
|||
Mathieu Dreyfus a imaginé une complémentarité entre les deux avocats. |
|||
Le déroulement du procès montrera l'erreur, dont va se servir l'accusation devant une défense si affaiblie.<br> |
|||
[[Image:Dreyfus-rennes2.jpg|thumb|250px|left|Le procès d''''[[Alfred Dreyfus]]''' au Conseil de guerre de '''Rennes''']] |
|||
Le procès s’ouvre le [[7 août]] [[1899]] dans un climat de violence inouïe. |
|||
Rennes est en état de siège<ref>Mathieu Dreyfus, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k24254t L'Affaire...], pp. 206 et s.</ref>. |
|||
Les juges du Conseil de guerre sont sous pression. |
|||
Esterházy, qui a avoué la paternité du bordereau, en exil en Angleterre, et du Paty, se sont fait excuser. Dreyfus apparaît, l’émotion est forte. Son apparence physique bouleverse ses partisans et certains de ses adversaires<ref>Maurice Barres fait une description poignante de Dreyfus</ref>. Malgré sa condition physique dégradée, il a une maîtrise complète du dossier, acquise en seulement quelques semaines<ref>Duclert, ''Alfred Dreyfus'', p. 562</ref>.<br> |
|||
Tout l'État-major témoigne contre Dreyfus sans apporter aucune preuve. |
|||
On ne fait que s’entêter et on considère comme nuls les aveux d’Henry et d’Esterházy. |
|||
Pourtant, Mercier se fait huer à la sortie de l'audience. |
|||
La presse nationaliste et antidreyfusarde se perd en conjectures sur son silence à propos de la preuve décisive dont il n'avait cessé de faire état avant le procès<ref>Le pseudo bordereau annoté par le Kayser, dont personne ne verra jamais aucune preuve.</ref>. |
|||
Le [[14 août]], M{{e}} Labori est victime d'un attentat sur son parcours vers le tribunal. Il se fait tirer dans le dos par un extrémiste qui s'enfuit. |
|||
Il est écarté des débats pendant plus d'une semaine, au moment décisif de l'interrogatoire des témoins. |
|||
Le [[22 août]], il est de retour. |
|||
Les incidents entre les deux avocats de Dreyfus se multiplient, Labori reprochant à Demange sa trop grande prudence. <br> |
|||
Le gouvernement, devant le raidissement militaire du procès pouvait agir encore de deux manières pour infléchir les événements ; en faisant appel à un témoignage de l'[[Allemagne]] ou par l'abandon de l'accusation<ref>Cour de Cassation, ''De la Justice...'', Joly, p. 231</ref>. |
|||
Mais ces tractations en arrière plan sont sans résultats. |
|||
L'ambassade d'Allemagne adresse un refus poli au gouvernement. <br> |
|||
Le ministre de la guerre, le général [[Galliffet]], fait envoyer un mot respectueux au commandant Carrière, procureur à Rennes. |
|||
Il lui demande de rester dans l'esprit de l'arrêt de révision de la Cour de cassation. |
|||
L'officier feint de ne pas comprendre l'allusion et aidé de l'avocat nationaliste Auffray, âme véritable de l'accusation, il fait un réquisitoire contre Dreyfus.<br> |
|||
Du côté de la défense, il faut prendre une décision, car l'issue du procès s'annonce mal. |
|||
Malgré l'évidence de l'absence de charges contre l'accusé. |
|||
Au nom du président du Conseil, Waldeck-Rousseau, aidé de Jaurès et Zola, M{{e}} Labori est convaincu de renoncer à sa plaidoirie pour ne pas heurter l'armée. |
|||
On décide de jouer la conciliation en échange de l'acquittement que semble promettre le gouvernement. Mais c'est un nouveau jeu de dupes<ref>Duclert, ''L'affaire Dreyfus'', p. 60</ref>. |
|||
M{{e}} Demange, seul et sans illusions, assure la défense de Dreyfus, dans une atmosphère de guerre civile. <br /> |
|||
A Paris, les agitateurs antisémites et nationalistes d’Auteuil sont arrêtés. [[Jules Guérin]] et ceux qui se sont enfuis et retranchés dans le [[Fort Chabrol]] sont assaillis par la police. |
|||
===Nouvelle condamnation=== |
|||
[[Image:Dreyfus proteste.jpg|thumb|left|Nouvelle condamnation pour'''[[Alfred Dreyfus]]''']] |
|||
Le [[8 septembre]] [[1899]], la Cour rend son verdict : Dreyfus est reconnu coupable de trahison mais « avec circonstances atténuantes » (par 5 voix contre 2) et condamné à dix ans de réclusion et à une nouvelle dégradation. Ce verdict est au bord de l'acquittement à une voix près, puisque le code de justice militaire prévoyait le principe de minorité de faveur à trois voix contre quatre<ref>Doise, ''Histoire militaire...'', p. 159</ref>.<br /> |
|||
Ce verdict absurde<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 544</ref> a les apparences d'un aveu coupable des membres du Conseil de guerre. |
|||
Ils semblent ne pas vouloir renier la décision de [[1894]], et savent bien que le dossier ne repose que sur du vent. |
|||
Mais c'est surtout un verdict habile car tout en ménageant leurs pairs ainsi que les modérés angoissés par les risques de guerre civile, la Cour reconnaît implicitement l'innocence de Dreyfus (Peut-on trahir avec des circonstances atténuantes ?)<ref>Duclert, L'affaire Dreyfus, p. 61</ref>. |
|||
Le lendemain du verdict, Alfred Dreyfus, après avoir beaucoup hésité, dépose un pourvoi en révision. |
|||
Waldeck-Rousseau, dans une position difficile, aborde pour la première fois la grâce. Pour Dreyfus, c'est accepter la culpabilité. |
|||
Mais à bout de force, éloigné des siens depuis trop longtemps, il accepte. |
|||
Le décret est signé le [[19 septembre]] et il est libéré le [[21 septembre]] [[1899]]. |
|||
Nombreux sont les dreyfusards frustrés par cet acte final. |
|||
L'opinion publique accueille cette conclusion de manière indifférente. |
|||
La France aspire à la paix civile et à la concorde à la veille de [[Expositions universelles de Paris|l'exposition universelle de 1900]] et avant le grand combat que la République s'apprête à mener pour la [[Association loi de 1901|liberté des associations]] et la [[Séparation des Églises et de l'État en 1905|laïcité]]. |
|||
C'est dans cet esprit que le [[17 novembre]] 1899, Waldeck-Rousseau dépose une loi d’amnistie couvrant « tous les faits criminels ou délictueux connexes à l’Affaire Dreyfus ou ayant été compris dans une poursuite relative à l’un de ces faits ». |
|||
Les dreyfusards s’insurgent, ils ne peuvent accepter que les véritables coupables soient absous de leurs crimes d'État, alors même que Zola et Picquart doivent toujours passer en jugement. |
|||
Malgré d'immenses protestations, la loi est adoptée. |
|||
Il n’existe alors plus aucun recours possible pour obtenir que l’innocence de Dreyfus soit reconnue ; il faut désormais trouver un fait nouveau pouvant entraîner la révision. |
|||
===Réactions=== |
|||
Les réactions en [[France]], sont vives, faites de « stupeur et de tristesse » dans le camp révisionniste<ref>Bredin, ''L'Affaire'', p. 395</ref>. Pourtant d'autres réactions tendent à montrer que le « verdict d'apaisement » rendu par les juges est compris et accepté par la population. |
|||
Les Républicains cherchent avant tout la paix sociale, pour tourner la page de cette longue affaire extrêmement polémique. |
|||
Aussi, les manifestations sont très peu nombreuses en province, alors que l'agitation persiste quelque peu à Paris<ref>Bredin, ''L'Affaire'', p. 404</ref>.<br> |
|||
Dans le monde militaire, l'appaisement est aussi de rigueur. |
|||
Deux des sept juges ont voté l'acquittement<ref>Il s'agissait du président du Conseil de guerre et du commandant de Bréon</ref>. |
|||
Ils ont refusé de céder à l'ordre militaire implicite. |
|||
Ceci est aussi clairement perçu. Dans une apostrophe à l'armée, Galliffet annonce : « l'incident est clos ».<br> |
|||
Dans vingt capitales étrangères, des manifestations anti-françaises ont lieu, la presse est scandalisée<ref>Miquel, ''Affaire Dreyfus'', Que sais-je ? p. 114</ref>. |
|||
Les réactions sont de deux ordres. Les Anglo-saxons, légalistes, se focalisent sur l'affaire d'espionnage et contestent assez violemment ce verdict de culpabilité sans arguments positifs à son édification. |
|||
À ce titre, le rapport du ''[[Lord Chief Justice]]'' d'Angleterre, [[Lord Russell of Killowen]], à la [[reine Victoria]], le [[16 septembre]] [[1899]] est un symbole de la répercussion mondiale de ''l'Affaire'' en [[Grande-Bretagne]]. |
|||
Le magistrat anglais, qui s'était rendu en observateur à Rennes, critique les faiblesses du Conseil de Guerre : |
|||
{{citation3| Les juges militaires « n'étaient pas familiers de la loi » [...]. Ils manquaient de l'expérience et de l'aptitude qui permettent de voir la preuve derrière le témoignage. [...] Ils agirent en fonction de ce qu'ils considéraient comme l'honneur de l'armée. [...] ils accordèrent trop d'importance aux fragiles allégations qui furent seules présentées contre l'accusé. Ainsi conclut-il : Il parait certain que si le procès de révision avait eu lieu devant la [[Cour de cassation (France)|Cour de cassation]], Dreyfus serait maintenant un homme libre.}}<br> |
|||
En [[Allemagne]] et en [[Italie]], les deux pays largement mis en cause par les procès contre Dreyfus, c'est le soulagement. |
|||
Même si l'Empereur d'Allemagne regrette que l'innocence de Dreyfus n'ait pas été reconnue, la normalisation des relations franco prussiennes qui s'annonce est vue comme détente bienvenue. Aucune des nations n'a intérêt à une tension permanente. |
|||
La diplomatie des trois puissances, avec l'aide de l'Angleterre, va s'employer à détendre une atmosphère qui ne se dégradera à nouveau qu'à vielle de la [[Première Guerre mondiale]]. |
|||
<br> |
|||
Cette conclusion judiciaire a aussi une conséquence funeste sur les relations entre la famille Dreyfus, et la branche ultra des dreyfusistes. Fernand Labori, Jaurès et Clemenceau, avec le consentement du général Picquart, reprocheront ouvertement à Alfred Dreyfus d'avoir accepté la grâce et d'avoir mollement protesté à la loi d'amnistie. |
|||
En deux ans après cette conclusion, leur amitié se finissait ainsi, en de sordides calculs<ref>Bredin, ''L'Affaire'', p. 411</ref>. |
|||
==La longue marche vers la réhabilitation - 1900-1906== |
|||
Préférant éviter un troisième procès, le gouvernement décide de [[grâce présidentielle|gracier]] Dreyfus, décret que signe le président Loubet le [[19 septembre]] [[1899]], après de multiples tergiversations. |
|||
Dreyfus n'est pas pour autant innocenté. Le processus de réhabilitation ne sera achevé que six années plus tard, sans éclat ni passion. De nombreux ouvrages paraissent pendant cette période. Outre les mémoires d'Alfred Dreyfus <ref>''Cinq années de ma vie''</ref>, Reinach fait paraître son ''Histoire de l'Affaire Dreyfus'', et Jaurès publie ''Les Preuves''. Quant à Zola, il écrit le troisième de ses ''Évangiles'' : ''Vérité''. Même [[Esterhazy|Esterházy]] en profite par des confidences et vend plusieurs versions différentes des textes de sa déposition au consul de France<ref>Bredin, L'Affaire, p. 414</ref>.<br> |
|||
===Décès de Zola=== |
|||
Un drame de tragédie grecque survient le [[30 septembre]] [[1902]]. [[Zola]], l'initiateur de l'Affaire, le premier des intellectuels dreyfusard, meurt asphyxié par la fumée de sa cheminée. Son épouse, Alexandrine, en réchappe de justesse<ref>Bredin, ''L'Affaire'', p. 417</ref>.<br> |
|||
C'est le choc dans le clan des dreyfusards.<br> |
|||
[[Anatole France]], qui a exigé que Dreyfus soit présent aux obsèques, alors que le Préfet de police souhaitait son absence « pour éviter les troubles », lit sa célèbre oraison funèbre à l'auteur de [[J'accuse]] : |
|||
[[Image:Anatole France Oseques Zola.jpg|thumb|left|250px|Les osèques de Zola où '''[[Anatole France]]''' dit l'hommage à son ami.]] |
|||
{{citation3|Devant rappeler la lutte entreprise par Zola pour la justice et la vérité, m'est-il possible de garder le silence sur ces hommes acharnés à la ruine d'un innocent et qui, se sentant perdus s'il était sauvé, l'accablaient avec l'audace désespérée de la peur ? <br> |
|||
Comment les écarter de votre vue, alors que je dois vous montrer Zola se dressant, faible et désarmé devant eux ? <br> |
|||
Puis-je taire leurs mensonges ? |
|||
Ce serait taire sa droiture héroïque. <br> |
|||
Puis-je taire leurs crimes ? |
|||
Ce serait taire sa vertu.<br> |
|||
Puis-je taire les outrages et les calomnies dont ils l'ont poursuivi ? |
|||
Ce serait taire sa récompense et ses honneurs.<br> |
|||
Puis-je taire leur honte ? |
|||
Ce serait taire sa gloire.<br> |
|||
Non, je parlerai. <br> |
|||
Envions-le : il a honoré sa patrie et le monde par une œuvre immense et un grand acte. <br> |
|||
Envions-le, sa destiné et son cœur lui firent le sort le plus grand. <br> |
|||
Il fut un moment de la conscience humaine.}} |
|||
===La réhabilitation=== |
|||
Les élections de [[1902]] avaient vu la victoire des gauches. C'est [[Jean Jaurès]], réélu, qui relance l'Affaire le [[7 avril]] [[1903]] alors que la France la pensait enterrée à jamais. |
|||
Dans un discours, Jaurès évoque la longue liste des faux qui parsèment le dossier Dreyfus, et insiste particulièrement sur deux pièces saillantes : |
|||
*La lettre de démission du général de Pellieux, rédigée en termes très durs. Juridiquement, elle a les formes d'un aveu de la collusion de l'État-major : |
|||
{{citation3|Dupe de gens sans honneurs, ne pouvant plus compter sur la confiance des subordonnés sans laquelle le commandement est impossible, et de mon côté, ne pouvant avoir confiance en ceux de mes chefs qui m'ont fait travailler sur des faux, je demande ma mise à la retraite.}} |
|||
*Le bordereau prétendument annoté (par Guillaume II) auquel le général Mercier avait fait allusion au procès de Rennes, et dont le fait rapporté par la presse aurait influencé les juges du Conseil de guerre<ref>Doise, ''L'histoire militaire...'', p. 160</ref>{{,}}<ref>Duclert, ''L'affaire Dreyfus'', p. 104</ref>.<br> |
|||
Devant ces faits nouveaux, le général André, nouveau ministre de la Guerre, mène une enquête à l'instigation d'[[Émile Combes]], assisté de magistrats. |
|||
L'enquête est menée par le capitaine Targe, officier d'ordonnance du ministre. |
|||
A l'occasion de perquisitions à la Section de statistiques, il découvre de très nombreuses pièces dont la majorité sont des faux fabriqués<ref>Cour de cassation, De la justice..., Becker, p. 262 </ref>.<br> |
|||
En novembre [[1903]], un rapport est remis au garde des Sceaux par le ministre de la Guerre. |
|||
C'était le respect des règles, dès lors que le ministre constate une erreur commise en Conseil de guerre. |
|||
C'est le début d'une nouvelle révision, avec une véritable enquête qui va durer deux ans. |
|||
== Le dénouement judiciaire == |
|||
[[Image:Port Haliguen (2).JPG|thumb|left|Port Haliguen à [[Quiberon]]]] |
|||
{{Wikisource|Affaire Dreyfus - arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 1906|Texte du second arrêt}} |
{{Wikisource|Affaire Dreyfus - arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 1906|Texte du second arrêt}} |
||
Les années [[1904]] et [[1905]] sont consacrées aux différentes phases judiciaires devant la Cour de cassation. |
|||
Alfred Dreyfus débarque le [[1er juillet|1{{er}} juillet]] [[1899]] en France et se présente le [[8 août]] devant le Conseil de guerre à [[Rennes]]. L'un de ses avocats, Maître [[Fernand Labori|Labori]] est blessé par coup de feu. Le [[8 septembre]], la cour rend son jugement : il est reconnu coupable de trahison mais « avec des circonstances atténuantes » (par 5 voix sur 7) et condamné à dix ans d'emprisonnement. |
|||
La cour emploie trois moyens (causes) à la révision : |
|||
*démonstration de la falsification du [[télégramme de Panizzardi]]. |
|||
*démonstration du changement de date d'une pièce du procès de 1894 (avril 1895 changé en avril 1894). |
|||
*démonstration du fait que Dreyfus n'avait pas fait disparaître les minutes d'attribution de l'artillerie lourde aux armées. |
|||
Concernant l'écriture du [[bordereau]], la cour est particulièrement sévère à l'encontre de [[Bertillon]] qui a « raisonné mal sur des documents faux ». Le rapport démontre que l'écriture est bien d'Esterházy, ce que ce dernier a d'ailleurs avoué entre-temps. |
|||
Enfin, la Cour démontre par une analyse complète et subtile du bordereau l'inanité de cette construction purement intellectuelle, et une commission de quatre généraux dirigée par un spécialiste de l'artillerie, le général Sebert, affirme « qu'il est fortement improbable qu'un officier d'artillerie ait pu écrire cette missive »<ref>Cour de Cassation, ''De la Justice...'', Becker, p. 267</ref>.<br> |
|||
Le [[9 mars]] [[1905]], le procureur général Baudouin rend un rapport de 800 pages dans lequel il réclame la cassation sans renvoi et fustige l'armée, amorçant un dessaisissement de la justice militaire qui trouvera sa conclusion en 1982<ref>Duclert, L'affaire Dreyfus, p. 108</ref>. |
|||
Le rapport du ''[[Lord Chief Justice]]'' d'Angleterre, [[Lord Russell of Killowen]], à la [[reine Victoria]], le [[16 septembre]] [[1899]] est un symbole de la répercussion mondiale de ''l'Affaire''. Le magistrat anglais, qui s'était rendu en observateur au Conseil de guerre de Rennes, critique les faiblesses d'un tel tribunal : {{citation| Les juges militaires ''n'étaient pas familiers de la loi'' [...]. ''Ils manquaient de l'expérience et de l'aptitude qui permettent de voir la preuve derrière le témoignage.'' [...] ''Ils agirent en fonction de ce qu'ils considéraient comme l'honneur de l'armée.'' [...] ''ils accordèrent trop d'importance aux fragiles allégations qui furent seules présentées contre l'accusé.''}}. Ainsi conclut-il : {{citation|''Il parait certain que si le procès de révision avait eu lieu devant la [[Cour de cassation (France)|Cour de cassation]], Dreyfus serait maintenant un homme libre.''}} |
|||
Il faut attendre le [[12 juillet]] [[1906]] pour que la Cour de cassation, toutes chambres réunies, annule sans renvoi le jugement rendu à [[Rennes]] en [[1899]] et prononce « l'arrêt de réhabilitation du capitaine Dreyfus ». |
|||
Les antidreyfusards crièrent à la réhabilitation à la sauvette. |
|||
Mais le but était évidemment politique : il s'agissait d'en finir et de tourner la page définitivement. |
|||
Rien ne pouvait entamer la conviction des adversaires de Dreyfus. |
|||
Cette forme était donc la plus directe et la plus définitive. |
|||
Il faut noter que ce qui est annulé est non seulement l'arrêt de Rennes, mais toute la chaîne des actes antérieurs, à commencer par l'ordre de mise en jugement donné par le général [[Saussier]] en [[1894]]. |
|||
La Cour s'est focalisée sur les aspects juridiques uniquement et constate que Dreyfus ne doit pas être renvoyé devant un Conseil de guerre pour la simple raison qu'il n'aurait jamais dû y passer, devant l'absence totale de charges. |
|||
{{citation3|Attendu, en dernière analyse, que de l'accusation portée contre Dreyfus, rien ne reste debout ; et que l'annulation du jugement du Conseil de guerre ne laisse rien subsister qui puisse à sa charge être qualifié crime ou délit ; dès lors, par application du paragraphe final de l'article 445 aucun renvoi ne doit être prononcé.}} |
|||
Dreyfus est réintégré partiellement dans l'armée au grade de chef d'escadron par la loi du 13 juillet 1906. |
|||
Préférant éviter un troisième procès, le président Loubet, accorde sa [[grâce présidentielle]] à Dreyfus, le [[19 septembre]]. Dreyfus n'est pas pour autant innocenté. Entre temps a lieu l'affaire du « [[Fort Chabrol]] », dernier coup d'éclat des antidreyfusards. Il faut attendre le [[12 juillet]] [[1906]] pour que, comme le préconisait Lord Russell of Killowen, la Cour de cassation annule {{citation|sans renvoi}} le jugement de Dreyfus, notamment grâce à l'affaire du [[Télégramme de Panizzardi]]. Ainsi, le colonel est complètement réhabilité. Dreyfus, qui n’a pas eu la promotion qu’il désirait dans l’armée, qu’il aurait d’ailleurs eue s’il n’avait pas été condamné, démissionne de l’armée. Officier de réserve, il participe à la [[guerre de 1914-1918]] et meurt en 1935. |
|||
Cette décision brisa tout espoir d'une carrière digne de ses succès antérieurs à son arrestation de 1894. |
|||
Il fut contraint à la démission en juin 1907. |
|||
Cette blessure, la dernière, ne fut-elle pas la pire ? |
|||
Les magistrats ne pouvaient rien contre cette ultime injustice volontairement commise. |
|||
Le droit et l'égalité avaient été encore une fois bafoués<ref>Cour de cassation, ''De la justice...'', Canivet, premier président, p. 12</ref>. |
|||
Il est à noter que Dreyfus n'a jamais demandé aucun dédommagement à l'état, ni dommages et intérêts à qui que ce soit. |
|||
La seule chose qui lui importait, c'était la reconnaissance de son innocence. |
|||
Officier de réserve, il participe à la [[guerre de 1914-1918]] au camp retranché de Paris, puis comme chef d'un parc d'artillerie. |
|||
Il termine sa carrière militaire au grade de colonel<ref>Duclert, ''L'affaire Dreyfus'', p. 111</ref>. |
|||
Il décède le 11 juillet 1935.<br> |
|||
Le [[colonel Picquart]] est lui aussi réhabilité officiellement et réintégré dans l'armée au grade de général de brigade. |
|||
Ironie de l'histoire, il sera nommé ministre de la Guerre en 1906 dans le gouvernement Clemenceau jusqu'en 1909. |
|||
Il décèdera en 1914 d'un accident de cheval<ref>Dictionnaire de l'affaire Dreyfus, entrée ''Picquart'', p. 263</ref>. |
|||
==Notes et références== |
|||
== Hannah Arendt et l’Exposition universelle de 1900 == |
|||
{{Références|colonnes = 4}} |
|||
La philosophe [[Hannah Arendt]] refuse de croire en la force, la profondeur et la sincérité du mouvement d'indignation de plus en plus massif des antidreyfusards en France . Elle prétend que c’est l’organisation de l’[[Exposition Universelle]] de 1900 à [[Paris]] qui eut un rôle décisif dans le règlement de l’affaire Dreyfus. C’est devant l’imminence de cet événement aux répercussions internationales immenses et parce que certains pays, révoltés par cette injustice criante qui sévissait alors en France, menaçaient de boycotter l’exposition universelle que les autorités se résignèrent à en finir avec cette affaire. Ce ne seraient donc pas ces prétendues valeurs morales fondatrices de la politique française contemporaine et de l'idéologie républicaine qui auraient fait éclater la justice mais bien des impératifs économico-festifs.<br /> |
|||
« C’est au dernier acte qu’il apparut que le drame dreyfusien était en réalité une comédie. Le ''deus ex machina'' qui refit l’unité brisée de la France, convertit le parlement à la révision puis réconcilia les partis hostiles, de l’extrême droite jusqu’aux socialistes, n’est autre que l’Exposition Universelle de 1900. Ce que n’avaient pu ni les éditoriaux quotidiens de Clemenceau, ni la rhétorique de Zola, ni les discours de Jaurès, ni la haine populaire du clergé et de l’aristocratie, c’est-à-dire le revirement du Parlement sur le problème de la révision, ce fut la peur du boycott qui l’accomplit. Le même Parlement qui, un an auparavant avait rejeté la révision à l’unanimité, refusa cette fois, à la majorité des deux tiers, la confiance à un gouvernement antidreyfusard. En juin 1899, le cabinet [[Waldeck-Rousseau]] fut formé. Le président Loubet gracia Dreyfus et liquida toute l’affaire. L’exposition put s’ouvrir sous les plus brillants auspices commerciaux ; une fraternisation générale s’en suivit» |
|||
==Sources== |
|||
Il est intéressant de voir comment la République a su à juste titre rappeler et glorifier cet épisode de son histoire et le rappeler en tant qu' événement fondateur où la société prenant conscience d’elle-même a su dans un même mouvement émancipateur, accoucher de la justice et se libérer du mal. À lire Hannah Arendt, on constate que cette philosophe s'ingénie à prétendre le contraire ; à tenter de démontrer que l'affaire Dreyfus comme « fondement de l'identité politique républicaine française » serait plus proche de la fable que de la réalité ''stricto sensu''.Cette démonstration toutefois n'est que l'opinion de son auteur et manque de persuasion. |
|||
===Sources primaires === |
|||
* [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62779w Compte rendu ''in extenso'' du procès d’Émile Zola aux Assises de la Seine et la Cour de Cassation] (1898) |
|||
* [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k24254t Débats de la Cour de Cassation en vue de la révision du procès Dreyfus] (1898) |
|||
* Compte rendu in extenso du procès de Rennes (1899) [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k24250f Tome 1], [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k24251s Tome 2], [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k242524 Tome 3] |
|||
* [[s:Affaire Dreyfus - arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 1906|Décision de la Cour de Cassation]] en vue de la cassation sans renvoi du procès Dreyfus de 1899. (1906) |
|||
===Bibliographie=== |
|||
== Confusions possibles == |
|||
'''Articles et presse''' |
|||
'''NB''' : Il ne faut pas confondre dreyfusards, dreyfusiens et dreyfusistes. |
|||
* Édition spéciale du ''Figaro'' du 12 juillet 2005, « Le centenaire de la réhabilitation du capitaine Dreyfus ». |
|||
* ''« Dreyfusards ! » : souvenirs de Mathieu Dreyfus et autres inédits'' (présentés par Robert Gauthier). Gallimard & Julliard, coll. « Archives » n° 16, Paris, 1978. |
|||
'''Ouvrages généraux'''<br> |
|||
*Les '''dreyfusards''' furent les premiers défenseurs de Dreyfus, ceux qui soutinrent le capitaine depuis le début. |
|||
* Pierre Birnbaum, ''L'Affaire Dreyfus, la République en péril'', éd. Gallimard, coll. « Découvertes », 1994. {{ISBN|978-2070532773}} |
|||
*Le terme '''dreyfusiste''' désigne ceux qui réfléchissaient au-delà de l'affaire et voyaient en celle-ci une nécessité de remettre en cause la société et la politique, et par extension le fonctionnement de la république (certains dreyfusards furent parfois aussi dreyfusistes par la suite). |
|||
* [[Jean-Denis Bredin]], ''L'Affaire'', Fayard, Paris, 1993 (1{{re}} édition 1981) {{ISBN|2-260-00346-X}} |
|||
*Quant aux '''dreyfusiens''', ils n'apparurent qu'en décembre [[1898]] lorsque l'affrontement entre dreyfusards et antidreyfusards devint vraiment aigu et que l'affaire compromettait la stabilité de la république. Ces derniers, même si certains avaient des sympathies pour Alfred Dreyfus, voulaient liquider l'affaire en calmant le jeu, dans le but de sauver le régime républicain parlementaire alors en place. Ils furent à l'origine d'une certaine conciliation entre les deux camps, grâce à un effort de médiation en prônant l'apaisement. Leur texte fondateur fut « l'appel à l'union », paru le [[23 janvier]] 1899 dans le journal ''Le Temps''. Ils soutinrent généralement la politique de Waldeck-Rousseau et prônèrent une [[laïcisation]] de la société. |
|||
* Michael Burns, ''Histoire d'une famille française, les Dreyfus'', Fayard, 1994 |
|||
* Éric Cahm, L’Affaire Dreyfus, Le Livre de poche, coll. « références », 1994 |
|||
* Michel Drouin (dir.), ''[http://www.histoforum.org/histobiblio/article.php3?id_article=175 L'Affaire Dreyfus]'' , Flammarion, 1994, réédition 2006 (sous le titre : ''L’affaire Dreyfus. Dictionnaire''). {{ISBN|978-2082105477}} |
|||
* Vincent Duclert, ''Alfred Dreyfus, l'honneur d'un patriote''. Fayard, 2006 {{ISBN|2-213-62795-9}}. |
|||
* Vincent Duclert, ''L'Affaire Dreyfus''. La Découverte, 2006 (1{{re}} éd. 1994) {{ISBN|2-7071-4793-1}}. |
|||
* [[Pierre Miquel]], ''l’affaire Dreyfus'', Que sais-je ?, Presses Universitaires de France – PUF, 2003, {{ISBN|2130532268}} |
|||
* [[Pierre Miquel]], ''La troisième République'', Fayard, 1989 |
|||
* [[Joseph Reinach]], ''Histoire de l'affaire Dreyfus'', éd. Fasquelle, 1901 ; éd. Robert Laffont, deux vol., 2006 - <br> |
|||
[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75082s Tome 1 ''Procès de 1894''], [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k750834 Tome 2 ''L'affaire Esterhazy''], [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75084g Tome 3 ''Procès Esterhazy et Zola''],<br> |
|||
[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75085t Tome 4 ''Cavaignac et Félix Faure''], [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k750865 Tome 5 ''Procès de Rennes''], [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75087h Tome 6 ''Le procès de Rennes''], <br> |
|||
[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k751017 Tome 7 ''Index général''] |
|||
* Marcel Thomas, ''L'Affaire sans Dreyfus'', Fayard, Paris, 1961. Réédition : Éditions Idégraf, [[Genève]], 1979, 2 volumes. |
|||
* Collectif, ''Dictionnaire de l’affaire Dreyfus'', Flammarion, 2e ed. 2006 |
|||
'''Ouvrages spécialisés''' |
|||
==Théories du complot et origines de l'antisionisme== |
|||
* Général André Bach, ''L'Armée de Dreyfus. Une histoire politique de l'armée française de Charles X à "L'Affaire"'', Tallandier, 2004 {{ISBN|2-84734-039-4}} |
|||
Dans une édition de 1898 de [[Civiltà Cattolica]], journal jésuite, les auteurs laissaient entendre que les sionistes avaient provoqué l'affaire Dreyfus pour ensuite blâmer la France et s'en prendre aux Palestiniens. C'est la première occurence d'une thèse complotiste opposée directement au mouvement fondé par [[Theodor Herzl]]. [http://www.col.fr/arche/article.php3?id_article=278]. Ces thèses étaient en effet monnaie courante à l'époque. |
|||
* [[Jean Doise]], ''Un secret bien gardé ; Histoire militaire de l'Affaire Dreyfus''. Le Seuil, collection {{s-|XX|e}}, 1994 : 225p. {{ISBN|2-02-021100-9}} |
|||
* [[Henri Guillemin]], ''L'énigme Estherhazy'', Paris, Gallimard, 1962. |
|||
* Armand Israël, ''Les vérités cachées de l'affaire Dreyfus'', Albin Michel, 2000 {{ISBN|2-226-11123-9}} |
|||
* Thierry Levy, Jean-Pierre Royer, ''Labori, un avocat'', Louis Audibert Editions, 2006, {{ISBN|2-226-11123-9}} |
|||
*Collectif, ''Les intellectuels face à l’affaire Dreyfus alors et aujourd’hui'', L’Harmattan, 2000, {{ISBN|978-2738460257}} |
|||
*Cour de Cassation, ''De la justice dans l’affaire Dreyfus'', Fayard, 2006, {{ISBN|978-2213629520}} |
|||
'''Témoignages'''<br> |
|||
* [[Alfred Dreyfus]], ''[http://www.histoforum.org/histobiblio/article.php3?id_article=232 Cinq années de ma vie]'', Paris, Fasquelle, 1935. Réédition La Découverte, 2006 |
|||
* [[Alfred Dreyfus]], [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4941c ''Lettres d'un innocent''], Stock, 1898 |
|||
* [[Léon Blum]], ''Souvenirs sur l’Affaire'', Flammarion, Follio Histoire, 1993, {{ISBN|978-2070327522}} |
|||
* [[Georges Clemenceau]], [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2027775 ''L'iniquité''], Stock, 1899 |
|||
* [[Georges Clemenceau]], [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k82753m ''La honte''], 1903 |
|||
* [[Georges Clemenceau]], [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k82754z ''Vers la réparation''], Tresse & Stock, 1899 |
|||
* [[Mathieu Dreyfus]], [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k24254t ''L'Affaire telle que je l'ai vécue''], Bernard Grasset, Paris, 1978.{{ISBN|2-246-00668-6}} |
|||
* [[Jean Jaurès]], [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k72819h Les preuves''], Recueil de La Petite République, 1898 |
|||
* Jean-Louis Lévy, ''Combat pour Dreyfus'', Editions Dilecta, 200606.{{ISBN|978-2916275048}} |
|||
* [[Octave Mirbeau]], ''L'Affaire Dreyfus'', Librairie Séguier, 1991. |
|||
* [[Maurice Paléologue]], ''L’Affaire Dreyfus et le Quai d’Orsay'', Plon, 1955 |
|||
* [[Émile Zola]], ''Combat pour Dreyfus''. Préface de Martine Le Blond-Zola. Postface de Jean-Louis Lévy. Présentation et notes d'Alain Pagès. Éditions Dilecta, 2006. |
|||
== Filmographie== |
|||
<ref>Dictionnaire de l'affaire Dreyfus, entrée Le Cinéma, de Baecque, pp. 550-551</ref> |
|||
===Actualités et assimilés=== |
|||
* 1899 : {{fr}} La garde en faction devant le tribunal de Rennes - Catalogue des vues [[Auguste et Louis Lumière|Lumière]]. |
|||
* 1899 : {{fr}} Mme Dreyfus et son avocat à la sortie de la prison de Rennes. - Catalogue des vues Lumière. |
|||
* 1899 : {{fr}}''L'Affaire Dreyfus'' (actualité reconstituée, 15 mn) de [[Georges Méliès]] (point de vue dreyfusard) |
|||
* 1899 : {{fr}}''L'Affaire Dreyfus'' (actualité reconstituée, 6 tableaux). - Actualités [[Pathé]] |
|||
* 1902 : {{fr}}''L'Affaire Dreyfus'', Film français attribué à Ferdinand Zecca produit par Pathé |
|||
* 1907 : {{fr}}''L'Affaire Dreyfus'', Film français de lucien Nonguet produit par Pathé |
|||
===Documentaires=== |
|||
* 1965 : {{fr}} ''L'affaire Dreyfus'', Film français réalisé pour les écoles de Jean Vigne - Noir et blanc - 18 mn |
|||
* 1972 : {{usa}} ''The Dreyfus Affair'', Film documentaire américain - Noir et blanc - 15 mn |
|||
* 1974 : {{fr}} ''Dreyfus ou l'Intolérable Vérité'', Film documentaire français de Jean Chérasse - Couleur - 90 mn - DVD 2006 par Alpamedia/Janus Diffusion |
|||
* 1994 : {{fr}} ''La Raison d'État, Chronique de l'Affaire Dreyfus'', Film français en deux épisodes de Pierre Sorlin - Couleur - 26 mn |
|||
===Films au cinéma=== |
|||
* 1930 : {{de}}''Dreyfus'', Film allemand de Richard Oswald - Noir et blanc - 90 mn |
|||
* 1931 : {{uk}}''Dreyfus'', Film anglais de F.W Kraemer et Milton Rosmer - Noir et blanc - 90 mn |
|||
* 1937 : {{usa}} ''The Life of Émile Zola'', Film américain de William Dietele - Noir et blanc - 90 mn |
|||
* 1957 : {{usa}} ''I accuse'', Film américain de José Ferrer - Noir et blanc - 90 mn |
|||
===Dramatiques de télévision=== |
|||
* 1978 : {{fr}} ''Zola ou la Conscience humaine'', Film français en quatre épisodes de Stellio Lorenzi - Produit par Antenne 2 - Couleur |
|||
* 1991 : {{uk}} ''Can a Jew Be innocent ?'', Film anglais en quatre épisodes de Jack Emery - Produit par la [[BBC]] - Couleur - 30 mn |
|||
* 1991 : {{usa}} ''Prisoners of Honnor'', Film américain de Ken Russel - Couleur - 105 mn |
|||
* 1994 : {{fr}} ''L'affaire Dreyfus'', Film français en deux épisodes d'Yves Boisset - Produit par France 2 - Couleur |
|||
== Voir aussi == |
== Voir aussi == |
||
{{Wikiquote}} |
|||
=== Articles connexes === |
|||
*[[Action française]] |
*[[Action française]] |
||
*[[Raoul Allier]] |
*[[Raoul Allier]] |
||
| Ligne 116 : | Ligne 746 : | ||
*[[Maurice Barrès]] |
*[[Maurice Barrès]] |
||
*[[Godefroy Cavaignac]] |
*[[Godefroy Cavaignac]] |
||
*[[Crises de la Troisième République]] : |
|||
* |
**[[Commune de Paris (1871)]] |
||
** |
**[[Scandale des décorations]] ([[1887]]) |
||
** |
**[[Affaire Schnaebelé]] (1887) |
||
**[[Boulangisme]] ([[1886]]-[[1889]]) |
|||
** [[Affaire Schnaebelé]] (1887) |
|||
**[[Scandale de Panama]] ([[1892]]) |
|||
** [[Boulangisme]]) |
|||
** |
**[[Fort Chabrol]] ([[1899]]) |
||
** |
**[[Affaire des Fiches]] ([[1904]]) |
||
**[[Affaire Thalamas]] ([[1908]]) |
|||
** Andrew Jansen (1897) |
|||
**[[Première Guerre mondiale]] (1914-1918) |
|||
**[[Affaire Stavisky]] ([[1933]]) |
|||
*[[Léon Dehon]] |
*[[Léon Dehon]] |
||
*[[Mathieu Dreyfus]] |
|||
*[[Hubert-Joseph Henry]] |
|||
*[[Bernard Lazare]] |
*[[Bernard Lazare]] |
||
*[[Ligue de la patrie française]] |
*[[Ligue de la patrie française]] |
||
*[[Ligue française des droits de l'Homme]] ([[1898]]) |
*[[Ligue française des droits de l'Homme]] ([[1898]]) |
||
*[[Affaire Mortara]] |
*[[Affaire Mortara]] |
||
*[[Auguste Mercier]] |
|||
*[[Nationalisme français]] |
*[[Nationalisme français]] |
||
*[[Francis de Pressensé]] |
*[[Francis de Pressensé]] |
||
| Ligne 136 : | Ligne 770 : | ||
*[[Émile Zola]] |
*[[Émile Zola]] |
||
== Liens externes == |
|||
{{Wikiquote}} |
|||
* [[s:J’accuse|''J’accuse'']] d’[[Émile Zola]] |
|||
* {{fr}}[[s:J’accuse|''J’accuse'']] d’[[Émile Zola]] |
|||
* ''[[s:Bordereau de l’affaire Dreyfus|Bordereau de l’affaire Dreyfus]]'' |
|||
* {{fr}}[[s:Bordereau de l’affaire Dreyfus|''Bordereau de l’affaire Dreyfus'']] |
|||
* [[s:Les Preuves|''Les Preuves'']], essai par [[Jean Jaurès]] qui passe en revue toute l'affaire en détail |
|||
* {{fr}}[[s:Les Preuves|''Les Preuves'']], essai par [[Jean Jaurès]] qui passe en revue toute l'affaire en détail |
|||
* [http://www.editions-dilecta.com ''Combat pour Dreyfus''] d’[[Émile Zola]] |
|||
* [http://www.capitainedreyfus.mulhouse.fr/ Commémoration de la réhabilitation d’Alfred Dreyfus à Mulhouse |
* {{fr}}[http://www.capitainedreyfus.mulhouse.fr/ Commémoration de la réhabilitation d’Alfred Dreyfus à Mulhouse à l’occasion de l’année Dreyfus] |
||
* {{fr}}[http://www.cahiers-naturalistes.com/centenaire_rehabilitation.htm Colloque organisé par la cour de cassation le 19 juin 2006, à l'occasion du centenaire de la réhabilitation d'Alred Dreyfus] |
|||
* [http://dreyfus.mahj.org/ Fonds Dreyfus] du [[Musée d'art et d'histoire du judaïsme]] |
|||
* {{fr}}[http://dreyfus.mahj.org/ Fonds Dreyfus] du [[Musée d'art et d'histoire du judaïsme]] |
|||
* {{fr}}[http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/Dreyfus/index.asp Site de l'Assemblée nationale] |
|||
== Bibliographie == |
|||
* {{fr}}[http://gallica.bnf.fr/themes/PolXVIIIIr.htm Site de la Bibliothèque nationale de France] |
|||
Les travaux consacrés à l'affaire Dreyfus sont innombrables, et présentent des avis et des positions souvent extrêmement variés, allant du soutien inconditionnel au Capitaine à la mise en accusation doctrinaire. N'ont donc été ici retenus que les ouvrages traitant avec honnêteté intellectuelle et méthodologie historique de la question. |
|||
* Général André Bach, ''L'Armée de Dreyfus. Une histoire politique de l'armée francaise de Charles X à "L'Affaire"'', Tallandier, 2004 {{ISBN|2-84734-039-4}} |
|||
*Pierre Birnbaum, ''L'Affaire Dreyfus, la République en péril'', éd. Gallimard, coll. « Découvertes », 1994. |
|||
* [[Jean-Denis Bredin]], ''L'Affaire'', Fayard, Paris, 1993 (1{{re}} édition 1981) {{ISBN|2-260-00346-X}} |
|||
* [[Jean Doise]], ''Un secret bien gardé ; Histoire militaire de l'Affaire Dreyfus''. Le Seuil, collection XXème siècle, 1994 : 225p. {{ISBN|2-02-021100-9}}. |
|||
* Michel Drouin (dir.), ''[http://www.histoforum.org/histobiblio/article.php3?id_article=175 L'Affaire Dreyfus]'', Flammarion, 1994, rééd. 2006 {{ISBN|978-2082105477}} |
|||
* Vincent Duclert, ''L'Affaire Dreyfus''. La Découverte, 2006 (1{{re}} éd. 1994). |
|||
* Henri Guillemin, ''L'énigme Estherhazy'', Paris, Gallimard, 1962. |
|||
* Armand Israël, ''Les vérités cachées de l'affaire Dreyfus'', Albin Michel , 2000 {{ISBN|2-226-11123-9}} |
|||
* [[Joseph Reinach]], ''Histoire de l'affaire Dreyfus'', éd. Fasquelle, sept volumes, ; éd. Robert Laffont, deux vol., 2006 |
|||
* Marcel Thomas, ''L'Affaire sans Dreyfus'', Fayard, Paris, 1961. Réédition : Éditions Idégraf, [[Genève]], 1979, 2 volumes. |
|||
* Édition spéciale du ''Figaro'' du 12 juillet 2005, « Le centenaire de la réhabilitation du capitaine Dreyfus ». |
|||
=== Témoignages d'époque === |
|||
* Alfred Dreyfus, ''Cinq années de ma vie)'', Paris, Fasquelle, 1935. |
|||
* Mathieu Dreyfus : |
|||
* ''« Dreyfusards ! » : souvenirs de Mathieu Dreyfus et autres inédits'' (présentés par Robert Gauthier). Gallimard & Julliard, coll. « Archives » n° 16, Paris, 1978. |
|||
* ''L'Affaire telle que je l'ai vécue''. Bernard Grasset, Paris, 1978.{{ISBN|2-246-00668-6}} |
|||
* [[Octave Mirbeau]], ''L'Affaire Dreyfus'', Librairie Séguier, 1991. |
|||
* [[Émile Zola]], ''Combat pour Dreyfus''. Préface de Martine Le Blond-Zola. Postface de Jean-Louis Lévy. Présentation et notes d'Alain Pagès. Éditions Dilecta, 2006. |
|||
==Filmographie== |
|||
* 1899 : ''L'Affaire Dreyfus'' (actualité reconstituée, court métrage) de [[Georges Méliès]] (point de vue dreyfusard) |
|||
* 1978 : [[Zola ou la conscience humaine]] (feuilleton TV) de [[Stellio Lorenzi]] |
|||
* 1995 : [[L'Affaire Dreyfus]] (film TV) de [[Yves Boisset]] |
|||
== Evenements concernant l'Affaire Dreyfus == |
== Evenements concernant l'Affaire Dreyfus == |
||
| Ligne 179 : | Ligne 785 : | ||
* 13 Juillet 1906 : Hommage du [[Sénat (France)|Sénat]] à [[Auguste Scheurer-Kestner|A.Scheurer-Kestner]] |
* 13 Juillet 1906 : Hommage du [[Sénat (France)|Sénat]] à [[Auguste Scheurer-Kestner|A.Scheurer-Kestner]] |
||
* 11 Février 1908 : Le [[Sénat (France)|Sénat]] inaugure le monument Scheurer-Kestner |
* 11 Février 1908 : Le [[Sénat (France)|Sénat]] inaugure le monument Scheurer-Kestner |
||
{{Multi bandeau |
{{Multi bandeau|Portail France au XIXe siècle|Portail histoire militaire|portail droit français}} |
||
<!--Catégories--> |
<!--Catégories--> |
||
| Ligne 185 : | Ligne 791 : | ||
<!--Interwikis--> |
<!--Interwikis--> |
||
{{lien BA|de}} |
{{lien BA|de}} |
||
[[Catégorie:Affaire Dreyfus|*]] |
[[Catégorie:Affaire Dreyfus|*]] |
||
[[Catégorie:Crise politique]] |
[[Catégorie:Crise politique]] |
||
Version du 9 mai 2007 à 11:47

À la fin du XIXe siècle, le point de départ de L'affaire Dreyfus, est une erreur judiciaire sur fond d’espionnage, dont la victime est le capitaine Alfred Dreyfus (1859-1935), juif et alsacien d'origine. Pendant douze ans, de 1894 à 1906, l’Affaire a bouleversé la société française.
La révélation de ce scandale, dans J'accuse, un article d’Émile Zola en 1898, provoque une succession de crises politiques et sociales uniques en France. À son paroxysme en 1899, elle révèle les clivages de la France de la Troisième République. Elle divise profondément et durablement les Français en deux camps opposés, dreyfusards et anti-dreyfusards. Cette affaire est le symbole moderne et universel de l'iniquité au nom de la raison d'État. Elle exacerbera les pires sentiments humains au travers de très violentes polémiques nationalistes et antisémites diffusées par une presse puissante.
Résumé de l'affaire Dreyfus
Modèle:AffaireDreyfus
[1]À la fin de l'année 1894, injustement accusé de trahison pour intelligence avec l'ennemi et transmission de documents secrets compromettant la défense nationale, le capitaine Dreyfus, polytechnicien, juif et alsacien, est condamné au bagne à vie et déporté sur l'île du Diable.
En partie animé par un antisémitisme doctrinaire, le haut commandement de l'armée française a employé des moyens illégaux afin d'emporter la décision du Conseil de guerre.
Quasiment oublié sauf des siens, Dreyfus purge sa peine dans des conditions inhumaines pendant quatre ans. Sans se décourager, sa famille, et notamment son frère Mathieu, mettent tout en œuvre pour le faire libérer, certains de son innocence.
Petit à petit, la vérité est révélée. Le chef du contre-espionnage, le colonel Picquart, découvre le nom du vrai traître en 1896 : Esterházy. Sa hiérarchie l’oblige à se taire. Ce qu’il refuse de faire, au risque de voir sa carrière compromise. L’information est donc rendue publique.
Le commandant Esterházy est traduit en Conseil de guerre au tout début de l’année 1898. Mais protégé par l'État-major, qui ne veut pas perdre la face, le vrai coupable est acquitté sous les ovations de la foule.
C'est un énorme scandale.
Deux jours après, devant l'iniquité insupportable de cette décision de justice militaire, Émile Zola publie J'accuse dans le journal l'Aurore en janvier 1898 et dévoile tous les traits sordides de ce qui devient désormais l'Affaire. Il accuse nommément et publiquement tous les protagonistes civils et militaires. C'est le début de la crise politique et sociale, qui se prolongera jusqu’à la fin du siècle. Des émeutes antisémites éclatent dans plus de vingt villes françaises. On dénombre plusieurs morts à Alger.
La république est ébranlée, certains la voient même en péril. Il faut en finir avec l’affaire Dreyfus pour ramener le calme.
Malgré les menées de l'armée pour étouffer cette affaire, le premier jugement condamnant Dreyfus est cassé par la Cour de cassation au terme d'une enquête minutieuse, et un nouveau Conseil de guerre a lieu à Rennes en 1899.
Mais contre toute attente, Dreyfus est condamné une nouvelle fois, à dix ans de travaux forcés, avec, toutefois, circonstances atténuantes. Epuisé par sa déportation de quatre longues années, Dreyfus n'a d'autre ressource que d'accepter la grâce présidentielle.
Il faudra que le capitaine attende 1906, pour que son innocence soit officiellement reconnue au travers d'un arrêt sans renvoi de la Cour de cassation, décision inédite et unique dans l'histoire du droit français.
Réhabilité, le capitaine Dreyfus sera réintégré dans l'armée au grade de lieutenant-colonel et participera à la Première Guerre mondiale. Il décède en 1935.
Les conséquences de cette affaire sont innombrables, encore perceptibles plus de cent ans après les faits, touchant tous les aspects sociaux en France : politique, armée, religion, société, droit, media, diplomatie et intellectuels.
Confusions possibles
Il ne faut pas confondre dreyfusards, dreyfusiens et dreyfusistes.
- Les dreyfusards furent les premiers défenseurs de Dreyfus, ceux qui soutinrent le capitaine depuis le début.
- Le terme dreyfusiste désigne ceux qui réfléchissaient au-delà de l'affaire et voyaient en celle-ci une nécessité de remettre en cause la société et la politique et par extension le fonctionnement de la république (certains dreyfusards furent parfois aussi dreyfusistes par la suite).
- Quant aux dreyfusiens, ils n'apparurent qu'en décembre 1898 lorsque l'affrontement entre dreyfusards et antidreyfusards devint vraiment aigu et que l'affaire compromettait la stabilité de la république. Ces derniers, même si certains avaient des sympathies pour Alfred Dreyfus, voulaient liquider l'affaire en calmant le jeu, dans le but de sauver le régime républicain parlementaire alors en place. Ils furent à l'origine d'une certaine conciliation entre les deux camps, grâce à un effort de médiation en prônant l'apaisement. Leur texte fondateur fut « l'appel à l'union », paru le 23 janvier 1899 dans le journal Le Temps. Ils soutinrent généralement la politique de Waldeck-Rousseau et prônèrent une laïcisation de la société.
Contextes de l'affaire Dreyfus
Contexte politique
En 1894, la IIIe République est vieille de vingt-trois ans.
Le régime politique de la France va vers la stabilité après trois grandes crises : le boulangisme en 1889, le scandale de Panamá en 1892, et la menace anarchiste, réduite par les « lois scélérates » de juillet 1894.
Le président Sadi Carnot, assassiné le 24 juin 1894 est remplacé par un modéré, Casimir-Perier qui incarnera un certain retour au calme.
Les gouvernements appelés « opportunistes » font des choix politiques orientés vers un protectionnisme économique, presque indifférents à la question sociale, tournés radicalement vers une alliance russe sensée briser l'isolement du pays, œuvre du général le Mouton de Boisdeffre.
Les élections de 1893 amènent un profond renouvellement du personnel politique, usé par les crises.
Majoritairement républicaine et modérée alliée aux monarchistes, qui sont devenus une force parlementaire, la Chambre écarte les radicaux qui, dès lors, cherchent une alliance avec les socialistes.
Ainsi la République en tant que régime parlementaire était désormais fondée.
Qu'ils soient de droite ou de gauche, les républicains existent bien et la droite même nationaliste, ne remet pas en cause le cadre institutionnel.
La stabilité du régime est assurée par une forte croissance économique développant une société bourgeoise emprunte de positivisme, appuyée par de considérables progrès scientifiques.
L'empire colonial français, en voie de finalisation, est vu comme une grande réussite, contribuant largement à l'embellie économique de cette fin de siècle. L'Empire doit être prêt pour la consécration : l'exposition universelle de 1900.[2] , [3]
Contexte militaire

L'affaire Dreyfus se place dans le cadre de l'annexion de l'Alsace et de la Moselle, déchirure qui va alimenter tous les nationalismes les plus extrêmes.
La défaite traumatisante de 1870 semble loin, mais l'esprit revanchard est toujours présent.
De nombreux acteurs de l'affaire Dreyfus sont d'ailleurs des Alsaciens[4].
Les militaires exigent des moyens considérables pour préparer le prochain conflit, et c'est dans cet esprit que l'alliance franco-russe contre nature[5] du 27 août 1892 est signée, sur la base d'une convention militaire.
L'armée s'est relevée de la défaite, mais elle est encore largement constituée de ses anciens cadres socialement aristocrates et politiquement monarchistes.
Le culte du drapeau et le mépris de la République parlementaire sont les deux rouages de la pensée militaire à cette époque[6].
La France a beau célébrer son armée avec la régularité d'un métronome, l'armée ignore la nation.
Depuis une dizaine d'années, l'armée connaît une mutation importante, dans le double but de la démocratiser et de la moderniser.
Des polytechniciens concurrencent efficacement les officiers issus de la voie royale de Saint-Cyr, ce qui amènera des dissensions, amertumes et jalousies parmi ceux des sous-officiers qui s'attendaient à des promotions au choix.
La période est aussi marquée par une course aux armements qui touche principalement l'artillerie, avec des perfectionnements concernant l'artillerie lourde (canons de 120 et 150), mais aussi et surtout, la mise au point de l'ultra secret canon de 75mm[7].
Il faut aussi signaler ici le fonctionnement du contre-espionnage militaire, alias « Section de statistiques ».
Le Renseignement, activité organisée et outil de guerre secrète, est une nouveauté de la fin du XIXe siècle.
La Section de statistiques est créée en 1871 mais ne compte alors qu'une poignée d'officiers et de civils.
Son chef en 1894 est le lieutenant-colonel Jean Sandherr, saint-cyrien, alsacien de Mulhouse et très antisémite.
Sa mission est simple : récupérer des renseignements sur l'ennemi potentiel de la France, et l'intoxiquer avec de fausses informations.
La Section de statistiques est épaulée par les « Affaires réservées » du quai d'Orsay, animée par un jeune diplomate, Maurice Paléologue.
La course aux armements va amener une ambiance d'espionnite aiguë dans le contre-espionnage français.
Aussi, l'une des tâches de la section consiste à espionner l'ambassade d'Allemagne, rue de Lille, à Paris afin de déjouer toute tentative de transmission d'informations importantes à l'Allemagne.
D'autant que plusieurs affaires d'espionnage avaient déjà défrayé la chronique d'une presse friande de ces histoires mêlant les hauts sentiments au sordide.
Ainsi en 1890, l'archiviste Boutonnet a-t-il été condamné pour avoir vendu les plans de l'obus à la mélinite.
L'attaché militaire allemand à Paris est en 1894 le comte Maximilien von Schwartzkoppen, qui développe une politique d'infiltration qui semble avoir été efficace.
Depuis le début 1894, la section enquête sur un trafic de plans directeurs concernant Nice et la Meuse, mené par un agent que les Allemands et les Italiens surnomment Dubois.
C'est ce qui l'amène aux origines de l'affaire Dreyfus[8].
Contexte social
Le contexte social est marqué par la montée du nationalisme et de l'antisémitisme, une donnée de l'armée, et une composante de la société.
Cette croissance de l'antisémitisme, très virulente depuis la publication de La France juive d'Édouard Drumont en 1886 (150 000 exemplaires la première année), va de pair avec une montée du cléricalisme.
Les tensions sont fortes dans toutes les couches de la société, attisées par une presse puissante et totalement libre d'écrire et de diffuser n'importe quelle information, fût-elle injurieuse ou diffamatoire.
Pratiquement sans risques juridiques.
L'antisémitisme n'épargne pas l'institution militaire qui pratique des discriminations occultes jusque dans les concours, avec la fameuse cote d'amour, notation irrationnelle, dont Dreyfus a fait les frais à l'école d'application de Bourges[9].
Témoin des fortes tensions de cette époque, la vogue du duel, à l'épée ou au pistolet, allant parfois jusqu'à la mort d'un des deux duellistes.
De brillants officiers juifs, atteints par une série d'articles de presse de La Libre Parole[10], accusés de « trahir par naissance », défient leurs rédacteurs.
Ainsi en est-il du capitaine Cremieu-Foa, juif alsacien et polytechnicien qui se bat sans résultat.
Mais le capitaine Mayer, autre officier juif, est tué par le marquis de Morès, ami de Drumont, dans un autre duel ; décès qui déclenche une émotion considérable, très au delà des milieux israélites.
La haine des juifs est désormais publique, irrationnelle, alimentée par un brûlot diabolisant la présence juive en France.
La présence juive en France ?
80 000 personnes au plus en 1895 (dont 40 000 à Paris), très intégrés, plus 45 000 en Algérie.
Le lancement de La Libre Parole, dont la diffusion estimée est de 200 000 exemplaires[11] en 1892 va permettre à Drumont d'élargir encore son audience vers les basses couches de la population, déjà tentées par l'aventure boulangiste.
L'antisémitisme diffusé par La Libre Parole, mais aussi par L'Éclair, Le Petit Journal, La Patrie, L'Intransigeant, La Croix, en puisant dans les racines antisémites des milieux catholiques va atteindre des sommets himalayens[12].
Origines de l'affaire et le procès de 1894
A l'origine : les faits d'espionnage


L'origine de l'affaire Dreyfus n'est pas claire plus d'un siècle après les faits. Il s'agit d'une affaire d'espionnage dont les intentions sont restées obscures jusqu'à nos jours[13]. De nombreux historiens parmi les plus éminents expriment plusieurs hypothèses distinctes[14], mais tous arrivent à une conclusion unique : Dreyfus était innocent du crime de haute trahison.
Découverte du bordereau
Les militaires du SR[15] ont affirmé de manière constante
[16] qu'en septembre 1894, la « voie ordinaire »[17] avait apporté[18] au contre-espionnage français une lettre que l’on surnommera par la suite « le bordereau» [19].
Cette lettre-missive, partiellement déchirée en six grands morceaux[20], écrite sur du papier pelure, non signée et non datée, était adressée à l'attaché militaire allemand en poste à l’ambassade d’Allemagne, Max von Schwarzkoppen. Il établissait que des documents militaires confidentiels, mais d'importance relative[21], avaient été transmis à une puissance étrangère.
Recherche de l'auteur du bordereau
Cette prise semble suffisamment importante pour que le chef de la « Section de statistiques »[22], le mulhousien[23] Jean Sandherr, en informe le ministre de la Guerre, le général Auguste Mercier.
Le ministre, violemment attaqué dans la presse pour son action jugée faible, semble vouloir tirer parti de cette affaire pour se requinquer[24]. Il diligente immédiatement deux enquêtes successives, l’une administrative et l’autre judiciaire.
Pour trouver le coupable, le raisonnement est simple sinon simpliste, voire grossier[25]: le cercle de recherche est restreint à un coupable forcément en poste ou ancien collaborateur à l’État-major, artilleur[26], et officier stagiaire [27],[28] .
Le coupable idéal est tout trouvé : le capitaine Alfred Dreyfus, polytechnicien et artilleur, de confession israélite et alsacien d’origine. D'autant plus qu'au travers de Dreyfus, on s'en prend à la république[29]. Sans que ce soit une exception, puisqu’on privilégiait les officiers de l’est de la France pour leur double connaissance de la langue allemande et de la culture germanique, on insistera plus sur les origines alsaciennes de Dreyfus que sur son appartenance religieuse au tout début de l’affaire [30]. Mais l’antisémitisme, qui n’épargne pas les bureaux d’État-major[31], deviendra rapidement le centre de l’affaire d’instruction, remplissant les vides d’une enquête préliminaire incroyablement sommaire. D'autant que Dreyfus était à ce moment là le seul officier juif à l'État-major.
De fait, la légende[32] du caractère froid et renfermé, voire hautain de l’homme et sa « curiosité » va fortement jouer contre lui et rendront plausibles toutes les accusations en transformant les actes les plus ordinaires de la vie courante dans un ministère, en faits avérés d’espionnage.
C’est bien entendu ce début d’instruction, partial et partiel, cette vision restrictive du champ du possible, qui va amener la bévue puis l’erreur et enfin le mensonge d’État au travers d’un conte à dormir debout où l’irrationnel et la pensée magique l’emporteront souvent sur le positivisme pourtant en vogue à cette époque. [33]
« Dès cette première heure s’opère le phénomène qui va dominer toute l’affaire. Ce ne sont plus les faits contrôlés, les choses examinées avec soin qui forment la conviction ; c’est la conviction souveraine, irrésistible, qui déforme les faits et les choses. Joseph Reinach »


Expertises en écriture
Pour confondre Dreyfus, les écritures du bordereau et du capitaine sont comparées. Personne n’est compétent en cette matière à l’État-major[34]. Entre alors en scène l’un des personnages les plus énigmatique de cette histoire : le commandant du Paty de Clam. [35] Entre autres traits originaux de sa personnalité complexe, le commandant se pique d’une expertise graphologique. Mis en présence des deux écritures le 5 octobre, du Paty conclut d’emblée à l’identité. Après une journée de travail complémentaire, il assure dans un rapport que, malgré quelques dissemblances, les ressemblances sont suffisantes pour justifier une enquête. Dreyfus est donc « l'auteur probable » du bordereau pour l'État-major[36].
Le général Mercier tenant un coupable, il va faire mousser l'affaire, qui prendra le statut d'affaire d'État pendant la semaine qui s'écoule avant l'arrestation de Dreyfus. En effet, le ministre consulte et informe toutes les autorités[37], mais malgré les conseils de prudence[38] et les objections courageusement exprimés par Gabriel Hanotaux lors d'un petit conseil des ministres,[39] il décide de poursuivre.[40] Du Paty de Clam est nommé officier de police judiciaire. Pendant ce temps plusieurs informations sont ouvertes parallèlement, les unes sur la personnalité de Dreyfus, les autres consistant à s'assurer de la réalité des identités d'écriture. L'expert[41] Gobert n'est pas convaincu, trouve de nombreuses différences et écrit même que « la nature de l'écriture du bordereau exclut le déguisement graphique »[42]. Déçu, Mercier fait alors appel à Alphonse Bertillon, l'inventeur de l'anthropométrie judiciaire, mais nullement expert en écritures. Il n'est d'abord pas plus affirmatif que Gobert, en n'excluant pas une copie de l'écriture de Dreyfus.[43]. Mais par la suite, sous la pression des militaires, il affirmera que Dreyfus s'est auto-copié.
L'arrestation
Le 13 octobre, sans aucune preuve tangible, le dossier étant vide, le général Mercier fait convoquer le capitaine Dreyfus pour une inspection générale, en « tenue bourgeoise »[44]. L'objectif de l'État-major était de gagner la preuve parfaite en droit français : l'aveu. Cet aveu serait obtenu par effet de surprise, en faisant écrire au suspect une lettre inspirée du bordereau[45] au coupable[46] sous la dictée.
Le 15 octobre 1894 au matin, le capitaine Dreyfus subit donc cette mascarade, sans rien avouer. L'espoir des militaires était déçu. Du Paty de Clam le fait arrêter tout de même[47] et l'inculpe d'intelligence avec l'ennemi afin d'être traduit devant un Conseil de guerre. Il est incarcéré à la prison du Cherche-midi à Paris.
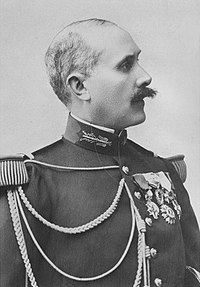
L'instruction et le premier Conseil de guerre
Mme Dreyfus est prévenue le jour même de l'arrestation, par une perquisition au domicile du capitaine. Mais elle doit se taire sous les menaces comminatoires de du Paty. En toute illégalité[48], Dreyfus est mis au secret dans sa prison. Il est torturé psychologiquement jour et nuit par du Paty, qui veut obtenir des aveux. Mais Dreyfus ne craque pas, et n'avoue rien. Il est soutenu par le premier dreyfusard : le commandant Forzinetti[49].
Le 30 octobre, l'affaire est révélée dans le journal antisémite d'Édouard Drumont, La Libre Parole , début d'une très violente campagne de presse qui durera jusqu'au procès. Cet événement place l'Affaire sur le terrain de l'antisémitisme, qu'elle ne quittera plus[50].
Le 1er novembre, Mathieu Dreyfus, le frère d'Alfred, appelé d'urgence à Paris, est mis au courant de l'arrestation. Il va devenir l'artisan du combat long et ingrat pour la libération de son frère. En attendant, il s'est mis à la recherche d'un avocat, qui sera finalement l'éminent pénaliste Edgar Demange.
L'instruction
Le 3 novembre, à contre cœur[51], le général Saussier donne l'ordre d'informer. Saussier avait tous les pouvoirs pour arrêter la machine infernale, mais il ne l'a pas fait. A-t-il cru exagérément en la justice militaire pour acquitter Dreyfus[52] ?
Le commandant Besson d'Ormescheville, rapporteur auprès du Conseil de guerre, commet un rapport à charge. Tous les ragots les plus vils sur la vie privée prétendument dissolue d'Alfred Dreyfus, toutes les indiscrétions, les boues de caniveau, encombrent ce monument de partialité[53]. Mais même supposés vrais, ce ne sont pas des preuves de trahison.
On n'a donc pas de preuves, mais c'est une preuve de culpabilité. Dreyfus n'a pas connu les pièces incriminées dans le bordereau, mais il aurait pu les connaître. Il avait de la mémoire : une nouvelle preuve. Il savait l'allemand : une autre preuve. Il ne savait finalement pas très bien l'allemand : toujours une preuve. Bref le vide.
Le 4 décembre, devant ce dossier « accablant »[54], Dreyfus est renvoyé devant le premier Conseil de guerre. Le secret est levé et Me Demange a enfin accès au dossier. À sa lecture, sa confiance est absolue : ce sera l'acquittement. Premier juge de Dreyfus, l'avocat a pu constater le néant du dossier qui ne repose que sur une pièce unique, le bordereau, et sur de vagues témoignages indirects.
Le procès : « le huis clos ou la guerre ! »[55]

Le Conseil de guerre se déroule du 19 au 22 décembre 1894. Sous la pression de la violente campagne de presse qui durait depuis deux mois, le huis clos[56] est prononcé. Ce huis clos n'est d'ailleurs pas conforme puisque le commandant Picquart et le préfet Louis Lépine seront présents à certaines audiences en violation du droit. Cette mesure permet, dès lors, de ne pas divulguer le néant du dossier au grand public[57]. C'est l'étouffement des débats[58]
Conformément aux prévisions, le vide du dossier apparaît nettement. Les discussions de fond sur le bordereau montrent que le capitaine Dreyfus ne pouvait pas en être l'auteur[59]. D'autre part, l'accusé lui même clame son innocence, et se défend point par point. Au surplus, ses déclarations sont appuyées par de nombreux témoignages à décharge. Enfin l'absence de mobile pour le crime est une sérieuse épine dans le dossier d'accusation. Dreyfus était en effet ultra patriote, brillant officier prometteur, et surtout très riche[60].
Pourquoi donc aurait-il trahi ? Personne n'apporte d'arguments. Pour la presse de droite, l'argument est tout trouvé : parce qu'il est juif !
Alphonse Bertillon, qui n'est pas expert en écritures, est présenté comme un savant de première importance. Il invente la théorie extravagante de l'auto-forgerie à l'occasion de ce procès. Il accuse en effet Dreyfus d'avoir imité sa propre écriture, expliquant les dissemblances de l'écriture du bordereau par le fait qu'il ait employé des extraits de l'écriture de son frère Mathieu et de son épouse Lucie. Cette théorie farfelue et sidérante semble avoir eu un certain effet sur les juges.
Le commandant Hubert Henry [61] fait une déclaration théâtrale. En affirmant qu'une suspicion existait depuis le mois de février à propos d'une trahison à l'État-major, il jure sur l'honneur à l'audience que le traître est Dreyfus en le désignant. L'incident a un effet considérable sur le jury[62].
Toutefois, l'issue du procès est incertaine. La conviction des juges a été ébranlée par l'attitude ferme et les réponses logiques de l'accusé[63]. Les juges partent délibérer. Mais l'État-major a encore une carte en main.
Transmission d'un dossier secret aux magistrats

Les témoins militaires du procès alertent le commandement sur les risques d'acquittement. Mais dans cette éventualité, la Section de statistiques avait préparé un dossier, contenant quatre preuves « absolues » de la culpabilité du capitaine Dreyfus, accompagnées d'une note explicative. Celui-ci fut remis, en toute illégalité, au président du Conseil de guerre, le colonel Emilien Maurel au début du délibéré sur ordre du ministre de la Guerre, le général Mercier[64].
Ce dossier, on le saura bien plus tard, contenait, outre des lettres sans grand intérêt dont certaines étaient truquées[65], une pièce restée célèbre dénommée « Canaille de D... ». C'était une lettre de l'attaché militaire allemand, Max von Schwartzkoppen à l'attaché militaire italien Alessandro Panizzardi interceptée par le SR. La missive était sensée accuser définitivement Dreyfus, puisque d'après ses accusateurs, il était désigné par l'initiale de son nom[66]. En réalité, la Section de statistiques savait que la lettre ne pouvait pas être attribuée à Dreyfus, et si elle le fut, ce fut par intention criminelle[67].
Le colonel Maurel a affirmé au second procès Dreyfus[68] que les pièces secrètes n'avaient pas servi à emporter l'adhésion des juges du Conseil de guerre. Mais il se contredit en affirmant qu'il a lu un seul document, « ce qui fut suffisant ».
Après plusieurs heures de délibération, le verdict tombe.
Condamnation, dégradation et déportation

Le 22 décembre, à l'unanimité des sept juges, Dreyfus est condamné « à la destitution de son grade, à la dégradation militaire, et à la déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée », c'est-à-dire au bagne en Guyane.
La constitution de 1848 avait aboli la peine capitale pour crime politique. Le jury a condamné Dreyfus pour trahison, à l'unanimité. Pour la presse et le public, les quelques doutes préexistants au procès s'étaient immédiatement dissipés, et personne ne se posait plus de question. La culpabilité était certaine. L'heure était à la vindicte populaire.
À droite comme à gauche, on regrettait l'abolition de la peine de mort pour ce genre de crime. L'antisémitisme atteint des sommets dans la presse et se manifeste dans des populations jusqu'à présent épargnées[69]. Même Jaurès dans un article, rappelle « qu'un troupier vient d'être condamné à mort et exécuté pour avoir lancé un bouton au visage d'un adjudant. Alors pourquoi laisser ce misérable en vie ? »
Le 5 janvier 1895, la cérémonie de la dégradation se déroule dans une cour de l'École militaire à Paris. Les témoins signalent la dignité de Dreyfus, qui continue de clamer son innocence. Ici vient se greffer ce que l'on appellera appellera « la légende des aveux »[70]. Avant la dégradation, Dreyfus aurait confié être un traître au capitaine Lebrun-Renault, dans le fourgon qui l'amenait à l'École militaire. Il apparaîtra qu'en réalité, le capitaine de la Garde républicaine s'était vanté, mais que Dreyfus n'avait fait aucun aveu[71].
Le prisonnier est mis au secret du fait de la nature même de l'affaire, touchant à la sécurité nationale. Il est enfermé dans une cellule en attendant son transfert.
Le 17 janvier, il est transféré au bagne de l'île de Ré, où il est maintenu plus d'un mois. Il a le droit de voir sa femme deux fois par semaine, dans une salle allongé, chacun à un bout, le directeur de la prison au milieu[72].
Le 21 février, il embarquait sur le vaisseau Ville-de-Saint-Nazaire. Le lendemain, le navire fit cap vers la Guyane.
La Vérité en marche (1895-1897)
Dreyfus à l'île du Diable

Le 12 mars, après une traversée pénible de quinze jours, le navire mouille au large des îles du Salut.
Dreyfus reste un mois au bagne de l'île Royale, puis il est transféré à l'île du Diable le 14 avril.
Avec ses gardiens, il est le seul habitant de l'île, logeant dans une case de pierre de quatre mètres sur quatre[73].
Hanté par le risque de l'évasion, le commandant du bagne va faire vivre un enfer au condamné alors que les conditions de vie sont déjà très pénibles. La température atteint 45°C.
Dreyfus tombe malade, secoué par les fièvres qui s'aggraveront d'année en année[74].
Dreyfus est autorisé à écrire sur un papier numéroté et paraphé. Il subit la censure du commandement de même que lorsqu'il reçoit du courrier de sa femme Lucie, par lequel ils s'encouragent mutuellement.
Le 6 septembre 1896, les conditions de vie d'Alfred Dreyfus s'aggravent encore : il est mis à la double boucle.
Ce supplice infâme, oblige le forçat à rester sur son lit, immobile, les chevilles entravées.
Cette mesure est la conséquence de la fausse information de son évasion, révélée par un journal anglais.
Pendant deux longs mois, elle plonge Dreyfus dans un profond désespoir.
Pour lui, il est certain, à ce moment, que sa vie s'achèvera sur cette île lointaine[75].
La famille Dreyfus découvre l'affaire et agit
Mathieu Dreyfus, le frère aîné d'Alfred Dreyfus, est convaincu de l'innocence du condamné. Il est le premier artisan de la réhabilitation de son frère, dans un moment très difficile à vivre, passant tout son temps, toute son énergie et sa fortune à rassembler autour de lui un mouvement de plus en plus puissant en vue de la révision du procès de décembre 1894 :
- « Après la dégradation, le vide se fit autour de nous. Il nous semblait que nous n'étions plus des êtres comme les autres, que nous étions comme retranchés du monde des vivants. Mathieu Dreyfus »[76]
Mathieu essaie toutes les pistes, y compris les plus étonnantes.
Ainsi, grâce au docteur Gibert[77] il rencontre au Havre une femme qui, sous hypnose, lui parle pour la première fois d'un « dossier secret »[78]. Le fait est confirmé par le président de la République au docteur Gibert dans une conversation privée.
Petit à petit, malgré les menaces d'arrestation pour complicité, les filatures, les pièges tendus par les militaires, il réussit à convaincre divers modérés.
Ainsi, le vice-président du Sénat Auguste Scheurer-Kestner, un alsacien, et un journaliste de gauche Bernard Lazare, se penchent sur les zones d'ombre de la procédure.
Lazare est le premier à publier un opuscule dreyfusard dès 1896 à Bruxelles[79].
Cette publication n'a que peu d'influence sur le monde politique et intellectuel, mais elle contient tant de détails que l'État-major suspecte le nouveau chef du SR, Picquart, d'en être responsable.
Leur campagne en faveur de la révision, relayée petit à petit dans la presse de gauche antimilitariste, déclenche en retour une vague d'antisémitisme très violente dans l'opinion. La France était alors très majoritairement antidreyfusarde. Le commandant Henry, à la Section de statistiques, est de son côté conscient de la fragilité du dossier d'accusation. À la demande de sa hiérarchie, le général de Boisdeffre, chef d'État-major général, et le général Gonse, il est chargé de faire grossir le dossier afin d'éviter toute tentative de révision. Incapable de trouver la moindre preuve à posteriori, il décide d'en fabriquer...
Le vrai coupable est identifié et dénoncé : affaire Esterházy et procès
Découverte du traître : Picquart « passe à l'ennemi »

Le vrai coupable est découvert par hasard de deux manières ; par Mathieu Dreyfus d'une part, et par le SR d'autre part, à la suite d'une enquête.
Le fait marquant de cette période, c'est l'affectation du lieutenant-colonel Georges Picquart à la tête du SR en juillet 1895 ; le colonel Sandher est en effet tombé malade. Picquart avait suivi l’affaire Dreyfus dès son origine. [80].
En mars 1896, Picquart exige désormais de recevoir directement les documents volés à l'ambassade d'Allemagne, sans intermédiaire[81] ; il y découvre un document surnommé le « petit bleu ».
Il s’agit d’une carte télégramme, jamais envoyée, écrite par von Schwartzkoppen et interceptée à l’ambassade d’Allemagne.
Celle-ci est adressée à un officier français d'origine hongroise : commandant Ferdinand Esterházy, 27 rue de la Bienfaisance - Paris[82].
Par ailleurs, une autre lettre au crayon noir de von Schwartzkoppen démontre les mêmes relations d'espionnage avec Esterházy[83].
Mis en présence de lettres de cet officier, Picquart s'aperçoit avec stupéfaction que son écriture est la même que celle du « bordereau » qui a servi à incriminer Dreyfus.
Il se procure le « dossier secret » remis aux juges en 1894, et devant sa vacuité, acquiert la certitude de l’innocence de Dreyfus.
Picquart diligente une enquête en secret, avec l'accord de ses supérieurs[84]. Elle démontre qu'Esterházy avait connaissance des éléments décrits par le « bordereau » et qu'il était bien en contact avec l'ambassade d'Allemagne[85].
Il fut notamment établi que l'officier vendait de nombreux documents secrets aux Prussiens, mais dont la valeur était assez faible.
Esterházy était un ancien membre du contre-espionnage français[86] où il a servi après la Guerre de 1870.
Il avait travaillé dans le même bureau que le Commandant Henry de 1877 à 1880 [87].
Fripouille à la personnalité trouble, à la réputation sulfureuse et controversée, criblé de dettes, il est pour Picquart, un traître probable animé par un mobile certain : l'argent.
Picquart communique alors les résultats de son enquête à l'État-major.
Mais il se heurte à un mur : « l'autorité de la chose jugée ».
Désormais, tout sera fait pour l'évincer de son poste, avec l'aide de son propre adjoint le commandant Henry.
Il s'agissait avant tout, dans les hautes sphères de l'Armée, de ne pas admettre que la condamnation de Dreyfus puisse être une grave erreur judiciaire.
Pour Mercier, puis Zurlinden, et l'État-major, ce qui est fait est fait, on ne revient jamais en arrière[88].
Il convenait maintenant de séparer les affaires Dreyfus et Esterházy.
Dénonciation d'Estarházy
La presse lance une violente campagne contre le noyau dur naissant des Dreyfusards.
Mais en contre-attaquant, l'État-major se découvre et révèle des informations ignorées jusque là, ayant trait, notamment, au « dossier secret »[89].
Le doute commence à s'installer.
Des intellectuels s'interrogent[90].
Picquart tente de convaincre ses chefs de réagir en faveur de Dreyfus, mais l'État-major semble sourd.
Une enquête est instruite contre lui, il est surveillé.
Il devient le gêneur qu'on éloigne dans l'Est, puis en Tunisie « dans l'intérêt du service »[91].
C'est le moment que choisit le commandant Henry pour passer à l'action. Le 1er novembre 1896, il fabrique un faux, le faux Henry[92], en conservant l'entête et la signature[93] d'une lettre quelconque de Panizzardi, et écrit lui-même le texte central :
« J'ai lu qu'un député va interpeller sur Dreyfus. Si on demande à Rome nouvelles explications, je dirai que jamais j'avais les relations avec ce Juif. C'est entendu. Si on vous demande, dites comme ça, car il ne faut pas que on sache jamais personne ce qui est arrivé avec lui. »
C'est un faux assez grossier, Henry ne parle à personne de ses agissements, et les généraux Gonse et Boisdeffre peuvent foncer chez leur ministre, le général Billot, avec leur lettre salvatrice.
Tout le monde respire.
Il n'y avait pas d'erreur.
Le traître était bien Dreyfus, on en est sûr désormais[94].
Fort de cette trouvaille, l'État-major va désormais s'ingénier à protéger Esterházy et à persécuter le colonel Picquart.
Picquart, qui ignore tout du faux Henry, comprend peu à peu qu'il est méprisé par les militaires. Littéralement accusé de malversations par le commandant Henry, il proteste par écrit et rentre à Paris.
Le secret est trop lourd à porter seul. Picquart se confie à son ami, l'avocat Louis Leblois.
Le vice-président du Sénat, Auguste Scheurer-Kestner est touché par le doute alors qu'il est mis en présence de l'avocat.
Sans citer Picquart, il révèle l'affaire aux plus hautes personnalités du pays.
Mais l'État-major a des soupçons.
C'est le début de l'affaire Picquart[95], cette conspiration contre l'officier de valeur qui a osé s'interroger sur l'indicible.
Le commandant Henry, pourtant adjoint de Picquart, mais jaloux, mène de son propre chef, une opération d'intoxication afin de compromettre son supérieur. Il se livre à diverses malversations (fabrication d'une lettre le désignant comme l’instrument du syndicat juif voulant faire évader Dreyfus, truquage du « petit bleu » pour faire croire que Picquart en a effacé le nom du réel destinataire, rédaction d'un courrier nommant Dreyfus en toutes lettres).
En novembre 1897, les défenseurs de Dreyfus sont informés par d'autres sources des similitudes d'écriture du « bordereau » avec celle d'Esterházy et de nouvelles charges contre lui.
Mathieu avait en effet fait afficher la reproduction du bordereau, publiée par Le Figaro.
Un banquier, Castro, avait formellement identifié son écriture comme celle du commandant Esterházy, son débiteur.
Le 11 novembre1897, les deux pistes se rejoignent, à l'occasion d'une rencontre entre Scheurer-Kestner et Mathieu Dreyfus.
Mathieu obtient la confirmation du fait qu'Esterházy est bien l'auteur du bordereau.
Le 15 novembre, sur ces bases, Mathieu Dreyfus porte plainte auprès du ministère de la Guerre contre Esterházy[96].
La polémique étant publique, l'armée n'a plus d'autre choix que d'ouvrir une enquête.
Fin 1897, Picquart, qui est revenu à Paris, fait connaître publiquement ses doutes sur la culpabilité de Dreyfus, du fait de ses découvertes. La collusion destinée à éliminer Picquart semble avoir échoué [97].
La contestation est très forte et vire à l'affrontement.
Afin de discréditer Picquart, Esterházy envoie des lettres au Président de la République.
L'effet est vain.
Procès et acquittement
Le général de Pellieux est chargé d'effectuer une enquête.
Celle-ci tourne court, l'enquêteur étant adroitement manipulé par l'État-major.
Le vrai coupable, lui dit-on, c'est le lieutenant-colonel Picquart[98]!
De Pellieux s'achemine vers un non-lieu, quand un nouveau coup de théâtre se produit : l'ex-maîtresse d'Esterházy, Mme de Boulancy, fait publier dans Le Figaro des lettres dans lesquelles il exprimait violemment, une dizaine d'années plus tôt, toute sa haine de la France et son mépris de l'Armée française.
Une partie de la presse vole au secours du traître au travers d'une campagne antisémite sans précédent.

Mais la presse dreyfusarde réplique, forte des nouveaux éléments en sa possession. Georges Clemenceau, dans le journal L’Aurore, se demande :
« Qui protège le commandant Esterházy ? La loi s'arrête, impuissante devant cet aspirant prussien déguisé en officier français. Pourquoi ? Qui donc tremble devant Esterházy ? Quel pouvoir occulte, quelles raisons inavouables s'opposent à l'action de la justice ? Qui lui barre le chemin ? Pourquoi Esterhazy, personnage dépravé à la moralité plus que douteuse, est-il protégé alors que tout l’accuse ? Pourquoi un honnête soldat comme le lieutenant-colonel Picquart est-il discrédité, accablé, déshonoré ? S'il le faut nous le dirons! »
Bien que protégé par l'État-major et donc par le gouvernement, Esterházy, est obligé d’avouer la paternité de lettres francophobes publiées par Le Figaro.
Ceci décide le bureau de l’État-major, les membres de la Sainte Arche, à agir : une solution pour faire cesser les questions, les doutes et les débuts de demande de justification doit être trouvée. L'idée est d'exiger d'Esterházy qu'il demande lui-même à passer en jugement et être acquitté. Alors les bruits cesseront et tout rentrera dans l’ordre.
C'est donc pour le disculper définitivement, selon la vieille règle « Res judicata pro veritate habetur »[99], qu'Esterházy est présenté le 10 janvier 1898 devant un Conseil de guerre.
Le huis clos « retardé »[100] est prononcé. Il est prévenu des sujets du lendemain avec des indications sur la ligne de défense à tenir.
Le procès est un festival d'impudences : les constitutions de parties civiles demandées par Mathieu et Lucie Dreyfus[101] leur sont refusées, les trois experts en écritures ne reconnaissent pas l'écriture d'Esterházy dans le bordereau et concluent à la contrefaçon[102].
L'accusé lui-même est applaudi, les témoins à charge, hués et conspués, Pellieux intervient pour défendre l'État-major sans qualité légale[103].
Bref une véritable comédie, une parodie de justice s'il en fut jamais.
Le véritable accusé est le colonel Picquart, sali par tous les protagonistes militaires de l'Affaire[104].
L'accusé est acquitté à l'unanimité dès le lendemain, après trois minutes de délibéré[105]. Sous les cris de « vive Esterházy », il a du mal à se frayer un chemin vers la sortie où l'attendent 1 500 personnes. Mais l'État-major est allé trop loin. Le scandale est immense et ne restera pas sans réponse.
Les réactions à l'acquittement d'Esterházy

L'acquittement d'Esterházy amène un changement de stratégie dreyfusarde. Au libéralisme de Scheurer-Kestner et Reinach, succède une action plus combative et contestataire[106].
Un mouvement dit dreyfusard s'est déjà formé pour défendre Alfred Dreyfus, animé par Bernard Lazare, Mathieu Dreyfus, Joseph Reinach et Auguste Scheurer-Kestner. De proche en proche, ils parviennent à convaincre de plus en plus d'élites. Parmi eux, on trouve des hommes de lettres : Émile Zola comme on l'a vu, mais aussi Octave Mirbeau, Anatole France, Marcel Proust, Lucien Herr). Des scientifiques, des universitaires et des savants comme Arthur Giry, Auguste Molinier, Paul Meyer et surtout Émile Duclaux, personnage considérable de la science française, directeur de l'Institut Pasteur. Il sont qualifiés pour la première fois d'« intellectuels »[107].
On trouve également des catholiques ou libre penseurs, et de nombreux protestants tels que Raoul Allier. C'est à l'occasion de l'affaire Dreyfus que la Ligue française pour la défense des droits de l'Homme et du citoyen est créée, afin d'affirmer la prédominance des doits individuels sur les excès de la raison d'État.
Le monde politique n'est pas en reste. Jean Jaurès défendra aussi Dreyfus, publiant le 11 octobre, dans La Petite République, une série d'articles intitulés Les Preuves. Georges Clemenceau et son frère Albert, Léon Blum, qui tente de convaincre Barrès, sans succès.
En réaction à l'acquittement, d'importantes émeutes antidreyfusardes et antisémites, d'une violence jamais atteinte, ont lieu dans toute la France. On attente aux biens et aux personnes. Par ailleurs, les réactions de l’État-major sont vives. Fort de cette victoire éclatante, l'heure est en effet venue des règlements de compte. Le lieutenant-colonel Picquart, est lui-même arrêté sous l'accusation de violation du secret professionnel, accusé d'avoir divulgué son enquête à son avocat qui l'aurait révélée au sénateur Scheurer-Kestner.
Le colonel Picquart aurait pu s'arrêter là, revenir en arrière, se protéger. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il va s'engager de plus en plus dans l'Affaire par honneur. Il est, avec quelques autres, l'un des artisans majeurs de la révision.
En attendant, il est l'objet des pires vexations, d'humiliations, mis aux arrêts au Mont-Valérien. On veut briser sa carrière s'il ne rentre pas dans le rang. À Mathieu qui le remercie, il réplique sèchement qu'il ne « fait que son devoir »[108].
Le commandant Esterházy, sera mis rapidement à la réforme, et devant les risques qui pèsent à son égard, ne tardera pas à s'exiler en Angleterre où il terminera ses jours confortablement dans les années 1920[109]. Il est clair qu'Esterházy bénéficia, au moment de « L'Affaire », d'un traitement de faveur de la part des hautes sphères de l'Armée. Ce traitement s'explique assez mal, sinon par le désir de l'État-major de vouloir étouffer toute velléité de remise en cause du verdict du Conseil de guerre qui avait condamné le capitaine Dreyfus en 1894.
L'affaire explose 1898
J'accuse : l'affaire Dreyfus devient l'Affaire

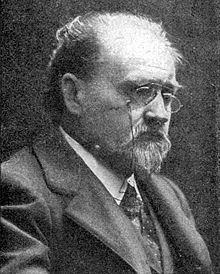
Émile Zola est au sommet de sa gloire. Il a publié les vingt volumes des Rougon-Macquart, diffusés dans des dizaines de pays. Il est une sommité du monde littéraire, et en a pleinement conscience. Au général de Pellieux, il dira pendant son procès :
« Je demande au général de Pellieux s'il n'y a pas différentes façons de servir la France ? On peut la servir par l'épée ou par la plume. M. le général de Pellieux a sans doute gagné de grandes victoires ! J'ai gagné les miennes. Par mes œuvres, la langue française a été portée dans le monde entier. J'ai mes victoires ! Je lègue à la postérité le nom du général de Pellieux et celui d'Émile Zola : elle choisira[110]! »
Par son engagement personnel, Zola donne une nouvelle dimension à l'affaire Dreyfus, qui devient l'Affaire.
Mi-novembre 1897, Auguste Scheurer-Kestner présente à Zola l'ensemble du dossier Dreyfus, et le convainc de l'erreur judiciaire.
C'est le début de l'engagement officiel du romancier[111].
Le 25 novembre, Émile Zola publie M. Scheurer-Kestner dans Le Figaro, premier article d'une série qui en comptera trois[112].
Devant les menaces de désabonnements massifs de ses lecteurs, le directeur du journal cesse de soutenir Zola[113].
Le 13 janvier 1898, scandalisé par l'acquittement d'Esterházy, Zola décide de procéder à un acte révolutionnaire.
Il publie en première page de L'Aurore, un énorme article de 4 500 mots, en forme de lettre ouverte, en forme de lettre ouverte au président Félix Faure.
Clemenceau, trouve le titre : J'accuse.
Vendu habituellement à trente mille exemplaires, le journal diffuse ce jour là près de trois cent mille copies.
Cet article fait l'effet d'une bombe.
Le papier est une attaque directe, explicite et nommée. Tout le monde y passe : le ministre de la Guerre, l'État-major, bref tous les complices du complot qui ont envoyé le capitaine Dreyfus au bagne.
L'article lui même comporte de nombreuses erreurs, en majorant ou minorant les rôles de tel ou tel acteur. Le rôle du général Mercier est fortement sous-estimé.
L'auteur n'a pas prétendu faire œuvre d'historien[114].
Mais il apporte pour la première fois la réunion de toutes les données existantes sur l'Affaire[115].
Le but premier de Zola est de s'exposer volontairement afin de forcer les autorités à le traduire en justice.
Son procès servirait d'occasion pour un nouvel examen publique des cas Dreyfus et Esterházy.
Il va ici à l'encontre de la stratégie de Scheurer-Kestner et Lazare, qui prônaient la patience et la réflexion[116].
Devant le succès national et international de ce coup d'éclat, le procès est inévitable.
À partir de ce moment critique, l'Affaire va suivre deux voies parallèles. D'une part, l'État va utiliser son appareil pour imposer la limitation du procès à une simple affaire de diffamation, afin de dissocier les cas Dreyfus et Esterházy, déjà jugés.
D'autre part, les conflits d'opinion tenteront de peser sur les juges ou le gouvernement, pour obtenir les uns la révision et les autres la condamnation de Zola.
Mais l'objectif du romancier est atteint : l'ouverture d'un débat public aux assises.
Les procès Zola

Le général Billot porte plainte contre Zola qui passe devant les Assises de la Seine du 7 au 23 février 1898.
Le ministre ne retient que trois passages de l'article [117], dix-huit lignes, qui en compte plusieurs centaines.
Il est reproché à Zola d'avoir écrit que le Conseil de guerre avait commis une « illégalité » « par ordre »[118]. Le procès s’ouvre dans une ambiance terrible.
Les journaux se sont acharnés contre les partisans de Dreyfus en général et surtout contre Zola.
Il est traité d'italien, d'émigré et d'apatride.
Les passions se déchaînent, la population prend position plus nettement, manipulée par la presse.
Fernand Labori, l’avocat de Zola, fait citer environ deux cents témoins.
Le but de l’opération est de permettre aux dreyfusards de parler des anomalies du dossier Dreyfus.
C’est pour les avoir dénoncées ouvertement que Zola se retrouve devant les Assises.
Mais c'est aussi le moyen d'étaler dans la presse la réalité de l'Affaire Dreyfus, inconnue du public jusqu'à présent.
Plusieurs journaux[119] publient en effet les notes sténographiques in extenso des débats presque en direct, ce qui édifie la population.
Ce sera aussi un outil incontestable dans les batailles futures, auquel les dreyfusards vont constamment se référer.
Mais pour l'heure, les nationalistes sont maîtres du palais et organisent des émeutes, forçant le préfet de police à intervenir afin de protéger les sorties de Zola à chaque audience[120].
Ce procès est aussi le lieu d'une véritable bataille juridique, dans laquelle les droits de la défense sont sans cesse bafoués. C'est le moment d'une prise de conscience pour beaucoup d'observateurs, celle de la collusion entre le monde politique et les militaires. À l'évidence, la Cour a reçu des instructions pour étouffer les débats. Le président Delegorgue apparaissant obnubilé par la longueur des audiences, doit jongler sans cesse avec le droit pour que le procès de 1894 ne soit surtout pas l'objet des interventions. Sa litanie célèbre, « la question ne sera pas posée » sera répétée des dizaines de fois[121]. Voici un échange parmi d'autres entre l'avocat de la défense et le président de la Cour d'assise :

« Me Labori. - Mais j'ai une question à poser.
M. Le président. - Vous ne la poserez pas.
Me Labori. - J'insiste, monsieur le Président.
M. Le président. - Je vous dis que vous ne la poserez pas.
Me Labori. - Oh ! monsieur le Président ! Il est intéressant...
M. Le président. - C'est inutile de crier si fort.
Me Labori. - Je crie parce que j'ai besoin de me faire entendre.
M. Le président. - La question ne sera pas posée.
Me Labori. - Permettez, vous dites cela ; mais je dis que je veux la poser.
M. Le président. - Eh bien ! je dis que non, et c'est une affaire entendue ! Le Président doit écarter du débat tout ce qui peut allonger les débats sans aucune utilité ; c'est mon droit de le faire.
Me Labori. - Vous ne connaissez pas la question ; vous ne savez pas quelle est la question.
M. Le président. - Je sais parfaitement ce que vous allez demander[122]. »
De fait, on a bien parlé de l’Affaire, mais Zola est condamné à un an de prison et à 3 000 francs d'amende (c'est Octave Mirbeau qui paiera de sa poche les 7 525 francs, représentant le montant de l'amende et des frais de justice, le 8 août 1898).
Le procès Zola est un tournant qui permet la publicité des pièces et la mise en lumière de nombreuses contradictions.
Le 2 avril, une demande de pourvoi en cassation reçoit une réponse favorable.
Il s'agit de la première intervention de la Cour suprême dans cette affaire judiciaire, premier barrage à la raison d'État.
La plainte aurait en effet dû être portée par le Conseil de guerre et non par le ministre.
Le procureur général Manau est favorable à la révision du procès Dreyfus et s’oppose fermement aux antisémites.
Les juges du Conseil de guerre, mis en cause par Zola, portent plainte pour diffamation. L’affaire est déférée à Versailles où, pense-t-on, le public est plus favorable à l’Armée, plus nationaliste. Le 23 mai 1898, dès la première audience, Me Labori se pourvoit en cassation en raison du changement de juridiction. Le procès est ajourné et les débats sont repoussés au 18 juillet. Ce nouveau procès aboutit à une nouvelle condamnation des accusés ; Zola quitte la France et rejoint Londres. Quant à Picquart, il se retrouve à nouveau en prison.
La mort de Henry, le faussaire démasqué

L'acquittement d'Esterházy et les condamnations d'Émile Zola et de Georges Picquart, sans compter le fait qu'un innocent purge en ce moment même une peine indigne, ont un retentissement national et international considérables.
La France, démocrate et républicaine, patrie des droits de l'homme, qui prétend diffuser la philosophie humaniste des Lumières, expose un arbitraire étatique au bord de la caricature.
L'antisémitisme a fait des progrès considérables, et les émeutes sont courantes pendant toute l'année 1898.
Les révisionistes ont eux aussi progressé en exposant toutes les contradictions de l'Affaire.
Ils rassemblent autour d'eux de plus en plus d'indignés.

Godefroy Cavaignac, nouveau ministre de la Guerre et anti-révisionniste farouche, veut démontrer une bonne fois pour toute la culpabilité de Dreyfus, en tordant le cou à Esterházy au passage.
Il le tient en effet pour « un mythomane et un maître chanteur »[123].
Cavaignac a l'honnêteté d'un doctrinaire intransigeant[124], mais il ne connaît absolument pas les dessous de l'Affaire.
Il avait eu la surprise d'apprendre que l'ensemble des pièces sur lesquelles l'accusation se basait, n'avaient pas été expertisées.
Boisdeffre ayant « une confiance absolue » en Henry.
Alors il décide d'enquêter lui-même, dans son bureau avec ses adjoints, et rapatrie le dossier secret qui compte alors 365 pièces[125].
Il est absolument convaincu de la culpabilité de Dreyfus, renforcé dans cette idée par la légende des aveux, après avoir rencontré le principal témoin, le capitaine Lebrun-Renault[126].
Le 7 juillet 1898, lors d'une interpellation à la Chambre, Cavaignac fait état de trois pièces « accablantes, entre mille ».
La conviction des députés est unanime, foudroyante[127].
Son discours est affiché dans les 36 000 communes de France, avec la reproduction des trois preuves.
Les antidreyfusards jubilent et portent Cavaignac en triomphe. Mais leur joie est de courte durée.
Jaurès, dans un long article, démolit la démonstration du ministre.
Par ailleurs, le colonel Picquart écrit le 8 juillet au président du Conseil :
« Je suis en état d'établir devant toute juridiction compétente que les deux pièces portant la date de 1894 ne sauraient s'appliquer à Dreyfus et que celle qui portait la date de 1896 avait tous les caractères d'un faux. »
Le ministre fait une nouvelle fois vérifier ses documents.
Le 13 août au soir, coup de théâtre, le capitaine Cuignet découvre la supercherie.
La missive qui désigne Dreyfus en toutes lettres, la base des certitudes de l'État-major depuis deux ans, est un faux, un faux grossier, le faux Henry.
Tout l'édifice s'écroule.
Cavaignac tente encore de trouver des raisons logiques à la culpabilité et la condamnation de Dreyfus, contre l'évidence[128].
Mais tout à son honneur, il ne tait pas sa découverte.[129]
Un conseil d'enquête est formé contre Esterházy, devant lequel celui-ci panique.
Il avoue ses rapports avec le commandants du Paty de Clam.
La collusion entre l'État-major et le traître est avérée.
Le 30 août, Cavaignac se résigne à demander des explications au colonel Henry, en présence de Boisdeffre et Gonse.
Au bout d'une heure d'interrogatoire mené par me ministre lui-même, Henry s'effondre et fait des aveux complets[130]. Il est mis aux arrêts de forteresse au Mont-Valérien. Il se suicide[131] le lendemain en se tranchant la gorge avec un rasoir.
Les généraux de Boisdeffre et Gonse démissionnent, « dupes de gens sans honneur ».
Preuve de l'intoxication des esprits, apparaît alors la notion de « faux patriotique » et La Libre Parole, journal violemment antisémite, lance une souscription au profit de sa veuve, le monument Henry. Chaque donation est accompagnée de remarques lapidaires sur Dreyfus et les Dreyfusards, témoignage de la bêtise et de la méchanceté humaines. Quatorze mille souscripteurs, dont 53 députés, envoyèrent 131 000 francs[132].
La révision est désormais inévitable.
Pourtant, Cavaignac affirme : « moins que jamais ! »
Mais le président du Conseil, Henri Brisson, le force à démissionner.
Malgré son rôle, apparemment totalement involontaire, dans la révision du procès de 1894, il restera un antidreyfusard convaincu et fera une intervention méprisante et blessante envers Dreyfus au procès de Rennes.
Le gouvernement transfert donc le dossier à la Cour de cassation, pour avis sur les quatre années de procédures passées.
La révision inéluctable provoque une crise du régime
Le régime au bord de l'implosion
Henry est mort, Boisdeffre a démissionné, Gonse n'a plus aucune autorité et du Paty a été très gravement compromis par Esterházy : pour les conjurés, c'est la débâcle[133].
Le gouvernement est désormais pris entre deux feux : la loi et le droit contre la pression nationaliste de la rue et du commandement supérieur qui se reprend.
Le 3 septembre 1898, le président du Conseil, Brisson, incite Mathieu Dreyfus à déposer une demande en révision du Conseil de guerre de 1894. Cavaignac, démissionné, pour avoir continué à répandre sa vision antidreyfusarde de l'affaire, se pose en chef de file antirévisionniste. C'est la crise politique. Le général Zurlinden lui succède.
Mais « travaillé » par l'État-major, il est vite « retourné » et rend un avis négatif à la révision le 10 septembre, conforté par la presse extrémiste pour laquelle, « la révision, c'est la guerre ».
L'obstination du gouvernement, qui vote le recours à la Cour de cassation le 26 septembre, amène la démission de Zurlinden, remplacé aussitôt par le général Chanoine[134].
Celui-ci, lors d'une interpellation à la Chambre, donne sa démission, la confiance étant refusée à Brisson, contraint lui aussi à la démission. Le discrédit est total.
Le 4 novembre, le progressiste Charles Dupuy est nommé à sa place.
Quatre ans plus tôt, il avait couvert les agissements du général Mercier aux débuts de l'affaire Dreyfus ; mais aujourd'hui, il annonce qu'il suivra les arrêts de la Cour de cassation, barrant la route à ceux qui veulent étouffer la révision et dessaisir la Cour.
le 5 décembre, à la faveur d'un débat à la Chambre sur la transmission du « dossier secret » à la Cour de cassation, la tension monte encore d'un cran.
Les injures, invectives et autres violences nationalistes font place aux menaces de soulèvement. Paul Déroulède déclare : « s'il faut faire la guerre civile, nous la feront. »
Une nouvelle crise survient au sein même de la Cour de cassation, dès lors que Quesnay de Beaurepaire, président de la chambre civile, accuse la chambre criminelle de dreyfusisme par voie de presse. Il démissionne le 8 janvier 1899 en héros de la cause nationaliste. Cette crise aboutit au dessaisissement de la chambre criminelle au profit des chambres réunies. C'est le blocage de la révision[135].
Survient alors un de ces clins d'œil de l'Histoire, qui, sous des dehors de scandale mondain, amènent subitement une issue devant la muraille. Le 16 février 1899 le président de la République Félix Faure décède dans des conditions rocambolesques. Émile Loubet est élu, une avancée pour la cause de la révision, car le précédent président en était un farouche opposant. Le 23 février, à la faveur des funérailles de Félix Faure, Paul Déroulède tente un coup de force sur l'Élysée. C'est un échec, les militaires ne s'étant pas ralliés en définitive. La République tremble mais ne s'écroule pas.
Le 28 février, Waldeck-Rousseau s'exprime au Sénat sur le fond et dénonce la « conspiration morale » au sein du gouvernement et dans la rue. La révision n'est plus évitable.
La Cour de cassation rend la Justice

Dans ce contexte de grave crise républicaine, alimentée de campagnes de presse grossièrement conflictuelles à l'encontre de la chambre criminelle[136], la Cour de cassation va commencer à rendre la Justice.
Les magistrats qui payaient encore le désastre du scandale de Panamá, étaient constamment traînés dans la boue dans les journaux nationalistes.
Le 26 septembre 1898, après à un vote du Cabinet, le garde des Sceaux saisit la Cour de cassation.
Le 29 octobre, à l'issue de la communication du rapport du rapporteur Alphonse Bard, la chambre criminelle de la Cour déclare « la demande recevable et dit qu'il sera procédé par elle à une instruction supplémentaire »[137].
Le rapporteur Louis Loew préside. Il est l'objet d'une très violente campagne d'injures antisémite, alors qu'il est protestant alsacien, accusé d'être un déserteur, un vendu aux Prussiens.
Malgré les silences complaisants de Mercier, Billot, Zurlinden et Roget qui se retranchent derrière l'autorité de la chose jugée et le secret d'État, la compréhension de l'Affaire s'illumine de détails ignorés auparavant.
Cavaignac fait une déposition de deux jours, mais ne parvient pas à démontrer la culpabilité de Dreyfus.
Au contraire il le disculpe aussi brillamment qu'involontairement par une démonstration de la datation exacte du bordereau (août 1894).
Puis Picquart démontre par sa calme précision l'ensemble des rouages de l’erreur puis de la conspiration.
Dans une décision du 8 décembre 1898 en représailles au dessaisissement qui s'annonce, Picquart est écarté du Conseil de guerre par la chambre criminelle.
C'est un nouvel obstacle aux volontés souveraines de l’État-major.
Une nouvelle campagne de presse furieusement antisémite éclate à cette nouvelle.
Le travail d'enquête est tout de même repris par la chambre criminelle[138].
Le « dossier secret » est analysé à partir du 30 décembre, et la chambre demande la communication du dossier diplomatique, ce qui est accordé.
Parallèlement, pour faire suite à l'incident de Beaurepaire, le président Mazeau instruit une enquête sur la chambre criminelle, qui aboutira au dessaisissement de celle-ci « afin de ne pas la laisser porter seule toute la responsabilité de la sentence définitive ».
Le 9 février, la chambre criminelle rend son rapport en mettant en exergue deux faits majeurs : il est certain qu'Esterházy a utilisé le même papier pelure que le bordereau[139] et le dossier secret est totalement vide.
Ces deux fait majeurs anéantissent à eux seuls toute les procédures à l'encontre d'Alfred Dreyfus.
Mais une loi de dessaisissement prive la chambre criminelle de la poursuite des actions qui découleraient de son rapport.
Le 1er mars 1899, le nouveau président de la chambre civile de la Cour de cassation, Alexis Ballot-Beaupré est nommé rapporteur pour l'examen de la demande de révision.
Il aborde le dossier en juriste et décide d'un supplément d'enquête. Dix témoins complémentaires sont interrogés, lesquels affaiblissent encore la version de l'État-major. Dans le débat final et par un modèle d'objectivité, le président Ballot-Beaupré détruit la seule pièce à charge contre Dreyfus : le bordereau.
Le procureur Manau abonde dans le sens du président.
Me Mornard qui représente Lucie Dreyfus plaide sur du velours[140].
Le 3 juin 1899, les chambres réunies de la Cour de cassation cassent le jugement de 1894 en audience solennelle[141].
L’affaire est renvoyée devant le Conseil de guerre de Rennes.
Les conséquences sont immédiates : Zola, exilé en Angleterre, revient en France, Picquart est libéré, Mercier est accusé de communication illégale de pièces.
Par cet arrêt, la Cour de cassation s'impose comme une véritable autorité, capable de tenir tête à l'armée et au pouvoir politique[142].
Pour de nombreux Dreyfusards cette décision de justice est l'anti-chambre de l'acquittement du martyre.
C'est sans doute oublier un peu vite que la Cour place le destin de l'accusé entre les mains d'une armée humiliée.
On a démontré ses grossières erreurs, et même, plusieurs de ses membres sont des faussaires avérés.
Dès lors, le débat portera sur le respect strict ou non de l'arrêt de renvoi par le Conseil de guerre.
L'organe militaire a-t-il une autonomie juridique comme l'affirme à dessein la presse nationaliste ?
Reste que la Cour, en cassant avec renvoi, a cru en la Justice souveraine et universellement partagée.
Elle a oublié, ou feint d'oublier que l'esprit de corps peut obéir à d'autres lois[143].
Le procès de Rennes 1899
Déroulement du procès


Le prisonnier n'était au courant en rien des événements qui se déroulaient à des milliers de kilomètres de lui.
Ni des complots ourdis pour que jamais il ne puisse revenir, ni de l'engagement d'innombrables honnêtes hommes et femmes à sa cause. L'administration pénitentiaire avait filtré des informations qu'elle jugeait confidentielles, véritable abus de pouvoir.
À la fin de l'année 1898, il apprend avec stupéfaction la dimension réelle de l'Affaire, dont il ignorait tout : l'accusation de Mathieu contre Esterházy, son acquittement, l'aveu et le suicide d'Henry, ceci à la lecture du dossier d'accusation de la Cour de cassation qu'il reçoit deux mois après sa publication[144].
Le 5 juin 1899, Alfred Dreyfus est prévenu de la décision de cassation du jugement de 1894.
Le 9 juin, il quitte l'île du diable, cap vers la France, enfermé dans une cabine comme un coupable qu'il n'est pourtant plus.
Il débarque le 30 juin à Port Haliguen, sur la presqu'île de Quiberon, dans le plus grand secret « par une rentrée clandestine et nocturne »[145]. Après cinq années de martyre, Il retrouve le sol natal, mais enfermé dès le 1er juillet à la prison militaire de Rennes.
Il est déféré le 7 août devant le Conseil de guerre de la capitale bretonne.
Le Général Mercier, champion des antidreyfusards, intervient constamment dans la presse, pour affirmer l'exactitude du premier jugement : Dreyfus est bien le coupable.
Immédiatement, des dissensions se font jour dans la défense de Dreyfus.
Ses deux avocats sont sur des stratégies opposées.
Me Demange souhaite jouer la défensive et obtenir simplement l'acquittement de Dreyfus.
Me Labori, brillant avocat de 35 ans cherche à frapper plus haut, il veut la défaite de l'État-major, son humiliation publique.
Mathieu Dreyfus a imaginé une complémentarité entre les deux avocats.
Le déroulement du procès montrera l'erreur, dont va se servir l'accusation devant une défense si affaiblie.

Le procès s’ouvre le 7 août 1899 dans un climat de violence inouïe.
Rennes est en état de siège[146].
Les juges du Conseil de guerre sont sous pression.
Esterházy, qui a avoué la paternité du bordereau, en exil en Angleterre, et du Paty, se sont fait excuser. Dreyfus apparaît, l’émotion est forte. Son apparence physique bouleverse ses partisans et certains de ses adversaires[147]. Malgré sa condition physique dégradée, il a une maîtrise complète du dossier, acquise en seulement quelques semaines[148].
Tout l'État-major témoigne contre Dreyfus sans apporter aucune preuve.
On ne fait que s’entêter et on considère comme nuls les aveux d’Henry et d’Esterházy.
Pourtant, Mercier se fait huer à la sortie de l'audience.
La presse nationaliste et antidreyfusarde se perd en conjectures sur son silence à propos de la preuve décisive dont il n'avait cessé de faire état avant le procès[149].
Le 14 août, Me Labori est victime d'un attentat sur son parcours vers le tribunal. Il se fait tirer dans le dos par un extrémiste qui s'enfuit.
Il est écarté des débats pendant plus d'une semaine, au moment décisif de l'interrogatoire des témoins.
Le 22 août, il est de retour.
Les incidents entre les deux avocats de Dreyfus se multiplient, Labori reprochant à Demange sa trop grande prudence.
Le gouvernement, devant le raidissement militaire du procès pouvait agir encore de deux manières pour infléchir les événements ; en faisant appel à un témoignage de l'Allemagne ou par l'abandon de l'accusation[150].
Mais ces tractations en arrière plan sont sans résultats.
L'ambassade d'Allemagne adresse un refus poli au gouvernement.
Le ministre de la guerre, le général Galliffet, fait envoyer un mot respectueux au commandant Carrière, procureur à Rennes.
Il lui demande de rester dans l'esprit de l'arrêt de révision de la Cour de cassation.
L'officier feint de ne pas comprendre l'allusion et aidé de l'avocat nationaliste Auffray, âme véritable de l'accusation, il fait un réquisitoire contre Dreyfus.
Du côté de la défense, il faut prendre une décision, car l'issue du procès s'annonce mal.
Malgré l'évidence de l'absence de charges contre l'accusé.
Au nom du président du Conseil, Waldeck-Rousseau, aidé de Jaurès et Zola, Me Labori est convaincu de renoncer à sa plaidoirie pour ne pas heurter l'armée.
On décide de jouer la conciliation en échange de l'acquittement que semble promettre le gouvernement. Mais c'est un nouveau jeu de dupes[151].
Me Demange, seul et sans illusions, assure la défense de Dreyfus, dans une atmosphère de guerre civile.
A Paris, les agitateurs antisémites et nationalistes d’Auteuil sont arrêtés. Jules Guérin et ceux qui se sont enfuis et retranchés dans le Fort Chabrol sont assaillis par la police.
Nouvelle condamnation

Le 8 septembre 1899, la Cour rend son verdict : Dreyfus est reconnu coupable de trahison mais « avec circonstances atténuantes » (par 5 voix contre 2) et condamné à dix ans de réclusion et à une nouvelle dégradation. Ce verdict est au bord de l'acquittement à une voix près, puisque le code de justice militaire prévoyait le principe de minorité de faveur à trois voix contre quatre[152].
Ce verdict absurde[153] a les apparences d'un aveu coupable des membres du Conseil de guerre.
Ils semblent ne pas vouloir renier la décision de 1894, et savent bien que le dossier ne repose que sur du vent.
Mais c'est surtout un verdict habile car tout en ménageant leurs pairs ainsi que les modérés angoissés par les risques de guerre civile, la Cour reconnaît implicitement l'innocence de Dreyfus (Peut-on trahir avec des circonstances atténuantes ?)[154].
Le lendemain du verdict, Alfred Dreyfus, après avoir beaucoup hésité, dépose un pourvoi en révision. Waldeck-Rousseau, dans une position difficile, aborde pour la première fois la grâce. Pour Dreyfus, c'est accepter la culpabilité. Mais à bout de force, éloigné des siens depuis trop longtemps, il accepte. Le décret est signé le 19 septembre et il est libéré le 21 septembre 1899. Nombreux sont les dreyfusards frustrés par cet acte final. L'opinion publique accueille cette conclusion de manière indifférente. La France aspire à la paix civile et à la concorde à la veille de l'exposition universelle de 1900 et avant le grand combat que la République s'apprête à mener pour la liberté des associations et la laïcité.
C'est dans cet esprit que le 17 novembre 1899, Waldeck-Rousseau dépose une loi d’amnistie couvrant « tous les faits criminels ou délictueux connexes à l’Affaire Dreyfus ou ayant été compris dans une poursuite relative à l’un de ces faits ». Les dreyfusards s’insurgent, ils ne peuvent accepter que les véritables coupables soient absous de leurs crimes d'État, alors même que Zola et Picquart doivent toujours passer en jugement. Malgré d'immenses protestations, la loi est adoptée. Il n’existe alors plus aucun recours possible pour obtenir que l’innocence de Dreyfus soit reconnue ; il faut désormais trouver un fait nouveau pouvant entraîner la révision.
Réactions
Les réactions en France, sont vives, faites de « stupeur et de tristesse » dans le camp révisionniste[155]. Pourtant d'autres réactions tendent à montrer que le « verdict d'apaisement » rendu par les juges est compris et accepté par la population.
Les Républicains cherchent avant tout la paix sociale, pour tourner la page de cette longue affaire extrêmement polémique.
Aussi, les manifestations sont très peu nombreuses en province, alors que l'agitation persiste quelque peu à Paris[156].
Dans le monde militaire, l'appaisement est aussi de rigueur.
Deux des sept juges ont voté l'acquittement[157].
Ils ont refusé de céder à l'ordre militaire implicite.
Ceci est aussi clairement perçu. Dans une apostrophe à l'armée, Galliffet annonce : « l'incident est clos ».
Dans vingt capitales étrangères, des manifestations anti-françaises ont lieu, la presse est scandalisée[158]. Les réactions sont de deux ordres. Les Anglo-saxons, légalistes, se focalisent sur l'affaire d'espionnage et contestent assez violemment ce verdict de culpabilité sans arguments positifs à son édification. À ce titre, le rapport du Lord Chief Justice d'Angleterre, Lord Russell of Killowen, à la reine Victoria, le 16 septembre 1899 est un symbole de la répercussion mondiale de l'Affaire en Grande-Bretagne. Le magistrat anglais, qui s'était rendu en observateur à Rennes, critique les faiblesses du Conseil de Guerre :
« Les juges militaires « n'étaient pas familiers de la loi » [...]. Ils manquaient de l'expérience et de l'aptitude qui permettent de voir la preuve derrière le témoignage. [...] Ils agirent en fonction de ce qu'ils considéraient comme l'honneur de l'armée. [...] ils accordèrent trop d'importance aux fragiles allégations qui furent seules présentées contre l'accusé. Ainsi conclut-il : Il parait certain que si le procès de révision avait eu lieu devant la Cour de cassation, Dreyfus serait maintenant un homme libre. »
En Allemagne et en Italie, les deux pays largement mis en cause par les procès contre Dreyfus, c'est le soulagement.
Même si l'Empereur d'Allemagne regrette que l'innocence de Dreyfus n'ait pas été reconnue, la normalisation des relations franco prussiennes qui s'annonce est vue comme détente bienvenue. Aucune des nations n'a intérêt à une tension permanente.
La diplomatie des trois puissances, avec l'aide de l'Angleterre, va s'employer à détendre une atmosphère qui ne se dégradera à nouveau qu'à vielle de la Première Guerre mondiale.
Cette conclusion judiciaire a aussi une conséquence funeste sur les relations entre la famille Dreyfus, et la branche ultra des dreyfusistes. Fernand Labori, Jaurès et Clemenceau, avec le consentement du général Picquart, reprocheront ouvertement à Alfred Dreyfus d'avoir accepté la grâce et d'avoir mollement protesté à la loi d'amnistie.
En deux ans après cette conclusion, leur amitié se finissait ainsi, en de sordides calculs[159].
La longue marche vers la réhabilitation - 1900-1906
Préférant éviter un troisième procès, le gouvernement décide de gracier Dreyfus, décret que signe le président Loubet le 19 septembre 1899, après de multiples tergiversations.
Dreyfus n'est pas pour autant innocenté. Le processus de réhabilitation ne sera achevé que six années plus tard, sans éclat ni passion. De nombreux ouvrages paraissent pendant cette période. Outre les mémoires d'Alfred Dreyfus [160], Reinach fait paraître son Histoire de l'Affaire Dreyfus, et Jaurès publie Les Preuves. Quant à Zola, il écrit le troisième de ses Évangiles : Vérité. Même Esterházy en profite par des confidences et vend plusieurs versions différentes des textes de sa déposition au consul de France[161].
Décès de Zola
Un drame de tragédie grecque survient le 30 septembre 1902. Zola, l'initiateur de l'Affaire, le premier des intellectuels dreyfusard, meurt asphyxié par la fumée de sa cheminée. Son épouse, Alexandrine, en réchappe de justesse[162].
C'est le choc dans le clan des dreyfusards.
Anatole France, qui a exigé que Dreyfus soit présent aux obsèques, alors que le Préfet de police souhaitait son absence « pour éviter les troubles », lit sa célèbre oraison funèbre à l'auteur de J'accuse :

« Devant rappeler la lutte entreprise par Zola pour la justice et la vérité, m'est-il possible de garder le silence sur ces hommes acharnés à la ruine d'un innocent et qui, se sentant perdus s'il était sauvé, l'accablaient avec l'audace désespérée de la peur ?
Comment les écarter de votre vue, alors que je dois vous montrer Zola se dressant, faible et désarmé devant eux ?
Puis-je taire leurs mensonges ?
Ce serait taire sa droiture héroïque.
Puis-je taire leurs crimes ?
Ce serait taire sa vertu.
Puis-je taire les outrages et les calomnies dont ils l'ont poursuivi ?
Ce serait taire sa récompense et ses honneurs.
Puis-je taire leur honte ?
Ce serait taire sa gloire.
Non, je parlerai.
Envions-le : il a honoré sa patrie et le monde par une œuvre immense et un grand acte.
Envions-le, sa destiné et son cœur lui firent le sort le plus grand.
Il fut un moment de la conscience humaine. »
La réhabilitation
Les élections de 1902 avaient vu la victoire des gauches. C'est Jean Jaurès, réélu, qui relance l'Affaire le 7 avril 1903 alors que la France la pensait enterrée à jamais. Dans un discours, Jaurès évoque la longue liste des faux qui parsèment le dossier Dreyfus, et insiste particulièrement sur deux pièces saillantes :
- La lettre de démission du général de Pellieux, rédigée en termes très durs. Juridiquement, elle a les formes d'un aveu de la collusion de l'État-major :
« Dupe de gens sans honneurs, ne pouvant plus compter sur la confiance des subordonnés sans laquelle le commandement est impossible, et de mon côté, ne pouvant avoir confiance en ceux de mes chefs qui m'ont fait travailler sur des faux, je demande ma mise à la retraite. »
- Le bordereau prétendument annoté (par Guillaume II) auquel le général Mercier avait fait allusion au procès de Rennes, et dont le fait rapporté par la presse aurait influencé les juges du Conseil de guerre[163],[164].
Devant ces faits nouveaux, le général André, nouveau ministre de la Guerre, mène une enquête à l'instigation d'Émile Combes, assisté de magistrats.
L'enquête est menée par le capitaine Targe, officier d'ordonnance du ministre.
A l'occasion de perquisitions à la Section de statistiques, il découvre de très nombreuses pièces dont la majorité sont des faux fabriqués[165].
En novembre 1903, un rapport est remis au garde des Sceaux par le ministre de la Guerre.
C'était le respect des règles, dès lors que le ministre constate une erreur commise en Conseil de guerre.
C'est le début d'une nouvelle révision, avec une véritable enquête qui va durer deux ans.
(langue non reconnue : affaire + langue non reconnue : dreyfus + langue non reconnue : + langue non reconnue : arrêt + de + la + langue non reconnue : cour + de + langue non reconnue : cassation + langue non reconnue : du + langue non reconnue : 12 + langue non reconnue : juillet + langue non reconnue : 1906) Affaire Dreyfus (Wikisource) Les années 1904 et 1905 sont consacrées aux différentes phases judiciaires devant la Cour de cassation. La cour emploie trois moyens (causes) à la révision :
- démonstration de la falsification du télégramme de Panizzardi.
- démonstration du changement de date d'une pièce du procès de 1894 (avril 1895 changé en avril 1894).
- démonstration du fait que Dreyfus n'avait pas fait disparaître les minutes d'attribution de l'artillerie lourde aux armées.
Concernant l'écriture du bordereau, la cour est particulièrement sévère à l'encontre de Bertillon qui a « raisonné mal sur des documents faux ». Le rapport démontre que l'écriture est bien d'Esterházy, ce que ce dernier a d'ailleurs avoué entre-temps.
Enfin, la Cour démontre par une analyse complète et subtile du bordereau l'inanité de cette construction purement intellectuelle, et une commission de quatre généraux dirigée par un spécialiste de l'artillerie, le général Sebert, affirme « qu'il est fortement improbable qu'un officier d'artillerie ait pu écrire cette missive »[166].
Le 9 mars 1905, le procureur général Baudouin rend un rapport de 800 pages dans lequel il réclame la cassation sans renvoi et fustige l'armée, amorçant un dessaisissement de la justice militaire qui trouvera sa conclusion en 1982[167]. Il faut attendre le 12 juillet 1906 pour que la Cour de cassation, toutes chambres réunies, annule sans renvoi le jugement rendu à Rennes en 1899 et prononce « l'arrêt de réhabilitation du capitaine Dreyfus ». Les antidreyfusards crièrent à la réhabilitation à la sauvette. Mais le but était évidemment politique : il s'agissait d'en finir et de tourner la page définitivement. Rien ne pouvait entamer la conviction des adversaires de Dreyfus. Cette forme était donc la plus directe et la plus définitive. Il faut noter que ce qui est annulé est non seulement l'arrêt de Rennes, mais toute la chaîne des actes antérieurs, à commencer par l'ordre de mise en jugement donné par le général Saussier en 1894. La Cour s'est focalisée sur les aspects juridiques uniquement et constate que Dreyfus ne doit pas être renvoyé devant un Conseil de guerre pour la simple raison qu'il n'aurait jamais dû y passer, devant l'absence totale de charges. « Attendu, en dernière analyse, que de l'accusation portée contre Dreyfus, rien ne reste debout ; et que l'annulation du jugement du Conseil de guerre ne laisse rien subsister qui puisse à sa charge être qualifié crime ou délit ; dès lors, par application du paragraphe final de l'article 445 aucun renvoi ne doit être prononcé. »
Dreyfus est réintégré partiellement dans l'armée au grade de chef d'escadron par la loi du 13 juillet 1906.
Cette décision brisa tout espoir d'une carrière digne de ses succès antérieurs à son arrestation de 1894.
Il fut contraint à la démission en juin 1907.
Cette blessure, la dernière, ne fut-elle pas la pire ?
Les magistrats ne pouvaient rien contre cette ultime injustice volontairement commise.
Le droit et l'égalité avaient été encore une fois bafoués[168].
Il est à noter que Dreyfus n'a jamais demandé aucun dédommagement à l'état, ni dommages et intérêts à qui que ce soit.
La seule chose qui lui importait, c'était la reconnaissance de son innocence.
Officier de réserve, il participe à la guerre de 1914-1918 au camp retranché de Paris, puis comme chef d'un parc d'artillerie.
Il termine sa carrière militaire au grade de colonel[169].
Il décède le 11 juillet 1935.
Le colonel Picquart est lui aussi réhabilité officiellement et réintégré dans l'armée au grade de général de brigade.
Ironie de l'histoire, il sera nommé ministre de la Guerre en 1906 dans le gouvernement Clemenceau jusqu'en 1909.
Il décèdera en 1914 d'un accident de cheval[170].
Notes et références
- A partir de : Jean-Denis Bredin, l'Affaire et Pierre Birnbaum, L'Affaire Dreyfus, la République en péril.
- Miquel, L'affaire Dreyfus, Que sais-je ?, pp. 7 et s.
- Duclert, L'affaire Dreyfus, p. 4-5
- Dreyfus est de Mulhouse, comme Sandherr et Scheurer-Kestner, Picquart est strasbourgeois, Zurlinden est colmarien
- Auguste Scheurer-Kestner dans une allocution au Sénat.
- Duclert, L'affaire Dreyfus, p. 5
- Sur la mise au point du canon de 75 : Doise, Un secret bien gardé, pp. 9 et s.
- Doise, Un secret bien gardé, p. 25
- Bach, L'armée de Dreyfus, p. 534
- Les juifs dans l'armée
- Miquel, La troisième République, p. 391
- Duclert, L'affaire Dreyfus, p. 8
- Espionite aiguë ? Affolement de l'État-major ? Intox du SR français ? Écran de fumée pendant le développement de l'ultra secret canon de 75 ?
- hypothèses car les preuves n'existent pas
- SR pour « Service de renseignements », autrement dit, le contre-espionnage
- Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 1, p. 40-42
- Jargon du SR signifiant : documents récupérés par la femme de ménage de l’ambassade d’Allemagne
- Scénario toujours débattu par de nombreux historiens. Voir Bredin, l’Affaire, p.66, Doise, Histoire militaire de l'affaire Dreyfus p.49 et s., Thomas, L'affaire sans Dreyfus, T1 p. 70. La question est de savoir comment ce document est réellement arrivé entre les mains du SR.
- page écrite sur un papier léger dit « pelure »
- Et non pas en tout petits morceaux. De plus le papier n'était pas froissé. Bredin, l'Affaire, p. 67
- J Doise, p. 55 et s. La seule information importante du document consiste en une note sur le canon de 120, pièce d'artillerie qui ne représentera que 1,4% du parc d'artillerie moderne français en 1914.
- Sur la Section de statistiques, lire Bredin, p. 49-50, Doise p.42-43 et Thomas p. 60-70
- Thomas, l’affaire sans Dreyfus p. 67. Alfred Dreyfus était aussi originaire de Mulhouse
- Bredin, l'Affaire, p.65 et Reinach, et Reinach,Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 1, p. 39
- Birnbaum, L'affaire Dreyfus, p.40
- nota : sur les indication du capitaine Matton, seul artilleur de la Section de statistiques. Trois des documents transmis concernaient l'artillerie de près ou de loin.
- nota : les documents provenaient des 1er, 2e, 3e et 4e bureaux, un stagiaire semblant seul à même de proposer une telle variété de documents, car ils passaient de bureau en bureau pour parfaire leur formation.
- Doise, Histoire militaire… et Bredin, l’Affaire, p.68
- Birnbaum, l'Affaire Dreyfus..., p. 48
- Burns, Une famille…., p.139
- Sandherr était un antisémite forcené. v. Paléologue, l'Affaire Dreyfus et le quai d'Orsay
- Duclert, Alfred Dreyfus, p. 115 et s.
- Birnbaum, L'Affaire Dreyfus, p.38
- Comme le signale d'ailleurs le général Mercier à ses subordonnés
- sur les personnalités de Mercier et du Paty de Clam, lire : Paléologue, L’Affaire Dreyfus et le Quai d’Orsay, p.111 et s., et Guillemin, L’énigme Esterházy, T1 p. 99
- Bredin, l’Affaire, p. 70
- nota : le général rencontre le président de la République, Casimir-Perier, en minimisant l'importance des pièces transmises, ce que Mercier niera ensuite, opposant irréductiblement les deux hommes. v. Procès de Rennes, T1. pp. 60, 149 et 157
- Du général Saussier, gouverneur de la place de Paris notamment
- Thomas, L'affaire sans Dreyfus, p. 141. Hanotaux a fait promettre à Mercier d'abandonner les poursuites si d'autres preuves n'étaient pas trouvées. C'est sans doute l'origine du dossier secret.
- Bredin, l'Affaire, p.72
- expert en écritures à la Banque de France. Son honnête prudence sera vilipendée dans l'acte d'accusation du commandant d'Ormescheville. Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 1, p.311
- Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 1, p.92. Gobert affirme que le texte a été écrit rapidement, excluant la copie
- Procès de Rennes, T2 p. 322. Idée renforcée par la transparence du papier.
- En civil.
- Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 1, p.107
- Rapport de la Cour de Cassation, T1 p.127
- L'ordre d'arrestation avait été signé d'avance.
- Cour de cassation, Duclert, De la justice..., p. 51
- Commandant les prisons militaires de Paris.
- Bredin, l'Affaire, p. 80
- Il traite le rapport de du Paty « d'élucubrations », Bredin, l'Affaire, p.88.
- Cour de cassation, De la justice, p. 103
- Zola, J'accuse.
- L'accusation ne repose que sur l'écriture du bordereau, dont les expertises se contredisent. Bredin, l'Affaire, p. 89
- nota : Titre de l’Intransigeant du 21 décembre 1894
- Procès qui a lieu en la seule présence des magistrats, de l'accusé et de sa défense.
- Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 1, p. 394
- Cour de cassation, De la justice, Duclert, p. 107
- Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 1, p.409 et Doise, Histoire militaire..., p. 87
- Alors qu'il n'était que capitaine, il gagnait des revenus personnels issus de l'héritage de son père et de la dot de sa femme, équivalents à ceux d'un général commandant de région. Doise, l'histoire militaire..., p.38
- Adjoint du chef du SR et découvreur du bordereau
- Composé de sept officiers qui sont à la fois juges et jurés.
- Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 1, p. 411
- En droit militaire français de l'époque, toutes les preuves de culpabilité doivent être remises à la défense afin d'être débattues contradictoirement, ce qui n'était pas le cas de la justice ordinaire.
- Birnbaum, l'Affaire Dreyfus..., p.43
- Il s'agissait en fait d'un dénommé Dubois, identifié par la Section de statistiques depuis un an.
- Cour de cassation, De la justice..., Duclert p. 92
- Rennes, T2, pp. 191 et s.
- Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 1, p.468
- Bredin, l'Affaire, p. 107
- Décision de la Cour de Cassation
- Bredin, l'Affaire, p. 103
- Bredin, l'Affaire, p. 125
- Alfred Dreyfus, Cinq années de ma vie
- Bredin, l'Affaire, p. 132
- Mathieu Dreyfus, L'Affaire telle que je l'ai vécue, Fayard, p. 47
- nota : ami du président Félix Faure
- Bredin, l'Affaire, p. 117
- Lazare, Une erreur judiciaire. La vérité sur l'Affaire Dreyfus, Bruxelles, novembre 1896.
- C’est lui qui avait reçu le capitaine le matin du 15 octobre 1894, lors de la scène de la dictée.
- Bredin, l'Affaire, p. 140
- Sur la personnalité et la vie d'Esterházy, lire Reinach, Histoire de l'Affaire Dreyfus Tome 2, chapitre 1er
- Bredin, l'Affaire, p.142
- Bredin, l'Affaire, p.144
- Birnbaum, l'Affaire Dreyfus..., p. 56
- Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 2,p. 26
- Ce qui pose la question de savoir s'il n'y a pas eu complicité entre les deux hommes. Bredin, p. 144 et Thomas p. 231 sont sceptiques
- Doise, Histoire militaire..., p. 24 et s.
- v. articles de L'Éclair des 10 et 14 septembre 1896, hostiles à Dreyfus, mai révélant l'existence du « dossier secret ». Bredin, l'Affaire, p. 163
- Cassagnac, pourtant violent antisémite, fait paraître un article intitulé le doute, mi-septembre 1896
- Bredin, l'Affaire, p. 167
- Autrement appelé « faux patriotique » par les antidreyfusards
- Alexandrine, signature usuelle de Panizzardi.
- Bredin, l'Affaire, p.168
- Doise, Histoire militaire..., p. 109 et s.
- Bredin, l'Affaire, p. 200
- Thomas, l'Affaire sans Dreyfus, p. 475
- Bredin, L'Affaire, p. 207
- La chose jugée est tenue pour véridique
- La salle sera vidée dès que les débats aborderont des sujets touchant à la défense nationale, c'est à dire le témoignage de Picquart.
- Appelée à la barre, le président Delegorgue refuse de l'interroger
- Thomas, l'Affaire sans Dreyfus, T2 p. 244
- Duclert, L'affaire Dreyfus, p.39
- Thomas, l'Affaire sans Dreyfus, T2 p. 245
- Bredin, l'Affaire, p. 227
- Duclert, l'affaire Dreyfus, p.40
- Mot en vogue dans les années 1870, repris par Clemenceau
- Bredin, l'Affaire, p. 227
- Dictionnaire de l'affaire Dreyfus, Thomas, entrée Esterházy en Angleterre
- Procès Zola, T1 p. 268
- nota : bien qu'il soit déjà intervenu dans Le Figaro en mai 1896, dans un article Pour les juifs
- Suivi du Syndicat le 1er décembre et de Procès-verbal le 5 décembre
- Zola, Combat pour Dreyfus, p. 44
- Bredin, l'Affaire, p. 234
- Duclert, l'affaire Dreyfus, p. 42
- Bredin, l'Affaire, p. 236
- Miquel, Que sais-je, L'affaire Dreyfus, p. 45
- Cour de Cassation, De la Justice..., Pagès p. 143.
- Le Siècle et L'Aurore
- Duclert, l'affaire Dreyfus, p. 44
- Voir l'intégralité des débats de 1898
- Procès Zola, T1 p. 503-504
- Bredin, l'Affaire, p. 287
- Thomas, l'Affaire sans Dreyfus, T2, p.262
- Bredin, l'Affaire, p. 279
- Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 4 p. 5
- Bredin, l'Affaire, p. 288
- Duclert, l'Affaire Dreyfus, p. 48
- Bredin, l'Affaire, p. 301
- Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, Tome 4 p. 183 et s.
- Les circonstances du décès d'Henry ne sont toujours pas éclaircies et ont nourri quelques fantasmes. L'assassinat est peu probable. Miquel, l'Affaire Dreyfus, Que sais-je ? p. 74
- Miquel, L'affaire Dreyfus, Que sais-je, p. 92
- Bredin, l'Affaire, p. 307
- Duclert, L'affaire Dreyfus, p.50
- Duclert, L'affaire Dreyfus, p. 53
- Miquel, L'affaire Dreyfus, Que sais-je, p. 91
- Cour de cassation, La première révision, Royer-Ozaman, p. 182
- Duclert, L'affaire Dreyfus, p. 52
- La Cour a fait réaliser plusieurs expertises scientifiques minutieuses afin de conclure à des certitudes.
- v. Débats de la Cour de Cassation en vue de la révision
- v. arrêt de la Cour du 3 juin 1899
- Cour de cassation, La première révision, Royer et Ozaman, p. 210
- Cour de cassation, La première révision, Royer et Ozaman, p. 211
- Duclert, Alfred Dreyfus, p. 543
- Jean Jaurès, in L'Humanité du 4 juillet 1899
- Mathieu Dreyfus, L'Affaire..., pp. 206 et s.
- Maurice Barres fait une description poignante de Dreyfus
- Duclert, Alfred Dreyfus, p. 562
- Le pseudo bordereau annoté par le Kayser, dont personne ne verra jamais aucune preuve.
- Cour de Cassation, De la Justice..., Joly, p. 231
- Duclert, L'affaire Dreyfus, p. 60
- Doise, Histoire militaire..., p. 159
- Bredin, l'Affaire, p. 544
- Duclert, L'affaire Dreyfus, p. 61
- Bredin, L'Affaire, p. 395
- Bredin, L'Affaire, p. 404
- Il s'agissait du président du Conseil de guerre et du commandant de Bréon
- Miquel, Affaire Dreyfus, Que sais-je ? p. 114
- Bredin, L'Affaire, p. 411
- Cinq années de ma vie
- Bredin, L'Affaire, p. 414
- Bredin, L'Affaire, p. 417
- Doise, L'histoire militaire..., p. 160
- Duclert, L'affaire Dreyfus, p. 104
- Cour de cassation, De la justice..., Becker, p. 262
- Cour de Cassation, De la Justice..., Becker, p. 267
- Duclert, L'affaire Dreyfus, p. 108
- Cour de cassation, De la justice..., Canivet, premier président, p. 12
- Duclert, L'affaire Dreyfus, p. 111
- Dictionnaire de l'affaire Dreyfus, entrée Picquart, p. 263
Sources
Sources primaires
- Compte rendu in extenso du procès d’Émile Zola aux Assises de la Seine et la Cour de Cassation (1898)
- Débats de la Cour de Cassation en vue de la révision du procès Dreyfus (1898)
- Compte rendu in extenso du procès de Rennes (1899) Tome 1, Tome 2, Tome 3
- Décision de la Cour de Cassation en vue de la cassation sans renvoi du procès Dreyfus de 1899. (1906)
Bibliographie
Articles et presse
- Édition spéciale du Figaro du 12 juillet 2005, « Le centenaire de la réhabilitation du capitaine Dreyfus ».
- « Dreyfusards ! » : souvenirs de Mathieu Dreyfus et autres inédits (présentés par Robert Gauthier). Gallimard & Julliard, coll. « Archives » n° 16, Paris, 1978.
Ouvrages généraux
- Pierre Birnbaum, L'Affaire Dreyfus, la République en péril, éd. Gallimard, coll. « Découvertes », 1994. (ISBN 978-2070532773)
- Jean-Denis Bredin, L'Affaire, Fayard, Paris, 1993 (1re édition 1981) (ISBN 2-260-00346-X)
- Michael Burns, Histoire d'une famille française, les Dreyfus, Fayard, 1994
- Éric Cahm, L’Affaire Dreyfus, Le Livre de poche, coll. « références », 1994
- Michel Drouin (dir.), L'Affaire Dreyfus , Flammarion, 1994, réédition 2006 (sous le titre : L’affaire Dreyfus. Dictionnaire). (ISBN 978-2082105477)
- Vincent Duclert, Alfred Dreyfus, l'honneur d'un patriote. Fayard, 2006 (ISBN 2-213-62795-9).
- Vincent Duclert, L'Affaire Dreyfus. La Découverte, 2006 (1re éd. 1994) (ISBN 2-7071-4793-1).
- Pierre Miquel, l’affaire Dreyfus, Que sais-je ?, Presses Universitaires de France – PUF, 2003, (ISBN 2130532268)
- Pierre Miquel, La troisième République, Fayard, 1989
- Joseph Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus, éd. Fasquelle, 1901 ; éd. Robert Laffont, deux vol., 2006 -
Tome 1 Procès de 1894, Tome 2 L'affaire Esterhazy, Tome 3 Procès Esterhazy et Zola,
Tome 4 Cavaignac et Félix Faure, Tome 5 Procès de Rennes, Tome 6 Le procès de Rennes,
Tome 7 Index général
- Marcel Thomas, L'Affaire sans Dreyfus, Fayard, Paris, 1961. Réédition : Éditions Idégraf, Genève, 1979, 2 volumes.
- Collectif, Dictionnaire de l’affaire Dreyfus, Flammarion, 2e ed. 2006
Ouvrages spécialisés
- Général André Bach, L'Armée de Dreyfus. Une histoire politique de l'armée française de Charles X à "L'Affaire", Tallandier, 2004 (ISBN 2-84734-039-4)
- Jean Doise, Un secret bien gardé ; Histoire militaire de l'Affaire Dreyfus. Le Seuil, collection XXe siècle, 1994 : 225p. (ISBN 2-02-021100-9)
- Henri Guillemin, L'énigme Estherhazy, Paris, Gallimard, 1962.
- Armand Israël, Les vérités cachées de l'affaire Dreyfus, Albin Michel, 2000 (ISBN 2-226-11123-9)
- Thierry Levy, Jean-Pierre Royer, Labori, un avocat, Louis Audibert Editions, 2006, (ISBN 2-226-11123-9)
- Collectif, Les intellectuels face à l’affaire Dreyfus alors et aujourd’hui, L’Harmattan, 2000, (ISBN 978-2738460257)
- Cour de Cassation, De la justice dans l’affaire Dreyfus, Fayard, 2006, (ISBN 978-2213629520)
Témoignages
- Alfred Dreyfus, Cinq années de ma vie, Paris, Fasquelle, 1935. Réédition La Découverte, 2006
- Alfred Dreyfus, Lettres d'un innocent, Stock, 1898
- Léon Blum, Souvenirs sur l’Affaire, Flammarion, Follio Histoire, 1993, (ISBN 978-2070327522)
- Georges Clemenceau, L'iniquité, Stock, 1899
- Georges Clemenceau, La honte, 1903
- Georges Clemenceau, Vers la réparation, Tresse & Stock, 1899
- Mathieu Dreyfus, L'Affaire telle que je l'ai vécue, Bernard Grasset, Paris, 1978. (ISBN 2-246-00668-6)
- Jean Jaurès, Les preuves, Recueil de La Petite République, 1898
- Jean-Louis Lévy, Combat pour Dreyfus, Editions Dilecta, 200606. (ISBN 978-2916275048)
- Octave Mirbeau, L'Affaire Dreyfus, Librairie Séguier, 1991.
- Maurice Paléologue, L’Affaire Dreyfus et le Quai d’Orsay, Plon, 1955
- Émile Zola, Combat pour Dreyfus. Préface de Martine Le Blond-Zola. Postface de Jean-Louis Lévy. Présentation et notes d'Alain Pagès. Éditions Dilecta, 2006.
Filmographie
Actualités et assimilés
- 1899 : (fr) La garde en faction devant le tribunal de Rennes - Catalogue des vues Lumière.
- 1899 : (fr) Mme Dreyfus et son avocat à la sortie de la prison de Rennes. - Catalogue des vues Lumière.
- 1899 : (fr)L'Affaire Dreyfus (actualité reconstituée, 15 mn) de Georges Méliès (point de vue dreyfusard)
- 1899 : (fr)L'Affaire Dreyfus (actualité reconstituée, 6 tableaux). - Actualités Pathé
- 1902 : (fr)L'Affaire Dreyfus, Film français attribué à Ferdinand Zecca produit par Pathé
- 1907 : (fr)L'Affaire Dreyfus, Film français de lucien Nonguet produit par Pathé
Documentaires
- 1965 : (fr) L'affaire Dreyfus, Film français réalisé pour les écoles de Jean Vigne - Noir et blanc - 18 mn
- 1972 : Modèle:Usa The Dreyfus Affair, Film documentaire américain - Noir et blanc - 15 mn
- 1974 : (fr) Dreyfus ou l'Intolérable Vérité, Film documentaire français de Jean Chérasse - Couleur - 90 mn - DVD 2006 par Alpamedia/Janus Diffusion
- 1994 : (fr) La Raison d'État, Chronique de l'Affaire Dreyfus, Film français en deux épisodes de Pierre Sorlin - Couleur - 26 mn
Films au cinéma
- 1930 : (de)Dreyfus, Film allemand de Richard Oswald - Noir et blanc - 90 mn
- 1931 : (uk)Dreyfus, Film anglais de F.W Kraemer et Milton Rosmer - Noir et blanc - 90 mn
- 1937 : Modèle:Usa The Life of Émile Zola, Film américain de William Dietele - Noir et blanc - 90 mn
- 1957 : Modèle:Usa I accuse, Film américain de José Ferrer - Noir et blanc - 90 mn
Dramatiques de télévision
- 1978 : (fr) Zola ou la Conscience humaine, Film français en quatre épisodes de Stellio Lorenzi - Produit par Antenne 2 - Couleur
- 1991 : (uk) Can a Jew Be innocent ?, Film anglais en quatre épisodes de Jack Emery - Produit par la BBC - Couleur - 30 mn
- 1991 : Modèle:Usa Prisoners of Honnor, Film américain de Ken Russel - Couleur - 105 mn
- 1994 : (fr) L'affaire Dreyfus, Film français en deux épisodes d'Yves Boisset - Produit par France 2 - Couleur
Voir aussi
- Action française
- Raoul Allier
- Antisémitisme
- Antisémitisme français
- Maurice Barrès
- Godefroy Cavaignac
- Crises de la Troisième République :
- Léon Dehon
- Mathieu Dreyfus
- Hubert-Joseph Henry
- Bernard Lazare
- Ligue de la patrie française
- Ligue française des droits de l'Homme (1898)
- Affaire Mortara
- Auguste Mercier
- Nationalisme français
- Francis de Pressensé
- Revanchisme
- Émile Zola
Liens externes
- (fr)J’accuse d’Émile Zola
- (fr)Bordereau de l’affaire Dreyfus
- (fr)Les Preuves, essai par Jean Jaurès qui passe en revue toute l'affaire en détail
- (fr)Commémoration de la réhabilitation d’Alfred Dreyfus à Mulhouse à l’occasion de l’année Dreyfus
- (fr)Colloque organisé par la cour de cassation le 19 juin 2006, à l'occasion du centenaire de la réhabilitation d'Alred Dreyfus
- (fr)Fonds Dreyfus du Musée d'art et d'histoire du judaïsme
- (fr)Site de l'Assemblée nationale
- (fr)Site de la Bibliothèque nationale de France
Evenements concernant l'Affaire Dreyfus
- 13 Juillet 1906 : Hommage du Sénat à A.Scheurer-Kestner
- 11 Février 1908 : Le Sénat inaugure le monument Scheurer-Kestner
- Dictionnaire de l'affaire Dreyfus, entrée Le Cinéma, de Baecque, pp. 550-551
