Matériel d'escalade
Le matériel d'escalade comprend l'ensemble des équipements utilisés durant l'escalade. Il existe une grande panoplie de matériels différents qui permettent la progression du grimpeur ainsi que sa protection. La plupart des types usuels d'équipement d'escalade sont brièvement décrits dans cet article. Les articles sur les protections d'escalade et les systèmes d'assurage décrivent les équipements communément utilisés pour protéger le grimpeur des conséquences d'une chute. De nombreux équipements d'escalade sont communs avec les équipements utilisés en alpinisme comme les cordes, les pitons ou encore les mousquetons.

Histoire
L'histoire du matériel d'escalade a commencé avec l'escalade elle-même. Les grimpeurs cherchent continuellement à améliorer leur moyen de progression et de sécurisation en faisant évoluer leur matériel. Ainsi les évolutions cherchent à offrir un gain de confort, de robustesse, de légèreté et de fiabilité.
Chronologie
L'escalade étant un héritage de l'alpinisme, au début du XXe siècle, le matériel était confondu. Les grimpeurs, notamment Pierre Allain, ont commencé à améliorer les chaussures pour y ajouter une gomme plus adhérente et en améliorer la précision. Les mousquetons légers sont apparus dans les années 1930, améliorant leur utilisation notamment avec les cordes qui deviennent synthétiques vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aussi vers 1935 est apparu le premier moyen de progression conçu par Henri Bernot.
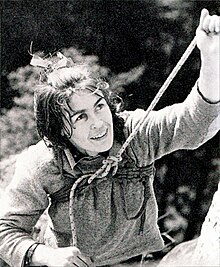
À partir de la seconde moitié du XXe siècle, le matériel s'est diversifié avec la pratique grandissante. Les bicoins (environ 1950) et les coinceurs (1972) ont permis la pratique du « clean climbing ». Les baudriers vont aussi beaucoup évoluer, évitant aux grimpeurs de s'assurer directement sur la corde ou avec des assemblage de sangles. À partir des 1980, le matériel s'est grandement perfectionné avec notamment des systèmes d'assurage de plus en plus complexes. Au début des années 2000 sont apparus les crash-pads et l'usage de la magnésie s'est banalisé.
Évolutions
L'arrivée des matériaux synthétiques a marqué le matériel. Tout d'abord, cela a permis de concevoir des cordes bien plus résistantes que celle en chanvre. Cela a permis également d'avoir des casques plus résistants et plus légers. Enfin les matériaux plastiques sont apparus dans la conception du matériel, lui offrant d'autres possibilités que l'acier ou l'aluminium[1] tout en étant plus léger.
La conception de ces matériaux synthétiques s'est améliorée permettant la fabrication de sangles qui ont un autre usage que les cordes notamment pour relier deux mousquetons ce qui constitue une dégaine. Les coutures de sangles ont permis d'éviter la confection d'un nœud encombrant. Enfin plus tard, la largeur des sangles s'est réduite (les Dyneema), offrant un gain de poids tout en conservant la résistance. Enfin, des tissus « 3D » ont été développés en mettant des membranes aérées dans le matériel comme pour les baudriers ou les sac à dos.
Les techniques de conception ont aussi fait évoluer le matériel. La production mécanique du métal s'est améliorée permettant un gain de poids tout en conservant la résistance, par exemple c'est ce qui a permis la réalisation des dégaines à doigt fil. Les systèmes mécaniques se sont également perfectionnés grâce à une plus grande précision, par exemple pour les ressorts utilisés dans les systèmes d'assurage. Cela a notamment été permis par la conception assistée par ordinateur.
Présentation
Corde et sangle
Corde

La corde est un des équipements principaux en escalade. À l'origine, il s'agissait uniquement de cordes en chanvre[2] dont la résistance et la fiabilité n'étaient alors pas toujours garanties. Avec la découverte du nylon et les progrès technologiques, les cordes ont beaucoup évoluées dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. De nos jours, les cordes d'escalade sont généralement constituée d'une âme de fibres tissées et d'une gaine extérieure de fibres de couleur tressées. L'âme fournit l'essentiel de la résistance en extension, alors que la gaine protège l'âme et donne à la corde ses caractéristiques voulues d'utilisation augmentant sa résistance à la friction, au rayon UV et à l'humidité.
Les cordes utilisées pour l'escalade sont classées en deux catégories : les cordes dynamiques et les cordes statiques. Les cordes dynamiques sont élastiques et sont généralement utilisées comme systèmes d'assurage car l'élasticité réduit la force maximale subie par le grimpeur et l'équipement en cas de chute. Les cordes statiques ne sont pas élastiques et sont généralement utilisées pour transporter ou attacher l'équipement. Elles sont aussi utilisées pour le rappel puisqu'elles réduisent les oscillations et facilitent la descente. Il existe de nombreux modèles de cordes dynamiques et statiques en fonction des besoins et des caractéristiques recherchés.
Les cordelettes sont des cordes de diamètre inférieur à 8 mm. Leur usage est très varié : confection de systèmes de sécurité, d'amarrages, de pédales, de nœuds auto-bloquants, etc.
Anneau de sangle
Une sangle est une corde plate, c'est-à-dire une corde sans âme. Elle est un composant polyvalent de l'escalade. Les sangles modernes sont souvent réalisées dans un matériau d'une très grande résistance (Dyneema). Les sangles sont généralement nouées ou cousues pour former une boucle connue sous le nom d'anneau de sangle. Les sangles ont de nombreux usages, dont l'extension ou équilibrage des ancrages, des baudriers improvisés, le transport de matériel, ou en tant que composant d'une dégaine.
Sac à corde
Le sac à corde est un sac conçu pour transporter, stocker et protéger la corde d'escalade. Il peut être déplié au sol afin de protéger la corde et il est généralement muni de deux points d'attaches afin de repérer plus facilement les extrémités de la corde.
Matériel de connexion
Le matériel de connexion permet de lier le grimpeur à du matériel, la corde aux ancrages ou le matériel entre lui.
Mousqueton
Le mousqueton est un anneau de métal muni d'un système d'ouverture facile appelé doigt à ressort. Il est utilisé comme connecteur. Pour l'escalade sportive, la plupart des mousquetons sont faits en alliage (d'aluminium). Les mousquetons existent dans de nombreuses formes, et son profil et son type de son doigt d'ouverture doit être choisis selon l'usage exact pour lequel il est destiné. Ils sont aussi connus sous le nom argotique de mousquif.
Les mousquetons sont classés en deux catégories : les mousquetons classiques qui peuvent être facilement ouvert par une pression sur le doigt du mousqueton et les mousquetons de sécurité. Ces derniers sont munis d'un dispositif mécanique à vis ou automatique qui empêchent le doigt du mousqueton de s'ouvrir lors de leur utilisation. Ils sont utilisés pour les connexions importantes.
Les mousquetons existent aussi avec différents types de doigt, dont les doigts à fil, les doigts courbés, ou les doigts droits. Ces différents doigts ont des résistances et utilisations différentes.
Dégaine
La dégaine est utilisée par les grimpeurs pour relier la corde au point d'ancrage. Elle permet à la corde de coulisser avec une friction minimale. Les dégaines sont généralement constituées de deux mousquetons classiques reliés par un court anneau de sangle cousu. Elles existent en différentes longueurs et certaines même avec une sangle extensible. Certaines sociétés peuvent réaliser un mousqueton avec une poulie à son extrémité pour réduire la friction de la corde sur le mousqueton, ce qui augmente néanmoins la force totale subie par la dégaine en cas de chute.
Baudrier
Un baudrier, ou harnais, sert à attacher une corde à une personne. La plupart des baudriers utilisés en escalade sont portés autour de la taille, bien que d'autres types peuvent être rencontrés, tels des harnais de torse ou des harnais complets.
Le type d'escalade détermine les caractéristiques souhaitées d'un baudrier. Les grimpeurs sportifs choisiront typiquement de baudriers minimalistes avec des porte-matériel. Les alpinistes choisiront des baudriers légers, éventuellement avec les boucles de jambe détachables. Les grimpeurs de grandes voies préféreront avoir plus de rembourrage pour le confort.
Chaussons d'escalade

Il s'agit de chaussures spécialement conçues pour l'escalade. Pour améliorer l'accroche du pied sur un mur d'escalade ou du rocher due à la friction, le chausson est recouvert d'une couche de gomme vulcanisée. Habituellement, les chaussons ont seulement quelques millimètres d'épaisseur et seront très resserrés autour du pied. Certains modèles ont un rembourrage en mousse sur le talon pour rendre les descentes et rappels plus confortables.
Matériel complémentaire
Le grimpeur a besoin de matériel complémentaire pour assurer sa progression avec plus de facilité et de confort. Dans l'absolu, il est possible d'assurer pleinement sa sécurité avec des mousquetons et dégaines, une corde et des cordelettes ; cependant pour diminuer les risques liés à leur mise en place, un matériel dédié existe.
Systèmes d'assurage
Il s'agit des dispositifs mécaniques utilisées pour l'assurage. Ils permettent un contrôle rigoureux de la corde d'assurage. Leur usage principal est de permettre le blocage de la corde avec un effort minimal. Beaucoup de types de dispositifs d'assurage existent, et certains d'entre eux peuvent aussi être utilisés en tant que descendeur ou pour assurer du haut d'une voie, ou en relais intermédiaire. La vigilance de l'assureur est de mise, et nécessitent tout un apprentissage.
Ces dispositifs se distinguent en deux catégories : ceux autobloquant, souvent d'une manière mécanique et ceux non-autobloquant qui historiquement était les premiers dispositifs existants. Les dispositifs autobloquant permettent de soulager une partie de l'attention nécessaire à l'assurage.
Descendeurs
Un descendeur est utilisé pour contrôler la descente sur corde, c'est-à-dire le rappel. Beaucoup de dispositifs d'assurage peuvent aussi être utilisés en tant que descendeurs, dont l'ATC, le huit, ou même un mousqueton.
Huit

Les descendeurs en huit, qui tirent leur nom de leur forme, permettent une descente rapide mais contrôlée sur une corde. Ils sont faciles à placer et permettent une dissipation efficace de la chaleur provoquée par la friction de la corde, mais ont tendance à toronner la corde. En raison de leur poids excessif et de leur aspect rudimentaire par rapport à d'autres descendeurs, beaucoup de grimpeurs sportifs les évitent. Ils sont préférés cependant quand la corde devient glacée. Ils permettent de descendre en rappel à condition d'y ajouter un nœud autobloquant, ou un dispositif tel que le SHUNT (petzl)
Un huit de secours est similaire à un huit, mais a des « oreilles » ou des « ailes » qui empêchent la corde de se coincer ou de créer un nœud et donc de bloquer sur sa corde la personne faisant le rappel.
Ce type d'assurage est maintenant progressivement interdit dans certaines salles ou certains club (la FFME) car il a tendance à vriller les cordes (ce qui la "tue") et à se tourner pour former une tête d’alouette ce qui peut entraîner des blocages sur cordes lors des descentes en rappels.
Dispositifs de remontée
Les dispositifs de remontée permettent, comme leur nom l'indique, de remonter sur une corde. Ils sont souvent appelés Jumars, du nom d'une marque.
Les jumars offrent la même fonctionnalité qu'un nœud de Prusik mais sont plus solides, rapides, sûrs et demandent moins d'effort. Un jumar utilise une came pour permettre au dispositif de glisser librement dans une direction (la direction souhaitée du mouvement) mais agrippe fermement la corde quand poussé dans la direction opposée. Pour empêcher un jumar de se libérer accidentellement de la corde, un mécanisme de blocage ou une gâchette est déployé. Un jumar est d'abord attaché au baudrier du grimpeur par une sangle, puis le jumar est clippé dans la corde et verrouillé. Pour remonter une corde fixe attachée à une ancre à neige sur une pente raide, seulement un jumar est nécessaire, l'autre main est utilisée pour maintenir le piolet.
Ancrage
En escalade, un point d'ancrage ou simplement ancrage désigne tout dispositif permettant de lier le grimpeur ou une charge et la corde à la paroi. Il peut s'agir d'un point d'assurage en escalade libre ou d'un point de relais (escalade). Il permet la protection contre les chutes lors de la progression en tête, ou le maintien d'une charge statique.
Les ancrages peuvent être placés par le grimpeur lors de son ascension, on parle alors d'ancrage temporaire, ou alors installés de manière fixe dans le cas des ancrages permanents.
Ancrage temporaire
Ces dispositifs peuvent être catégorisés comme passifs (bicoins, Hexentric, etc.) ou actifs (coinceurs mécaniques).
Bicoin

Les bicoins, aussi appelés câblés, sont fabriqués dans de nombreuses variétés. Dans leur forme la plus simple, ils sont juste constitués d'un petit bloc de métal auquel est attaché un anneau de cordelette ou un câble.
Les bicoins sont simplement utilisés en les bloquant dans des fissures, se rétrécissant vers le bas, du rocher.
Coinceur hexagonal
Les Hexcentrics sont une marque de coinceurs en forme de prisme hexagonal concave avec des extrémités coniques. Ils sont généralement utilisés dans des fissures larges. Les Hexcentrics sont fabriqués par Black Diamonds dans de nombreuses tailles. Ces dernières années, des sociétés telles que Metolius ou Wild Country ont sorti des coinceurs similaires, avec des côtés incurvés, qui sont plus intuitifs à placer et ont une meilleure action en came.
Coinceur mécanique
Aussi connu sous le nom de coinceur à came ou friend.
Ils consistent en deux, trois, ou quatre cames montées sur un axe commun ou deux axes adjacents, de manière que la traction sur l'axe force les cames à s'écarter. Une gâchette (ou une petite poignée) ramène les cames ensemble. Ils sont placés dans une fissure ou un trou du rocher en tirant sur cette gâchette pour permettre aux cames de s'insérer, puis en tirant sur une petite barre à l'extrémité de l'axe. Cela fait s'écarter les cames et adhérer les cames sur la surface du rocher. Les cames sont maintenues en place par de petits ressorts. Une corde d'escalade peut alors enfin être reliée à l'extrémité du coinceur.
Les coinceurs mécaniques sont faciles et rapides à poser et s'adaptent à une plus grande variété de fissures que les bicoins. Ils sont en revanche beaucoup plus chers.
Décoinceur

Il s'agit d'un matériel petit, mais essentiel. Le décoinceur est constitué d'une fine pièce de métal rigide d'une dizaine de centimètres de long, avec un ou plusieurs crochets. Ils permettent aux bicoins d'être enlevés des fissures du rocher et sont particulièrement utiles lorsque le coinceur a supporté le poids d'un grimpeur ou arrêté une chute. Il peut aussi rattraper un coinceur mécanique qui aurait glissé à l'intérieur d'une fissure. Il peut arriver qu'un coinceur ne puisse être enlevé même avec l'aide d'un décoinceur.
Ancrage permanent
Équipement personnel
Au début de l'escalade, beaucoup auraient considéré les vêtements spécialisés comme de la triche. De nombreuses personnes ont même choisi de grimper pieds nus, ce que les grimpeurs trouvent incroyable. Dans les années 1980 et le début des années 1990, la mode était de porter des vêtements serrés et très colorés. La mode est maintenant plutôt aux vêtements amples.
Casque

Le casque est un élément de sécurité souvent négligé, bien qu'il ait sauvé de nombreux grimpeurs de blessures graves ou de la mort. Un casque est constitué de matériaux résistants pour protéger la tête et la boîte crânienne des impacts. Dans les zones d'escalade bien développées et fréquentées, ces impacts sont plus souvent causés par la chute d'objets (comme des cailloux ou du matériel d'escalade) que par la chute d'un grimpeur touchant le rocher ou le sol.
Suivant le type d'escalade envisagé, les casques sont plus ou moins courants. Il y a beaucoup de raisons valides pour un grimpeur de ne pas porter un casque, dont des questions de poids, d'encombrement ou de réduction d'agilité. Cependant, la raison principale qu'ont de nombreux grimpeurs de ne pas porter de casque est plus certainement la vanité. Dans les salles d'escalade, il n'y a pas d'avantage discernable à porter un casque, mais sur des voies de plusieurs longueurs ou sur les voies de cascade de glace, seuls les plus téméraires ne porteraient pas de casque. Entre ces deux extrêmes, un appel au jugement personnel doit être fait.
Magnésie
La magnésie est une poudre constituée principalement de carbonate de magnésium, mais on y ajoute souvent du sulfate de magnésium qui agit comme agent séchant. Elle est utilisée par les gymnastes pour absorber la transpiration. Son usage s'est massivement répandu chez les grimpeurs qui l'utilisent pour améliorer l'adhérence des mains sur le rocher.
L'utilisation de la magnésie est controversée, et même interdite sur certains sites à l'exemple de Albarracín[3]. Elle serait nuisible au grès. Les traces de magnésie peuvent persister là où la pluie est insuffisante ou le rocher en dévers, et alors former des dépôts. Le brossage nécessaire pour enlever ces dépôts, s'il est trop agressif, peut abîmer le rocher.
Sac à magnésie

Il s'agit de sac de la taille d'une main pour recevoir la magnésie. Ils sont habituellement clippés ou attachés sur le baudrier du grimpeur pour un accès facile durant l'escalade.
La magnésie n'est généralement pas dispersée dans le sac. À la place, une chaussette à magnésie ou une balle à magnésie est remplie de la magnésie et ensuite placée dans le sac. Les chaussettes à magnésie sont les poches faites d'un matériau poreux qui permet à un peu de magnésie de sortir quand la chaussette est remuée ou frottée.
Gants d'assurage

Bien qu'étant souvent rejetés par la plupart des grimpeurs, qui prétendent que les gants d'assurage réduisent l'adhérence et le contrôle sur la corde, les gants d'assurage sont une aide utile pour l'assurage durant de longues escalades. En particulier, en descendant un grimpeur, ils éliminent la possibilité d'être brûlé par la corde et les conséquences involontaires d'un lâcher de corde.
Les gants d'escalade sont réalisés ou bien en cuir ou en un substitut synthétique. Ils ont souvent des rembourrages résistant à la chaleur sur la paume et les doigts.
Manchons d'escalade
Les manchons d'escalades fonctionnent suivant le même principe que les manchons des cyclistes[4], c'est-à-dire qu'il permettent une meilleure oxygénation des muscles des avant bras. Le gain sur la puissance semble difficilement mesurable, tandis que celui sur l'effet bouteille (durcissement des muscles de l'avant bras) est plus palpable.[réf. nécessaire]
Ruban adhésif médical
Le ruban adhésif médical est utile pour prévenir et soigner les blessures légères, par exemple la perte de peau. Beaucoup de grimpeurs, qui ne se reposent pas suffisamment, enroulent le ruban autour des doigts ou des poignets pour prévenir des problèmes récurrents de tendon. Le ruban est aussi très souhaitable pour protéger les mains dans les voies dont l'escalade consiste en coincements répétés.
Le ruban adhésif médical utilisé pour l'escalade est souvent appelé strappal (son nom commercial) ou parfois "tape" (prononcé tép), ou "strap".
Sac de hissage
Il s'agit d'un sac grand et souvent épais dans lequel le ravitaillement et le matériel d'escalade peut être placé. Un sac à dos avec un anneau de hissage sur le haut peut aussi être utilisé.
Porte-matériel
Un porte-matériel est habituellement utilisée par les grimpeurs de grandes parois ou d'artif' quand ils ont trop d'équipement pour les porte-matériel de leur baudrier. Il est porté autour de l'épaule. Les formes les plus simples sont des anneaux de sangle faits à la main, et les plus évolués ont un rembourrage et deux sangles de chaque côté.
Matériel d'entraînement
Divers matériels sont employés pour l'entraînement à l'escalade.
Boule d'échauffement
Il s'agit d'une petite boule malléable, et reprenant sa forme d'origine, qui peut aider à développer les muscles antagonistes à ceux utilisés pour la préhension par la main. L'utilisation d'un tel appareil peut prévenir les blessures des ligaments fréquemment éprouvées par les grimpeurs.
Poutre à doigts
Il s'agit d'un agrès principalement utilisé pour améliorer la force de préhension et pour pratiquer différentes techniques de préhension. Ces poutres consistent en une variété de trous et de réglettes de tailles différentes sur lesquelles on peut se suspendre ou pratiquer des tractions. Elles sont généralement montées au-dessus d'une porte, ou ailleurs dans une pièce pour permettre au corps du grimpeur de pendre librement.
Poutre de traction
Une série de barres horizontales attachées à une surface accrochée en hauteur, qui peut être escaladée ou désescaladée sans l'aide des pieds. Quand elle est utilisée correctement, les poutres améliorent la force des doigts et la force de préhension.
Matelas de bloc
Il s'agit d'un matelas dense utilisé pour amortir les chutes et recouvrir les objets qui pourraient être dangereux en cas de chute. Ils consistent généralement en une mousse dense de 5 à 15 centimètres recouverte d'une housse robuste. De nombreuses marques y ajoutent des poignées ou le conçoivent pour être replié dans des dimensions raisonnables pour le transport.
Le matelas de bloc est souvent appelé crash pad.
Utilisation
Gestion des EPI
Selon le décret du Code du travail no 94-689 du , il était précisé que les EPI de protection contre les chutes en hauteur étaient strictement individuels. Cependant avec le décret no 2004-249 du , si une gestion (avec identification, contrôle et suivi) de ce matériel est mise en place, la mise à disposition est possible. Cela a donc conduit à la publication de la norme NF S72-701 en juin de la même année[5].
Les fabricants tels que Beal recommandent d'effectuer un contrôle de routine à chaque utilisation et un contrôle complet annuellement ou après chaque utilisation exceptionnelle du matériel[5].
Les recommandations des fabricants est de changer tous les 5 ans le matériel « textile » tels que : baudrier, sangle de dégaine, corde… Le matériel métallique (mousqueton, système d'assurage…) n'a pas de limite de conservation à partir du moment où son contrôle d'inspection ne remonte pas de défaut d'utilisation tel qu'une fissure, ou un ressort qui ne fonctionne plus correctement.
Contrôles
Sur les cordes, la norme recommande de vérifier l'état de celles-ci en inspectant leur surface (gaine), en vérifiant qu'il n'y a pas de glissement avec la partie interne (âme) et cela afin de vérifier qu'elles ont conservé toutes leurs propriétés de forme, d'état de surface et de flexibilité. Une corde ayant subi une brûlure ou coupure (à la suite d'une chute violente, d'un frottement trop fort sur une surface coupante, d'un contact avec un agent chimique agressif…) doit être écartée du cercle d'utilisation (mise au rebut). Le même genre de contrôle doit être effectué pour le matériel textile mais il faut en plus vérifier les coutures de celui-ci[5].
Concernant le matériel, le contrôle doit porter sur la corrosion, l'usure prématurée ou les fissures. Si, par exemple, un mousqueton tombe par terre d'une hauteur importante comme 20 mètres, son état de surface pourra être bon mais des micro-fissures ont pu apparaître dedans. Cela nécessite de mettre au rebut ce matériel. De plus, il peut arriver qu'une dégaine fixée à demeure sur une SAE (à l'aide d'un maillon rapide) s'use fortement et présente un creux à l'endroit de passage de la corde, dans ce cas, le matériel doit être remplacé[5].
Dorénavant les grands constructeurs comme Petzl ou Beal mettent à disposition des méthodes de contrôles[6] ainsi que des outils de gestion du matériel[7].
Normes
Il y a deux principales entités de normalisation pour certifier la sûreté et la fiabilité des équipements d'escalade :
Tous les produits vendus en Europe doivent, par la loi, être certifiés conformes à ces normes. Il n'y a pas de telles exigences dans beaucoup d'autres pays, bien que la plupart des fabricants suivent volontairement les normes CEN ou UIAA.
Notes et références
- La poignée du grigri est en plastique, les poignées jumars sont rembourrées en plastique.
- « L'histoire de l'escalade : Les pionniers », sur www.grimper.com, (consulté le )
- Albarracin : mauvaises nouvelles
- 3 outils dédiés au cycliste pour une meilleure récupération
- « Beal - Résumé de la norme AFNOR NF S72-701 », sur http://www.beal-services.info/ (consulté le )
- « Petzl - Vidéos indiquant les méthodes de contrôles des différentes EPI », sur www.petzl.com (consulté le )
- « Beal - Outil de gestion du matériel », sur http://bealplanet.com (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Bibliographie
- Jean-Baptiste Duez, « Les instruments de l’alpiniste », dans Techniques & Culture, 52-53, 2009.
