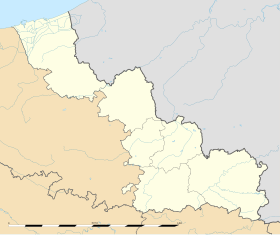Utilisateur:Serge Ottaviani/Verrerie Chappuy
| Destination initiale |
Fabrication de produits verriers |
|---|---|
| Construction |
1843 |
| Propriétaire |
Louis-François Chappuy |
| Pays | |
|---|---|
| Commune | |
| Adresse |
Frais-Marais |
| Coordonnées |
|---|
La verrerie Chappuy est autorisée par ordonnance royale n° 17 272 du 12 janvier 1843 au profit de Louis-François Chappuy à Frais-Marais; hameau de Douai dans le département du Nord pour une fabrication de verre blanc à vitres et à bouteilles[1].
L'installation de cette verrerie attirera d'autres implantations, des constructions de logements, d'école et d'église apportant une expansion de ce hameau qui ne comportait que quelques maisons.
Contexte[modifier | modifier le code]
Un peu d'Histoire[modifier | modifier le code]
Des opposants à l'installation de la verrerie Chartier à Douai-Dorignies l'oblige à construire au centre de la parcelle avec une cheminée de 20mètres. Ces contraintes sont également appliquées à Louis-François Chappuy qui est également autorisé en 1842 à une verrerie à Frais-Marais.Elle lui sera accordée sous réserves qu'elle soit construite au centre du terrain avec une cheminée de 20m pour ne pas gêner le voisinage[2].
La verrerie s’établit sur les bords de la Scarpe canalisée dans une situation pour recevoir les matières premières et écouler ses produits Elle fabrique 1 100 000 bouteilles et 110 000 dames-jeannes 3 1 de ses produits sont destinés à l exportation. Elle fait des dames-jeannes de 50 à 100 litres contenance et qui ne pèsent que 10 à 18 kilogramme la confection de ces vases i sont souillés dans moules présente de grandes difficultés d exécution[3]
La verrerie Chappuy occupe 300 ouvriers en 1908[4]
Louis-François Chappuy[modifier | modifier le code]
Louis Chappuy est né le 5 octobre à Saint-Dié-des-Vosges et décède en 1878[5]
La famille Chappuy est originaire des Vosges. Son berceau est la petite ville de Mirecourt. Le père de Louis-François Chappuy avait été commissaire des guerres sous Napoléon Ier, il rentra, après l'écroulement de l'Empire, et fut nommé à Douai receveur principal des contributions indirectes et entreposeur des tabacs.
Louis-François Chappuy étudia l'art de la verrerie dans sa région natale ; les vosges et dès 1841, se mit résolument à l’œuvre. Il fut d'abord chargé de la construction et de la direction d'une verrerie au Havre, mais , pour se rapprocher de son père, il entreprend de fonder un établissement analogue près de Douai[5].
C'est au hameau de Frais-Marais qu'il en choisit l'emplacement.
« L'usine de Frais-Marais fut construite entre le canal de la Scarpe et la grande route de Douai à Lille, placée ainsi de façon à recevoir facilement les matières premières, comme à expédier les produits de sa fabrication, ainsi favorablement située, dirigée avec une volonté ferme et prudente, une vigilance de tous les instants et une réelle entente commerciale, elle prospéra, et compta bientôt de cent à cent cinquante ouvriers, selon que le travail était plus ou moins actif. Louis Chappuy prit part à beaucoup d'expositions industrielles et y fut l'objet des distinctions les plus flatteuses. Un diplôme d'honneur, 2 médailles d'or, un rappel de médaille d'or, 3 médailles d'argent, 6 médailles de bronze et autant de mentions honorables forment les titres de noblesse de la verrerie de Frais-Marais. »[5]
Les relations que Louis Chappuy avait conservées au Havre lui donnèrent la facilité de nouer de fructueux rapports avec l'Amérique, où il expédiait chaque année notamment une grande quantité de dames-jeannes.
Bonnes Œuvres de Louis Chappuy[modifier | modifier le code]
Inspiré de Charles Fourier (1772-1837) avec ses idées communautaires et son phalanstère, Louis Chappuy est précurseur du Familistère de Guise de 1853. Autour de sa verrerie il urbanise le hameau avec des logements, une école, une chapelle et des œuvres sociales.
Logement[modifier | modifier le code]
Comme autour des mines de charbon; les corons étaient indispensables du fait de la dureté de la tâche à accomplir au fonds ou devant les ouvreaux de four, les longues journées de travail dépassant 10 heures, sans repos hebdomadaires et le peu de moyens de transport.
Dans cette stratégie Louis Chappuy apporte sa réponse tel qu'elle est citée dans son oraison funèbre :
« Cependant le hameau se peuplait, se développait autour de la verrerie. D'autres usines s'installaient dans le voisinage. M. Chappuy comprit que de nouveaux devoirs étaient nés pour lui et qu'il avait charge d'âmes. Ses ouvriers trouvaient difficilement à se loger aux environs, il leur construisit des maisons, il leur assura une demeure salubre et peu coûteuse; dès lors ils s'attachèrent à lui, ne le quittant plus et apprenant leur métier à leurs enfants. Je ne crois pas qu'il y ait dans l'arrondissement un seul établissement qui réunisse autant de vieux et fidèles ouvriers. Le travail de la verrerie use vite les forces du verrier, du souffleur surtout; pour lui l'heure de la retraite sonne prématurément, et souvent la vieillesse est longue et dure. Aussi notre collègue avait cherché à procurer à ces anciens serviteurs un travail plus facile qui leur permit, en utilisant sans danger les forces qui leur restaient, d'échapper aux étreintes du besoin, même après qu'ils avaient abandonné les fours; il adjoignit une culture à sa fabrique et put ainsi leur confier des taches moins rudes, proportionnées à leurs forces et leur conserver jusqu'aux dernières heures des salaires suffisants. Lui même trouvait un grand charme à se livrer aux travaux de l'agriculture. Il y apporta sa patiente et persévérante activité au travail, et y réussit aussi bien que dans la verrerie. Le Clos des nobles qu'il exploitait près de Waziers peut être cité parmi les meilleures exploitations de nos environs. »[5]
École[modifier | modifier le code]
L'époque du mi XIX éme siècle est favorable à la naissance des écoles du peuple prés des usines de la région du Nord[6]
« Frais-Marais était bien isolé ; ce hameau, qui dépend de la ville de Douai, en est éloigné de plusieurs kilomètres. » Ainsi Louis Chappuy commence par enseigner lui-même à partir de 1846 dans un local de l'usine, une école s'ensuivra avec un instituteur et une institutrice. École qui sera reprise en 1871 par la ville de Douai[5].
Chapelle[modifier | modifier le code]

Au XIXéme siècle des curés aux visions différentes s'opposent dans leurs pratiques. Ainsi l'Abbé Lemire, député d'Hazebrouck, qui portera la loi sur le travail des enfants, reprend les témoignages de Charles Delzant et publie son rapport sur le Le Travail de nuit des enfants, dans les usines à feu continu évoquant le travail en verrerie notamment à Arques où des enfants placés par l'abbé Santol sont pires que des prisonniers. Pour Santol, l'oisiveté est la mère de tous les péchés[7].
Louis Chappuy; lui; fait construire sa chapelle pour les besoins de tous :
« Ce fut encore M. Chappuy qui donna satisfaction aux besoins religieux de la population qui s'était groupée autour de lui ; il s'était longtemps vu contraint de se contenter d'instructions religieuses qu'il adressait à ceux qui voulaient y assister, ce n'était point assez, il éleva de ses deniers une élégante chapelle dont il fut lui-même l'architecte et en 1870 elle pût être consacrée. Depuis cette époque,il supporta complètement les frais du culte, faisant chercher à Douai, les dimanches et jours de fête, un prêtre qui venait y célébrer le service divin ; l'usage de cette chapelle, entièrement gratuit, fut un nouveau bienfait pour les habitants de Frais-Marais. »[5]
Bienfaisance[modifier | modifier le code]
Hiver 1870-1871[modifier | modifier le code]
« Ainsi pendant l'hiver 1870-71 de sinistre mémoire, il sollicita comme une faveur et obtint de la municipalité de Douai et du bureau de bienfaisance, de remplir pour Frais-Marais, la tâche si pénible dont s'acquittent à Douai avec tant de dévouement les filles de St-Vincent de Paul. Le bureau de bienfaisance lui fournissant une partie des denrées sèches, il faisait confectionner chez lui à ses frais les soupes qui étaient distribuées aux indigents. C'étaient par hectolitres que se comptaient ces distributions faites deux fois par semaine et il secourut ainsi pendant cet hiver, 24 familles comptant 121 personnes. »[5]
Epidémies de choléra 1847-48 et 1866[modifier | modifier le code]
« A deux reprises, pendant l'hiver de 1847-48 et en 1866, le hameau de Frais-Marais fut visité par le choléra, la première épidémie surtout fut terrible et meurtrière. Ceux qui voudraient apprécier à sa juste valeur l'homme dont je retrace la vie, n'ont qu'à aller à Frais-Marais et à y recueillir les souvenirs qu'y a laissés sa noble conduite, il donna à tous l'exemple du dévouement qui ne se ménage pas. Assidu au chevet des malades, les aidant de ses conseils, de ses secours, relevant le moral de tous, bravant tous les périls »[5]
« Il était partout où une souffrance ou un danger lui étaient révélés : il semait partout le courage et le bon exemple, poussant l'abnégation jusqu'à ensevelir les morts dont se détournaient avec effroi les familles terrifiées, et, comme les siens justement alarmés, craignant pour sa vie même, essayaient de modérer son zèle, il avait pris l'habitude de dresser chaque soir une échelle contre la fenêtre de sa chambre qu'il laissait entrouverte, pour qu'on put sans effrayer les siens, venir le chercher à toute heure au moindre danger et il s'évadait par cette voie, courant où sa charité l'appelait, sans souci du péril, partout où quelque bien était à accomplir. »[5]
Condamnation Prud'hommale[modifier | modifier le code]
Avec le code Napoléon il y a obligation d'avoir un livret pour travailler. Sans livret avec date d'entrée et de sortie signé de son ancien employeur, un ouvrier ne peut être embauché dans un nouvel emploi.
Le 19 novembre 1859 Louis Chappuy est, par le conseil des Prud'Hommes de Douai, condamné pour avoir limogé Joseph Georges (père) sans paiement des congés et retenu le livret du salarié limogé l’empêchant de retrouvé un travail[8]
Georges Chappuy[modifier | modifier le code]

Marie Louis Nicolas Guislain Georges Chappuy nait à Douai au hameau de Frais-Marais; le 30 Novembre 1854 est le fils de Louis-François Chappuy et de Laure-Sophie-Louise Chevillart [9].
En 1884 Georges Chappuy reprend la direction de la verrerie de son père. Il fondera la Société des verreries à bouteilles du Nord[9]
Puis Georges Chappuy, maître de verrerie, sera vice président de l'association des verreries à bouteilles du Nord de 1898 à 1910, vice-président de 1899 à 1899 du Syndicat général des maîtres de verrerie de France dont le siège est à Paris, chevalier de la légion d'honneur en 1910; décoré par Paul Hayez; et en 1925 officier de la Légion-d'Honneur; décoré par Paul Lemay.
Georges Chappuy était président honoraire et membre depuis 1887 de la Chambre de commerce dont il sera vice-président en 1907, Président en 1904 et membre durant 23 ans du Conseil des Prud’hommes de Douai, médaillé à l'Exposition universelle de Londres. Pendant là guerre, il s'occupa activement des sinistrés, ainsi que des prisonniers des régions libérées et faisait partie de nombreux groupements qui s'intéressaient à leur sort[10],[9].
Georges Chappuy décède de pneumonie au 8 rue Boulevard Delbecque à Douai, à l'âge de 79 ans, le 9 novembre 1933[10] . Dans cette habitation ont logé, l'Empereur Guillaume et le Prince Eitel-Frédérick, durant un séjour en France occupée[11]
Travail des enfants[modifier | modifier le code]
Georges Chappuy invente et teste en 1900 un transporteur des bouteilles et autres objets en verre à l'état incandescent depuis la place où ils sont façonnés jusqu'au four à recuire[9]. L'inspecteur du travail François Fagnot en tire les conclusions suivantes:
« Le transporteur qui fonctionne chez lui depuis quatre ans lui donne entière satisfaction. D'autre part, il est si difficile de recruter des enfants dans la région que, sans cet appareil, il eût été contraint, faute de porteurs, d'arrêter la moitié de sa fabrication. Avant l'installation des transporteurs, il occupait 50 porteurs. Il n'en a plus que 15 à 18 occupés à cet emploi pour le môme nombre de places. Contrairement à ce qu'on pourrait dire, le transporteur, quand il fonctionne bien,. ne diminue pas la production. Il ne cause donc pas la moindre perte aux ouvriers. A la verrerie Chappuy,' le personnel ne formule aucune plainte contre l'appareil.
Sans parler de ses avantages au regard de l'hygiène et de la sécurité, le transporteur réduit si heureusement le nombre des enfants occupés à porter les bouteilles qu'il est maintenant possible de supprimer le travail de nuit pour les porteurs. Les quelques enfants employés aux transporteurs pourront être remplacés, la nuit, par des manœuvres occupés le jour, par alternances, à des travaux de cour. Il y aura pour le patron une augmentation de dépenses que l'économie réalisée par l'emploi du transporteur lui permettra de supporter. »[4]
Concernant les cueilleurs François Fagnot relève :
« ils commencent à monter sur la place et à cueillir le verre vers l'âge de 14 ans. Ils apprennent leur métier et font dès lors partie du personnel de fabrication. Chez M. Chappuy, 19 cueilleurs d'âges divers travaillent simultanément la nuit. 5 cueilleurs sont, en outre, présents pour remplacer les absents. Il ne voit pas comment il les remplacerait. Le moyen semblerait être de réserver les cueilleurs ayant plus de 18 ans pour le poste de nuit ; mais, pour procéder ainsi, il faudrait avoir un personnel plus nombreux et surtout trouver plus aisément des apprentis dans la région. Or, par suite du voisinage des mines, où les enfants sont presque tous occupés, le recrutement des enfants est de la plus grande difficulté, de sorte que l'apprenti verrier devient de plus en plus rare. De plus, les cueilleurs adultes, fort peu nombreux du reste, ne consentiraient pas à travailler continuellement la nuit.
Si l'interdiction du travail de nuit ne portait que jusqu'à l'âge de 16 ans, et non 18, la solution serait évidemment un peu facilitée, ajoute M. Chappuy, mais il en résulterait cependant une gêne telle et des difficultés si graves que les maîtres verriers ne sauraient pas les supporter.
En ce qui touche les cueilleurs, la solution ne lui semble possible que lorsque la fabrication de la bouteille pourra se faire à la machine, ce qui ne saurait beaucoup tarder.
La question est à l'étude, en ce moment, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en France, dans tous les pays. On propose aux verrier â français d'acheter des licences pour l'emploi du brevet de la machine Owens, qui supprime complètement la main-d’œuvre du verrier. »[4]
Charles Delzant par la Voix des verriers et dans Les temps nouveaux dénoncera ce rapport ajoutant que l'inspecteur du travail manger à la table des patrons.
Gréves[modifier | modifier le code]
Une gréve générale nationale ,dans les 42 verreries à bouteilles (verrerie noire), est lancée le 9 octobre 1891[12].
Le 20 octobre 1891 deux tiers des ouvriers demandent à M. Chappuy la reprise du travail mais celui-ci reste solidaire de ses collègues patrons se remettant aux négociations en cours à Paris. Le lendemain les grévistes redemandent la reprise, comme un four sur trois est en chauffe; une réembauche de 34 ouvriers est lancée le jour même. A la verrerie Chartier de Dorignies à Douai la grève continue[13]
Notes et références[modifier | modifier le code]
- Bulletin des lois de la République française, (lire en ligne)
- Rapport sur les travaux du Conseil departemental d'hygiene et des commissions sanitaires, vol. 3 Et 5, (lire en ligne)
- Exposition universelle de 1855 : Rapports du jury mixte international, (lire en ligne)
- François Fagnot, Rapport sur le travail des enfants dans les usines à feu, F. Alcan (Paris),
- Mémoires de la Société centrale d'agriculture, sciences et arts du département du Nord, (lire en ligne)
- François Jacquet Francillon, Naissances de l'école du peuple: 1815-1870, Editions de l'Atelier, , 317 p. (ISBN 9782708231627, lire en ligne)
- Abbé Lemire, Le travail de nuit des enfants, dans les usines à feu continu : compte rendu des discussions, vœu adopté / rapport de M. l'abbé Lemire, F. Alcan (Paris), 1911lire en ligne=http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5543482g.r=abb%c3%a9+lemire+enfants+travail.langfr
- Annales de la science et du droit commercial, ou Mémorial du commerce et de l'industrie: recueil mensuel de législation, de science commerciale, de doctrine et de jurisprudence commerciales,, (lire en ligne)
- « Marie Louis Nicolas Guislain Georges Chappuy (cote19800035/244/32468) », sur http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr, (consulté le )
- « Décès Chappuy », Journal des débats politiques et littéraires, no 312, , p. 2 (lire en ligne)
- « Georges Nicolas M Ghislain Louis CHAPPUY », sur genenaet (consulté le )
- « Mouvement ouvrier », La Lanterne, no 5284, , p. 2 (lire en ligne)
- « Mouvement ouvrier », La lanterne, no 5297, , p. 2 (lire en ligne)