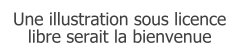« Blautia hydrogenotrophica » : différence entre les versions
nouvel article |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
{{Taxobox fin}} |
{{Taxobox fin}} |
||
'''''Blautia hydrogenotrophica''''', précédemment connue sous le nom de '''''Ruminococcus hydrogenotrophicus''','' est une espèce de bactérie à gram positif que l'on trouve dans l'intestin des humains et des ruminants. Il s'agit d'un coccus faisant partie de la flore intestinale anaérobie. Cette bactérie a été découverte par |
'''''Blautia hydrogenotrophica''''', précédemment connue sous le nom de '''''Ruminococcus hydrogenotrophicus''','' est une espèce de bactérie à gram positif que l'on trouve dans l'intestin des humains et des ruminants. Il s'agit d'un coccus faisant partie de la flore intestinale anaérobie. Cette bactérie a été découverte par Bernalier et ses collaborateurs en 1996 à partir d'isolats de selles humaines<ref name=":0">{{Article|langue=en|prénom1=A.|nom1=Bernalier|prénom2=Anne|nom2=Willems|prénom3=Marion|nom3=Leclerc|prénom4=Violaine|nom4=Rochet|titre=Ruminococcus hydrogenotrophicus sp. nov., a new H2/CO2-utilizing acetogenic bacterium isolated from human feces|périodique=Archives of Microbiology|volume=166|numéro=3|date=1996-09-01|issn=0302-8933|issn2=1432-072X|doi=10.1007/s002030050373|lire en ligne=https://link.springer.com/article/10.1007/s002030050373|consulté le=2017-07-20|pages=176–183}}</ref>. |
||
== Description == |
|||
''Blautia hydrogenotrophica'' est une bactérie intestinale à gram positif, en forme de coccus et de taille moyenne de 0,7 × 0,6 µm<ref name=":0" />. À partir d'expériences de coloration négatives menées sur les deux souches découvertes par Bernalier et son équipe, ils ont déterminé que cette espèce ne possède pas de flagelle, et de ce fait est non motile. Elle est présente généralement dans son environnement en tant qu'individu isolé, ou en paires<ref name=":0" />. |
|||
== Historique == |
|||
Le contexte de la découverte de cette bactérie trouve sa source dans un contexte d'étude de l'acétogénèse en tant que voie métabolique microbienne importante dans les environnements dépourvus d'oxygène mais contenant du CO<sub>2</sub> et/ou du H<sub>2</sub>. L'importance de ce processus a été démontrée dans le tractus gastrointestinal des rongeurs<ref>{{Article|prénom1=R. A.|nom1=Prins|prénom2=A.|nom2=Lankhorst|titre=Synthesis of acetate from CO2 in the cecum of some rodents|périodique=FEMS Microbiology Letters|volume=1|numéro=5|date=1977-05-01|lire en ligne=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0378109777900684|consulté le=2017-07-20|pages=255–258}}</ref>, des porcs<ref>{{Article|langue=en|prénom1=K.g.|nom1=De Graeve|prénom2=J.p.|nom2=Grivet|prénom3=M.|nom3=Durand|prénom4=P.|nom4=Beaumatin|titre=Competition between reductive acetogenesis and methanogenesis in the pig large-intestinal flora|périodique=Journal of Applied Bacteriology|volume=76|numéro=1|date=1994-01-01|issn=1365-2672|doi=10.1111/j.1365-2672.1994.tb04415.x|lire en ligne=http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2672.1994.tb04415.x/abstract|consulté le=2017-07-20|pages=55–61}}</ref>, des ruminants<ref>{{Ouvrage|langue=en|prénom1=Roderick I.|nom1=Mackie|prénom2=Marvin P.|nom2=Bryant|titre=Acetogenesis|passage=331–364|éditeur=Springer, Boston, MA|date=1994|doi=10.1007/978-1-4615-1777-1_12|lire en ligne=https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4615-1777-1_12|consulté le=2017-07-20}}</ref>, des termites<ref>{{Ouvrage|langue=en|prénom1=John A.|nom1=Breznak|titre=Acetogenesis|passage=303–330|éditeur=Springer, Boston, MA|date=1994|doi=10.1007/978-1-4615-1777-1_11|lire en ligne=https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4615-1777-1_11|consulté le=2017-07-20}}</ref> et des humains<ref>{{Ouvrage|langue=en|prénom1=Meyer J.|nom1=Wolin|prénom2=Terry L.|nom2=Miller|titre=Acetogenesis|passage=365–385|éditeur=Springer, Boston, MA|date=1994|doi=10.1007/978-1-4615-1777-1_13|lire en ligne=https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4615-1777-1_13|consulté le=2017-07-20}}</ref>{{,}}<ref>{{Article|prénom1=Annick|nom1=Bernalier|prénom2=Marielle|nom2=Lelait|prénom3=Violaine|nom3=Rochet|prénom4=Jean-Philippe|nom4=Grivet|titre=Acetogenesis from H2 and CO2 by methane- and non-methane-producing human colonic bacterial communities|périodique=FEMS Microbiology Ecology|volume=19|numéro=3|date=1996-03-01|doi=10.1016/0168-6496(96)00004-9|lire en ligne=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0168649696000049|consulté le=2017-07-20|pages=193–202}}</ref>. Mais alors que la production de méthane apparaît comme la voie prédominante de recyclage du dihydrogène dans l'intestin de différentes espèces, l'acétogénèse à partir du CO<sub>2</sub> et du H<sub>2</sub> a été supposée comme un mécanisme important pour l'assimilation du H<sub>2</sub> dans le côlon de certains individus humains. Cette production d'acétate représente alors un grand intérêt métabolique pour la santé et la nutrition chez l'humain en diminuant le volume de gaz dans le côlon et en produisant un métabolite non gazeux qui représente une source d'énergie pour l'hôte, à savoir l'acétate. |
|||
Les auteurs se sont donc intéressés aux espèces participant à cette production d'acétate dans l'intestin, qui à l'époque n'avaient pas été étudiées en profondeur. De plus, le peu de souches acétogènes ayant été isolées ne constituaient pas des consommateurs d'hydrogène spécifiques. Bernalier et ses collaborateurs ont donc isolé diverses souches à partir d'échantillons fécaux humains afin de mieux comprendre la diversité et le rôle des acétogènes intestinaux dans le recyclage de l'hydrogène et ils ont découvert cette bactérie. |
|||
Ils l'ont nommée ''Ruminococcus hydrogenotrophicus,'' la première partie du nom étant une référence au genre d'espèces apparentées et la deuxième partie signifiant « qui se nourrit d'hydrogène ». Dans la deuxième moitié des années 2000, Liu et ses collaborateurs ont mené des études phénotypiques et phylogénétiques ainsi qu'un séquençage de l'ARNr 16S sur 15 isolats d'une bactérie à gram positif, anaérobie et en forme de coccus, isolée de selles humaines. Ces études ont mené à la création d'un groupe phylogénétique comprenant un certain nombre d'organismes qui ont tous été transférés au sein du genre ''Blautia'', dont ''Ruminococcus hydrogenotrophicus'', qui a ainsi été renommé ''Blautia hydrogenotrophica''. |
|||
Version du 20 juillet 2017 à 15:58
| Domaine | Bacteria |
|---|---|
| Embranchement | Firmicutes |
| Classe | Clostridia |
| Ordre | Clostridiales |
| Genre | Blautia |
Liu et al., 2008
Blautia hydrogenotrophica, précédemment connue sous le nom de Ruminococcus hydrogenotrophicus, est une espèce de bactérie à gram positif que l'on trouve dans l'intestin des humains et des ruminants. Il s'agit d'un coccus faisant partie de la flore intestinale anaérobie. Cette bactérie a été découverte par Bernalier et ses collaborateurs en 1996 à partir d'isolats de selles humaines[1].
Description
Blautia hydrogenotrophica est une bactérie intestinale à gram positif, en forme de coccus et de taille moyenne de 0,7 × 0,6 µm[1]. À partir d'expériences de coloration négatives menées sur les deux souches découvertes par Bernalier et son équipe, ils ont déterminé que cette espèce ne possède pas de flagelle, et de ce fait est non motile. Elle est présente généralement dans son environnement en tant qu'individu isolé, ou en paires[1].
Historique
Le contexte de la découverte de cette bactérie trouve sa source dans un contexte d'étude de l'acétogénèse en tant que voie métabolique microbienne importante dans les environnements dépourvus d'oxygène mais contenant du CO2 et/ou du H2. L'importance de ce processus a été démontrée dans le tractus gastrointestinal des rongeurs[2], des porcs[3], des ruminants[4], des termites[5] et des humains[6],[7]. Mais alors que la production de méthane apparaît comme la voie prédominante de recyclage du dihydrogène dans l'intestin de différentes espèces, l'acétogénèse à partir du CO2 et du H2 a été supposée comme un mécanisme important pour l'assimilation du H2 dans le côlon de certains individus humains. Cette production d'acétate représente alors un grand intérêt métabolique pour la santé et la nutrition chez l'humain en diminuant le volume de gaz dans le côlon et en produisant un métabolite non gazeux qui représente une source d'énergie pour l'hôte, à savoir l'acétate.
Les auteurs se sont donc intéressés aux espèces participant à cette production d'acétate dans l'intestin, qui à l'époque n'avaient pas été étudiées en profondeur. De plus, le peu de souches acétogènes ayant été isolées ne constituaient pas des consommateurs d'hydrogène spécifiques. Bernalier et ses collaborateurs ont donc isolé diverses souches à partir d'échantillons fécaux humains afin de mieux comprendre la diversité et le rôle des acétogènes intestinaux dans le recyclage de l'hydrogène et ils ont découvert cette bactérie.
Ils l'ont nommée Ruminococcus hydrogenotrophicus, la première partie du nom étant une référence au genre d'espèces apparentées et la deuxième partie signifiant « qui se nourrit d'hydrogène ». Dans la deuxième moitié des années 2000, Liu et ses collaborateurs ont mené des études phénotypiques et phylogénétiques ainsi qu'un séquençage de l'ARNr 16S sur 15 isolats d'une bactérie à gram positif, anaérobie et en forme de coccus, isolée de selles humaines. Ces études ont mené à la création d'un groupe phylogénétique comprenant un certain nombre d'organismes qui ont tous été transférés au sein du genre Blautia, dont Ruminococcus hydrogenotrophicus, qui a ainsi été renommé Blautia hydrogenotrophica.
- (en) A. Bernalier, Anne Willems, Marion Leclerc et Violaine Rochet, « Ruminococcus hydrogenotrophicus sp. nov., a new H2/CO2-utilizing acetogenic bacterium isolated from human feces », Archives of Microbiology, vol. 166, no 3, , p. 176–183 (ISSN 0302-8933 et 1432-072X, DOI 10.1007/s002030050373, lire en ligne, consulté le )
- R. A. Prins et A. Lankhorst, « Synthesis of acetate from CO2 in the cecum of some rodents », FEMS Microbiology Letters, vol. 1, no 5, , p. 255–258 (lire en ligne, consulté le )
- (en) K.g. De Graeve, J.p. Grivet, M. Durand et P. Beaumatin, « Competition between reductive acetogenesis and methanogenesis in the pig large-intestinal flora », Journal of Applied Bacteriology, vol. 76, no 1, , p. 55–61 (ISSN 1365-2672, DOI 10.1111/j.1365-2672.1994.tb04415.x, lire en ligne, consulté le )
- (en) Roderick I. Mackie et Marvin P. Bryant, Acetogenesis, Springer, Boston, MA, (DOI 10.1007/978-1-4615-1777-1_12, lire en ligne), p. 331–364
- (en) John A. Breznak, Acetogenesis, Springer, Boston, MA, (DOI 10.1007/978-1-4615-1777-1_11, lire en ligne), p. 303–330
- (en) Meyer J. Wolin et Terry L. Miller, Acetogenesis, Springer, Boston, MA, (DOI 10.1007/978-1-4615-1777-1_13, lire en ligne), p. 365–385
- Annick Bernalier, Marielle Lelait, Violaine Rochet et Jean-Philippe Grivet, « Acetogenesis from H2 and CO2 by methane- and non-methane-producing human colonic bacterial communities », FEMS Microbiology Ecology, vol. 19, no 3, , p. 193–202 (DOI 10.1016/0168-6496(96)00004-9, lire en ligne, consulté le )