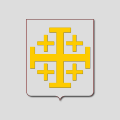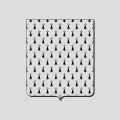Utilisateur:PercevalBxl/Emaux
Chapitre deuxième : les émaux[modifier | modifier le code]
Nomenclature, classification et hiérarchie des émaux[modifier | modifier le code]
En termes simples, les émaux désignent la palette héraldique, c'est à dire les quelques couleurs (et motifs) qu'utilise l'artiste-héraldiste pour représenter graphiquement le blason.
Pour des raisons historiques et culturelles discutées ailleurs, ces émaux sont en nombre extrêmement limité. Et plus encore en héraldique française qu'en héraldique britannique ou germanique, lesquelles acceptent quelques émaux supplémentaires qu'on n'y rencontre d'ailleurs que rarement.
Les émaux sont classés en trois groupes dont la hiérarchie et l'ordre ne sont pas sans importance, dans la mesure où les émaux possédaient une forte valeur dans l'esprit médiéval (comme, d'ailleurs, absolument TOUS les éléments du blason):
- Les métaux sont:
- l'or, représenté par le jaune
- l'argent, représenté par le blanc ou le gris clair
- Les couleurs (parfois nommées "émaux" et, dans ce cas, il faut le prendre au sens strict) sont:
- le gueules, représenté par le rouge
- l'azur, représenté par le bleu
- le sinople, représenté par le vert
- le sable, représenté par le noir
- le pourpre (assez rare), représenté par le violet
- Les fourrures (parfois nommées "pannes") sont:
- L'hermine et la contre-hermine
- Le vair et le contre-vair
Pour information, on trouve aussi parfois parmi les couleurs, l'orangé, le tanné, le sanguine, le murrey et, plus rarement encore, le brun, le fer, le bis et le carnation. Soulignons encore une fois que celles-ci appartiennent surtout à l'héraldique britannique ou germanique.
Ce vocabulaire, hérité de la tradition héraldique la plus ancienne, peuvent sembler étranges ou "délicieusement surrranés", c'est à dire pratiquement inutiles. La précision d'un blason ne perdrait rien, en effet, si l'on disait "rouge" au lieu de "gueules". Pourtant, il importe de les préserver:
- tout d'abord parce que nous passerons beaucoup de temps à déchiffrer des blasons anciens où ces termes sont inscrits;
- ensuite, parce que l'héraldique est fondée sur une symbolique "lourde" que ces termes véhiculent pleinement; leur abandon au profit de termes plus modernes, prétendûment plus "clairs", correspondrait à l'abandon d'une partie essentielle de l'héraldique ("rouge" n'a pas le même contenu culturel que "gueules");
- enfin, parce que le blasonnement est avant tout affaire de rigueur et de conventions communes à tous les hérauts d'armes de tous les temps; abandonner ces termes reviendrait donc à abandonner l'idée fondamentale du blasonnement qui est de permettre à tous les hérauts de déduire le même blason à partir des mêmes armes et inversément.
La règle de contrariété des émaux[modifier | modifier le code]
La classification des émaux en trois groupes (et, accessoirement, leur hiérarchisation) ne doit rien au hasard. En fait, elle permet d'appliquer la règle primordiale des émaux en héraldique ou règle de contrariété (d'alternance) des couleurs qui s'exprime de manière très simple par l'adage: «pas de couleur sur couleur; pas de métal sur métal». Et, bien sûr, pas de fourrure sur une fourrure.
Concrètement, cela signifie qu'il n'est pas permis (et même qu'il est strictement interdit) se superposer ou d'accoler deux émaux de la même catégorie. Ou, si l'on préfère, l'on doit toujours alterner un métal et une couleur, ou un métal et une fourrure, ou une couleur et une fourrure (même si ce cas d'école est plus rare). Les armes qui procèdent autrement sont tout simplement "illicites", à moins qu'elles n'aient reçu l'aval d'un conseil de hérauts d'armes (voir le paragraphe "armes à enquerre").
Existe-t-il des exceptions hormis les armes à enquerre ? Oui et non... Disons qu'il existe plutôt des situations particulières ou des limites à l'application de ce principe :
- le sable était, à l'origine, une fourrure (symbolisation de la zibeline) et on le trouve en tant que tel, dans des blasons fort anciens, associé avec une couleur. Une telle pratique n'est donc pas illicite pour ces blasons-là, mais elle le serait pour un blason de crétaion récente...
- le pourpre (nom masculin quand il s'agit d'une couleur héraldique) a longtemps correspondu à la pourpre ecclésiastique ou impériale, marque de dignité ou de noblesse. On admettait qu'un meuble ou une pièce de pourpre pouvaient parfaitement charger une couleur, pour peu qu'il s'agisse de marquer l'une ou l'autre de ces dignités.
- lorsque l'on compose un écu à partir de deux ou plusieurs autres écus (par exemple pour marquer une alliance matrimoniale ou quand le seigneur souhaite composer ses armes à partir de ses différentes possessions), on divise l'écu en autant de parties que nécessaire (voir le chapitre consacré aux partitions de l'écu) etla règle de contrariété des émaux ne s'applique pas entre les parties de l'écu. Elle s'applique pourant à l'intérieur de chacune des parties de l'écu, à moins que celles-ci ne soient à leur tour divisées pour ontenir d'autres écus. De telles armes sont dites "armes composées".
- La règle reste bien sûr appliquée quand le partitionnement n'a pas pour but "d'afficher" différents écus...
Il existe toutefois un moyen de contourner cette règle, pour des pièces honorables telles que le chef, la fasce, la croix... : les blasonner en disant qu'elles sont "cousues" sur le champ.
-
«de gueules au chef cousu d'azur»
Les armes à enquerre[modifier | modifier le code]
Il arrive que des armes contreviennent à l'une ou l'autre des lois de l'héraldique comme la "règle de contrariété des émaux" évoquée au paragraphe précédent. Dans ces cas très rares, il convient de s'enquérir auprès d'un héraut d'armes du caractère licite de cette anomalie. Car il arrive, très rarement, que l'on accorde le droit de contrevenir aux règles, pour des raisons précises et toujours extrêmement symboliques. De telles armes qui posent question sont appelées "armes à enquerre".
Les armes à enquerre les plus connues (et le plus souvent citées pour illustrer ce propos) sont celles du Royaume de Jérusalem: "d'argent à la croix alaisée potencée d'or cantonnée de quatre croisettes du même".
Dans ce cas précis, l'anomalie est sans doute due au fait qu'à l'époque des croisades, lors de sa fondation, ce royaume était tenu pour le plus noble et le plus saint de la chrétienté. L'héraldique étant essentiellement un langage symbolique, il est probable que les hérauts d'armes ont songé à associer dans ses armes l'or et l'argent, les plus nobles des émaux.
-
«d'argent à la croix alaisée potencée d'or, cantonnée de quatre croisettes du même»
La représentation graphique des fourrures, leurs variantes[modifier | modifier le code]
Les fourrures constituent des émaux un peu particuliers qui appellent quelques remarques.
Comme leur nom l'indique, elles sont la représentation symbolique, avant d'être la représentation graphique, de la fourrure de petits animaux dont le port était réservé aux seigneurs et indiquait la noblesse. Les fourrures sont en outre des émaux "bicolores" et sont impérativement constituées d'un métal associé à une couleur !
L'hermine héraldique évoque la fourrure de l'hermine, proche de la belette, qui est blanche avec une queue noire. On la dessine comme un semis de mouchetures de sable (noir) sur un fond d'argent (blanc). Les mouchetures de l'hermine ne sont pas formellement "standardisées", mais on les dessine le plus souvent comme une queue triplement fourchue surmontée de trois points (cf. les illustrations ci-dessous). Il est à noter que la taille et le nombre des mouchetures n'est pas défini avec précision. Disons qu'ils sont laissés à l'appréciation de l'artiste.
La contre-hermine sera, en toute logique, dessinée comme un semis de mouchetures d'argent (blanches) sur un fond de sable (noir).
Le vair héraldique, quant à lui, évoque la fourrure du petit-gris de Russie, une variété d'écureuil, au ventre blanc et au dos gris-bleu. La description de sa représentation graphique est un peu plus compliquée que celle de l'hermine. Schématiquement, on le représente par des lignes (en langage héraldique, des "tires") superposées de "clochettes" d'azur (bleu) et d'argent (blanches) alternées et disposées "tête-bèche". Les "tires" du vair sont disposées de telle manière que la pointe d'une clochette d'azur soit aboutée à la pointe d'une clochette d'argent. En outre, la première tire du chef de l'écu doit impérativement commencer par une demi clochette de métal inversée (la pointe en bas) et se terminer de la même manière. Cette première tire doit donc comporter un nombre entier de clochettes de couleur (cf. l'illustration ci-dessous).
Les auteurs anciens, quand ils abordent la question, sont très divisés sur le nombre de clochettes que doit compter une tire La règle la plus commune est que le vair est constitué de 4 ou 5 clochettes de couleur dans la première tire du chef de l'écu. A moins de trois clochettes, on parlera de "beffroi", tandis qu'à plus de 5 clochettes, on parlera de "menu vair". Quant au nombre de tires, il doit être égal au nombre de clochettes de couleur dans la première tire.
- Le "beffroi" est un motif rare, aussi appelé "gros vair", qui échappe à l'attention de la plupart des auteurs de traités anciens.
- Le "beffroi" est un motif rare, aussi appelé "gros vair", qui échappe à l'attention de la plupart des auteurs de traités anciens.
Le contre-vair, le vair en pal et le vair en pointe divergent du vair dans la manière dont les tires sont superposées:
- le contre-vair superpose les clochettes "base contre base", "couleur contre métal" et inversément
- le vair en pal superpose les clochettes "pointe contre base", "couleur contre métal" et inversément
- le vair en pointe superpose les clochettes "pointe contre base", mais en "couleur contre métal"
Le vair renversé se distingue du vair par le fait que la première demi-clochette de la tire du chef (toujours de métal) se trouve pointe vers le haut plutôt que vers le bas. On peut également renverser les variations du vair: contre-vair renversé, vair en pal renversé et vair en pointe renversé...
Enfin, il est important de noter, pour ce qui concerne le vair et ses variations, que la première demi-clochette de la tire du chef est toujours de métal (argent). Sinon, il convient de le blasonner comme un vairé (voir plus loin): vairé d'azur et d'argent (par exemple).
Herminés et vairés[modifier | modifier le code]
C'est plus rare, mais l'hermine, le vair et les variations du vair peuvent adopter des couleurs différentes de celles qui les définissent. Dans ce cas, on les blasonnera "herminé" et "vairé". Sans oublier qu'ils doivent toujours associer un métal à une couleur.
- herminé d'or et de gueules (en commençant par le fond avant les mouchetures)
- vairé d'argent de de sinople (en commençant par la première demi-clochette de la tire du chef)
- Remarque: Il existe une proximité évidente entre les herminés/vairés et les semés/échiquetés. Les nuances seront analysées dans ces chapitres.
- par analogie avec les semés, on blasonne parfois les hérminés: "d'or herminé de gueules";
- d'or herminé de sable est aussi parfois appelé erminois;
- de sable herminé d'or est appelé péan;
Remarques terminologiques[modifier | modifier le code]
- Pour des raisons qui demeurent mystérieuses, le champ n'est pas blasonné "plain" quand il est couvert d'une fourrure ou d'une variation d'une fourrure.
- Parfois (à tort) orthographié "plein", le terme "plain" vient du latin "planus" qui signifie "plat" ou, plus exactement, qui correspond à l'adjectif français "plan". En héraldique, c'est le champ qui est plain et non pas l'émail... Par conséquent, il est inutile de lui chercher un féminin que, d'ailleurs, il ne possède pas.
Illustrations[modifier | modifier le code]
LES METAUX
-
«d'or plain»
-
«d'argent plain»
LES COULEURS
-
«de gueules plain»
-
«d'azur plain»
-
«de sinople plain»
-
«de sable plain»
-
«de pourpre plain»
LES COULEURS RARES
-
«de tanné plain»
-
«de brun plain»
-
«d'orangé plain»
-
«de fer plain»
-
«de sanguine plain»
-
«de bis plain»
-
«de carnation plain»
LES FOURRURES
-
«d'hermine»
-
«de contre-hermine»
-
«de vair»
-
«de contre-vair»
LES VARIATIONS DU VAIR
-
«de vair en pal»
-
«de vair en pointe»
-
«de vair renversé»
-
«vairé d'azur et d'argent»
Les herminés et les vairés
-
«herminé d'or et de sable» ou «d'erminois»
-
«herminé de sable et d'or» ou «de péan»
-
«herminé de gueules et d'argent»
-
«vairé d'or et de gueules»
-
«vairé de sinople et d'argent»